
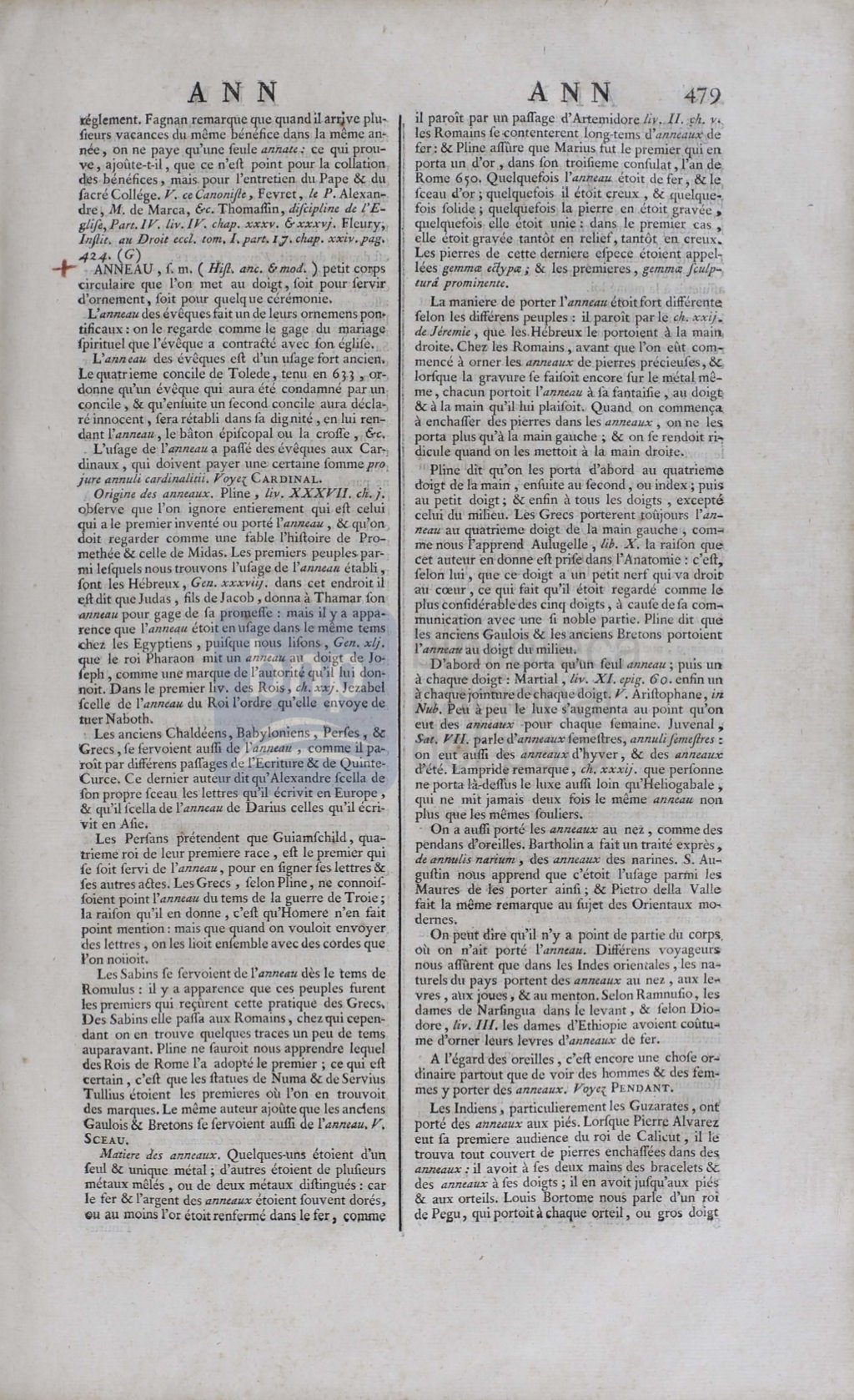
ANN
reglement. Fagnan remarque 'fre quandil arQve plu–
íieurs vacances du meme bénefice dans la meme an–
née,
On Re paye qu'lIne feule
annate,·
ce
qui
pr~>u
ve,
ajoíhe-t-il, que ce n'ell point pour la collatwn
des.bénélices, mais,pour I'entretien du Pape
&
dú
{acré Collége.
V. ce
Callonifte,
Fevret,
le P.
Alexan–
dre,
M.
de Marca,
&e.
Thomaffin,
difci.pli~e
de
l'E–
gJi.fi,P
art.]
V.
[iy.]
V.
c/zo,p. xxx
y
•
&
XXXy}.
f:leuty;
¡"'jiie. au Eroie eeel. tom.l.part.
1..J.
chapo xxw.pag.
42.+
CG)
-1-
ANNEAU, f. m. (
Ilifl.
anc.
~
mod,.
)
perit
co~s
circulaire q\le I'on met au do¡gt, foa pour fervll'
d'ornement,
feit
pour quelque cérémonie.
L'
anmau
des éveques fait un de leurs ornemens pon.
tilicaux: on le regarde cornme le gage du roari"ge
fpirituel que I'éveque a contraéré avec fon. églife.
L'anneau
des éveques
ea
d'un ufage fort ancien.
Lequatrieme concile de Tolede, tenu en
6}3
,. or–
donne qtl'un
évequ~
qui' aura été con:damné par un,
concile,
&
q~l'en111lte
un fecond conc¡[e aUra déela–
ré innocent , fera rétabli dans fa dig nité , en
lui
ren–
dant
I'anneau,
le baton épifcopalou la croí[e,
&.:..
L'u(age de
l'anneau
a paífé des éveques aux Car .
dinaux, qui doivent payer une certaine
fommepro.
jure annuti cardinalitii.
Vo~e{ CA~DINAL.
.
Origine des anneaux.
Pline,
lw.
XXXVlI.
ch.}.
o»ferve que I'on ignore enrierement qui ell celui
qui ale premierinventé ou porté
l'~~nea.u,
&<J.uIOrL,
deit regarder comm.e une fable l.hillo1l'e de Pro–
methée
&
ceHe de Midas. Les preffilers peuples. par–
mi le(quels nous trouvons
l'uf~.ge
de l'
annealt
éta~li.,
(om
les Hébreux,
Gen.
xxxyU¡.
dans cet endrolt il
-efl
dit que JlIdas , fils de Jacob , donna
~ ~hamar
[on
WlIleau
pour gage de fa promeífe: malS 1I
'f
a appa–
rence que l'
allnef{lt
éroit .en lI[age dan:s le meme tem.s
ciJ.ezles Egyptiens , Pl!ifque nous h[ons '.
Gen. xl¡.
que le roi PharaoR mlt un
anneait
au dOigt de Jo–
feph, comme une
~ar'fue
de
I'aut.orit~ qu'i~
lui don–
noit. Dans le preffiler hv. des
ROI&,
ch.
XX).
J
ezabel
fcelle de
I'anneau
du
Roí
I'orilie qu'elle envoye de
mer Naboth.
.
,
Les anciens Chaldéens, Babyloruens , Penes,
&
'Grecs (e fervoient auffi de
l'anneau
,
comme il pa–
roit pa'r différens paífages de l'Ecritme
&
de Quinte–
Curce. Ce dernier auteur dit qu'Alexandre {cella de
fon propre [ceau les lettres qu'il. écrivit en
E~!r~pe.'
&
qll.'il (cella de l'
anneau
de Danus celles qu il ecn–
vit en Aíie.
Les Perfans prétendent qlle Guiarnfchild, q'ua–
trieme roi de lem premiere race , eíl le premier qui
{e (oit [ervi de l'
anneau,
pom en ftgner fes lettres
&
fes autres aéres. Les Grecs , felon Pline, né connoi[–
[oient point l'
anneau
du tems de la guene de Troie ;
la rai(on qu'il en donne , c'eft
qu'Homer~
n'en fait
point mention : mais que quand on voulOltenvoyer.
des lettres , on les lioit enfemble avee des cardes que
l'on noiioit.
LesSabins [e (etvoient de l'
annellU
des le tems de
Romulus : il y a apparence que ces. peuples furent
les premiers qui rec;:ílrent cette priltlque
de~
Grecs,
Des Sabins elle paífa aux Romams, chez
CfU1
cepen–
dant on en trouve quelqul':s traces un peu de tems
auparavant. Pline ne (amoit nous apprendre leque!
des Rois de Rome I'a
adop~é
le premier ; ce Cflü ell
certain, c'ell Cflle les
ílan~es
de
~u~a
&
de
Servi~s
Tullius étoient les premleres óu Ion en troUVOlt
des marCflles. Le meme
aut~ur
ajoute Cflle ,les andens
Gaulois
&
Bretons fe [ervOlent au1li. de 1
anneau. V.
SCEAU.
Mmiere des anneaux.
Quelques-i.lns étoieilt d'un
feul
&
unique métal; d'alltres éroient de plufteurs
métaux mlHés , ou de deux métaux dillingués: car
le fer
&
I'argent des
anneaux
étoient [ouvent dorés,
'eU
al!
moins l'or étoitrenfermé dans le fer, co¡nme
ANN
479
il paroit par un paífage d'A:rterpidore
¡iy. IJ..fh.
Y ,.
les Remains fe-contenterent long-teros
d'anneaux
de
fer:
&
Pline a1ITlTe que Marius
fi.~t
le premier.qui en
Rorta un d'or , dans
(01\
t¡:oiíieme confulat, l'an de
Rome 650. QuelCfllefois l'
allPetlJl,
étoit de fer,
&
le
fceau d'er ; 'quelquefois il ét6it ereux ,
&.
![uelque–
fois folide; q1lel'(llefois la pierre en .étoit gravée ,
qJ.lel~llefois
elle etoit unie; dans le
prem~e(
cas ,
elle eroit gravée tantot en relief, tanto!, en. creux.
Les pierres de cene derniere efpeee étoient appel¡
lées
gemmlE ef/yPlE;
&
les premieres ,
gemmlli
[culp–
tura
prominente.
La maniere de porter
l'anneau
étoitfort di./férente
[elon les différens peup,les :
il
paroit par le
ch.
xxij.
de
Jéremie,
que les.Hebreux le portoient
a
la main,
droite. Chez
ltls
Romains ,
avant
c¡ue I'on ellt com–
meneé
a
arner les.
anmaux
de pierres précieuJes,
&J
lorfque la gravure [e faifoit
enco~e
[UI
le métaLme–
me, chacun portoit
I'anne,,·u
a[a fantaiiie, au doigt;
&
a la main qu'illui plaiíoit" Quand on
commeJ1~a.
a
enchaífer des pierres dans les
annealtX,
on ne les
porta plus qu'a la main gauche ;
&
on fe rendoit ri>:
dicule quand on les mettoit
a
la main droi,te,
Pline dit Cfll'on les port-a d'abord au
CfLlatr~eme
doigt de
la
main, enCuite au [eaond,
GU
index; pllis
a\.l petit doigt;
&
enlin
a
tous les doigts , excepté
celuí du milieu. Les Grecs porterent tOÍljOlfr-s
l'an–
neau
a11 quatrieme doigt de la main gauehe , com'"
me n01ls Papprend Aulugelle,
lib. X.
la raifon
qu~
cet auteur en donne ell prife'dans
l'
Anatomie : c'eíl,
{elon lui , c¡ue ce doigt a un perit nerf c¡ui va droit.>
-au
creur, ce qui· fait <j.u'il étoit regardé comme le
plus conftdérable
des
eme¡ doigts,
a
.cau(~
de (a. com–
muniéation avec ·une
fi
noble partIe. Plme dlt que
les anci:ens Gaulois
&
les anciens Bretons ponoient
l'a-nmattau doigt du milieu.
.
D'abord- on ne porta qu'üI1 feul
anh.eau;
plUS
UIl
achaque doigt: Manial,
liy. .
XI.
epig.
60.
enlio Ull
ir:chaqU'ejointnre dechaque cloigr.
V.
Arillophane,
in
Nu'/,.
Feh
a
peu le luxe s'augmenta au point qu'on
eut des
a1HZeaux
-pom chaque [emaine. Juvenal,
Sat, PIlo
p-arle d'
anneaux
femefues,
annuliflme.ftres:
on eut auffi des
anneaux
d'hyver,
&
des
Ilnneaux
d'été. l.ampride remarque,
ch. xxxij.
que perfonne
ne porta1·a,.de.Jfus le luxe auffi loin CfLI'Heliogabale,
CfLü ne mit jamais deux
fuis
le meme
anneau
non
plüs que les memes fouliers,
- On a ·au$ porté les
annealtX
au
nei,
eomme des
pendans cVoreilles. Bartholin a fait un
tr~ité
expres ,
de annulis narium,
des
anneaux
d'es nannes. S. Au–
gullin nous apprend que e'étoit l'ufage
parmi
les
Maures ue les porter ainft;
&
Pietro della Valle
fait la ffieme remarque au uljet des Orientaux mo–
demes.
On
pei.itdire qu'il n'y a point de parrie du corps.
oll on
n'ait
porté
l'anneau.
Différens voyageurs
nous afffirent q'ue dans les Indes orientales , les na–
turels du pays portent des
anmaux
au nez , aux
le~
vres, atlx joues,
&
au menton. Selon Ramnufto, les
clames de Naru.ngua dans!e l·e.vaJ?t,
&
,celon I?io–
dore,
liy. ]JI.
les dames d Ethiople avolent
coutu~
me d'orner leurs levres
d'anneau.:t'
de fer.
A I'égard des oreilles, c'eíl encore une chofe or"
'dinaire partout que de voir des hommes
&
des fem–
mes
y
porter des
anneaux. Vqye{
PENDA!'IT.
Les Indiens, particulierement les Gl!zarates , ont
porté des
anneaux
aux piés. Lon:que Pler:!!
Alv~rez
'eut [a premiere audiénce du rOl de Cali<:ut , il le
trouva tout couvert de pierres enchaífées dans des,
anmaux:
il avoit
a
(es deux mains des bracelets
&
des
anneaux
a
(es doígts ;
il
en avoit jufqu'aux piés
&
aux orteils. Louis Bortome nous parle d'un rOl
de Pegu, qui portoit
¡\
chaq~e
Qrteil, ou gros doi¡¡t
















