
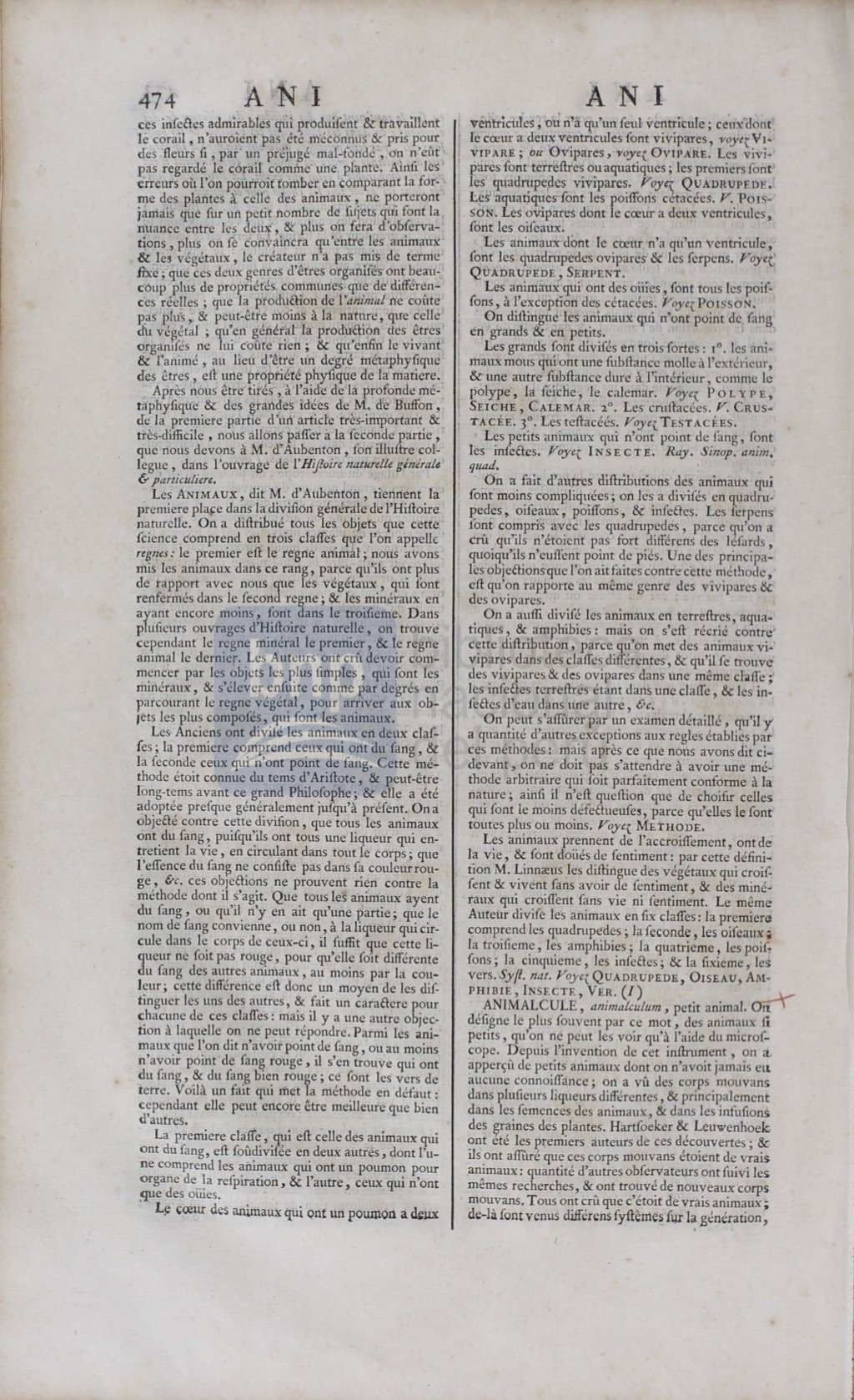
474
A
N
I
ces mfeaes admirables qui produifent
&
travaillent
le corail , n 'amolent pas été n'féconnus & pris potU'
des flems ú , par un préjugé mal-fondé ,
o~
n'eiu'
pas regardé le córail comme' une, pf'aore. Alnft les
erreurs olll'on poútroif fomber en comparant la for–
me des plantes a celle des atümaux '. ne P?rteront
¡amais que (ur IIn petit nombre de!
(I~'ets qt~1
font la
nuance entre les deltX, &: plus on feta d'ob(erva–
rions plus
011
(e conváincra qtl'entre les animaux
&
le; végétaux , le créateur n'a pas mis de terme
me' que ces deux genres
d'~tres
orgal'llfé's-ont beau–
coup plus de propriérés communes que de différen–
ces réelles ; que la ptoch.uSlion de I
'anima!
ne coute
pas
plu~
&
pellt-etre moins a la mrtnre, <'¡lce celle
dÍ!
vé~ét:U
; qll'eo géneral la produéliótl des
.~tres
orgarufés ne luí coute rien;
&
qn'enfin le vlVant
&
I'animé , au lieu
d'~tte
un degr1
iJré'taphy~qt,e
des etres, efr une propriété phyllque de la mauere.
Apres nous
~tre
ti¡-és , a I'aide de lá profonde mé–
taphyúqlie.& des
$Tan~eS i:d~es
de M: die Buffon,
de la premlere partle d
no
art1cte fres-mtportant,
&
ttes-difficile , nous allons patrer a la (econde paroe ,
que nous devons a
M.
d'AubentOn, fon illufue col–
legue, dans l'ouvragé de
I'Hijloire natimlle gÍlúrale
&
parlÍculiere.
Les ANIMAUX, dit
M.
d'Aubenton, tiennent la
premiere place dans la divifion gérrérale de I'Hifroire
naturelle. On a difuihué tOtlS les objets que
cette
fcience comprend en trois c1alfes que I'on appelk
regnes:
le premier
ell:
le regne animál; non5 avons
mis les animaux dans ce rang, paree qll'ils ont plus
de tapport avec nouS que les vl!gétaux, qui (ont
renfermés dans le fecond regne;
&
fes minérallx en
ayant encore moins, font dans le troiúeme. Dans
pluúeurs ouvrages d'Hilloire naturelle, on trouve
cependant le regne minéral le premier,
&
le regne
animal le dernier. Les Auteurs ont cril devoir com–
menc'er par les objets les plus úmples, qt\i (ont les
minéraux,
&
s'élever enfuite comme par degrés en
parcourant le regne végétal, pour arri'Ver amt ob–
/ets les plus compofés, qui font les animaux.
Les Anciens ont divue les animanx en deux c1af–
fes; la premiere comprend ceux qui ont du fang ,
&
la feconde ceux qui n'ont point de fango Cette mé–
thode étoit connue du tems d'Ariíl:ote,
&
peuf-~tre
long-tems avant ce grand Philo(ophe;
&
elle a été
adoptée prefque généralement jufqtl'a préfent. On a
objeaé contre cette diviíion, clue tous les animaux
ont du fang, puifqu'ils ont tous une liqtleur qui en–
tretient la vie, en circulant dans tout le corps; que
l'etrence du fang ne coníiíl:e pas dans fa couleurrou–
ge,
l/c.
ces objeélions ne prouvent ríen contre la
méthode dont il s'agit. Que tous les animaux ayent
du fang, ou qu'il n'y en ait qu'une I?artie; qtle le
nom de fang convienne, ou non,
a
la hqtleur qui cir–
cule dans
I~
corps de ceux-ci, il fuffit qtle cette
li–
queur ne fOlt pas rouge, pOUT qu'elle foit différente
du fang des autres animallx, au moins par la cou–
leur; cette différence eíl: done
un
moyen de les dif–
ringuer les uns des autres,
&
fait un caraaere pour
chacune de ces c1atres: mais il y a une autre objec–
rion a laquelle on ne peut répondre. Parmi les ani–
mallX que I'on dit n'avoir pomt de fang, ou au moins
n'avoir point de (ang rouge, il s'en trouve qni ont
du fang,
~
du fan.g bie.n rouge ;
c~
font les vers de
terreo Voila un falt
qut
met la methode en défaut:
cependant elle peut encore etre meilleure que bien
d'autres.
La premiere claít'e, qui eíl: celle des animaux qui
ont du fang, eíl: (oudivüee en deux autres, dont l'u–
ne comprend les animaux
qu1
ont
un
poumon pour
organe de la refpiration,
&
I'autre, celLX qui n'ont
9lle des omes.
L~
'cetlC
des animaux qui
Qnt
un poumon a
deux
ANI
ventricules, ou n'a qu'un feul ventricule; cel1xclont
le cceur a detLX ventricules font vivipaTes,
voye{
¡–
VIPARE;
Oll
Ovipares,
voye{
OVIl'ARE. Les vivi–
pares font terreftres ouaquatiques ; les premiers font
les quadmpedes vivipares.
Voy~
QUADRUPEDE.
I:.es aquatiqtles font les poiífons cetacées-.
V.
POI -
SÓN.
Les ovipareS dont le ccelO' a deux ventricules,
font les oifeatlx.
Les animaux dont le ctenr n'a qu'l1n ventricule,
font les qtladmpedes ovipares
&
les ferpcns.
royet'
QUADRUPEDE) SERPENT.
Les anima'nx qt,i Ont des oi\ies , font tous les poif–
fons,
a
l'exception des cétacées.
Voye{
Po
ISSON.
On diilingue les anímaux qtli n'ont pomt de fang
en grands
&
en perits.
Les grands font divifés en trois fortes:
¡o.
les ani–
mauxrnolls q(ti ont une fllbíl:ance molle
a
l'extéricllr,
&
une autre fi:tbil:ance dure a l'intérieur, comme le
polype, la feiche, le calemar.
Voye{
Po
L
y
PE,
, SEICHE, CAJ:EMAR.
1°.
Les cruíl:acées.
V.
CRUS4
TACÉE.
3°.
Lestefracéés.
Voye{TESTACÉES.
Les petits animaux qui n'ont point de fang, font
les infeaes.
Yoye{
INSECTE.
Ray. Sinop. animo
<filad.
.
On a
f:lit
d)atltres dillributions des animatix qtú
font moins compliquées; on les a divi(és en 'l.uadru–
pedes, oifeawx, poiífons,
&
infeaes. Les jerpens
font compri's avec les quadntpedes, paree qu'on a
crú qll'ils n'étorent pas fort différens des Jéfards,
qt,oiqu'ils n'euífent pomt de piés. Une des principa–
les objeaionsque I'on aitfaites contre cette mét!tode,
eíl: qll'on rapporte au meme genre des vlvipares
&
des ovipares.
On a auffi divifé les animaux en terrefues, aqua–
tiqtles,
&
amphibies
t
mais on s'e!t récrié contre
cette dillribution, paree qtl'oñ mer des animaux vi–
vipares dans des cla/res différentes,
&
qu'il fe trouve
des vivipares
&
des ovipares dans \lne meme daífe;
les infeaes tertefués érant dans une claífe ,
&
les
in.
feaes d'eau dans une autre,
&c.
On peut s'alfurer par IIn examen détaillé, C(\1'il
y'
a quantité d'autres exceptions aux regles établies par
ces méthodes; maís apres ce 'lue nOllS avons dit ci–
devant, on ne doit pas s'attendre a avoir une mé–
thode arbitraire qui {oit parfaitement conforme
a
la
nature; ainú
íI
n'eíl: queillon qtle de choiftr celles
qui (ont le moins défeaueufes, paree qtl'elles le font
toutes plus ou moins.
Voye{
METHODE.
Les animaux prennent de l'accroiífement, ontde
la vie,
&
font doiiés de fentiment; par cette défini–
tion
M.
Linnil!us les di1I:ingue des végétaux qui croif–
fent
&
vivent fans avoir de fentintent,
&
des miné–
taux qlti croifi'ent fans vie ni fentiment. Le meme
Allteur divire les animallx en úx clatres: la premiere
comprend les quadrupedes ; la feconde, les oifeallx;;
la troiíieme, les amphibies; la quatrieme, les poif,
fons; la cinqttieme, les infeaes;
&
la úxieme, les
vers.Syfl.
nato
VoyetQUADRUPEDE, OISEAU,AM.
PRIBIE, INSECTE, VER.
(1)
;\'"
ANIMALCULE,
animalculum,
petit
animal,
On.
déúgne le plus fouvem par ce mot, des animallx
íi
petits, qu'on ne peut les voir qtl'a l'aide du microf–
cope. Depuis I'invention de cet infuument, on
a.
apper~íi
de petits animaux dont on n'avoit jamais
ell
aucune connoitrance; on a vil des corps mOuvans
dans pluíiellrs liqllems diíférentes,
&
principalement
dans les femences des animallx,
&
dans les infuúons
des graines des plantes. Hartfoeker
&
Leuwenhoek;
ont eté les premiers auteurs de ces décollvertes ;
&
ils ont afITlré que ces corps mOllvans étoient de vrais
animaux: quantité d'autres obfervatems ont fuivi les
memes recherches,
&
ont trouvé de nouveaux corps
mouvans. Tous ont cm que c'étoit de vrais anÍIDaux;
de-1Hont venus diiférensfyfiemes
{¡~r I~
génération,
















