
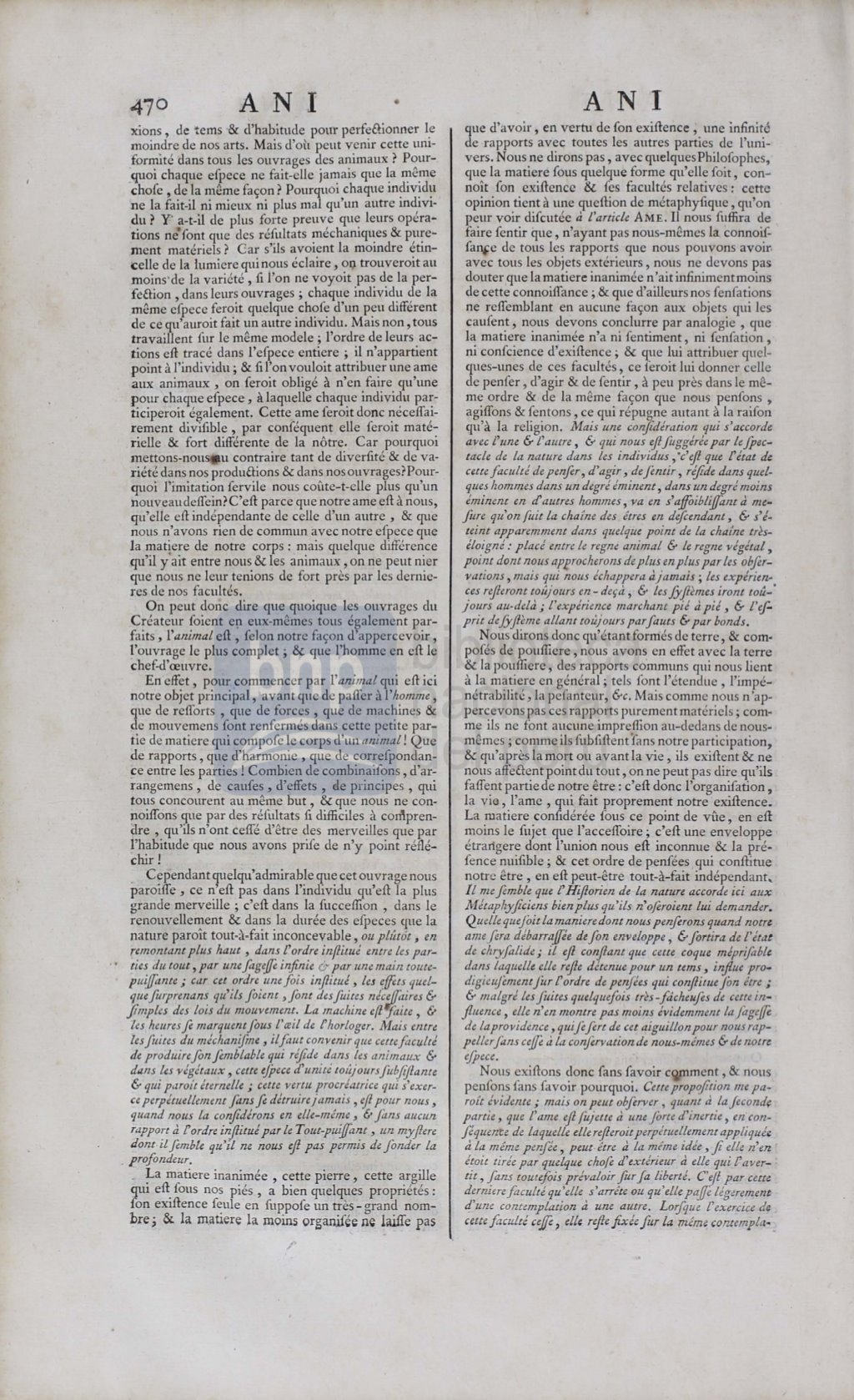
A N 1
XÍons, de t ems
&
d'habitude pOlfr perfeélionner l.e
rnoindre de nos arts. Mais d'oll peut venir cette um–
fDrmité dans tous les ouvrages des animaux ? pour–
quoi chaque efpece ne fait-elle jan:tais que l.a
n:te~e
chofe, de la meme fa<;on? PourquOl chaque
m~v~d~l
.ne la fait-il ni mieux ni plus mal qu'un autre mruvl–
du?
yo
a-t-il de plus forte preuve que leurs opéra–
tions néfont que des réfultats méchaniques
&
pure~
ment matériels? Car s'ils avoient la moindre étin–
celle de la lumiere qui nous éclaire ,
01}
trouveroit au
moins'de la variété , íi l'on ne voyoit pas de la per–
feétion dans leurs ouvrages ; chaque individu de la
meme ;fpece feroit quelque chofe d'un peu différent
de ce qu'auroit fait un autre individuo Mais non, tous
travaillent fur le meme modele; l'ordre de leurs ac–
lÍons eíl: tracé dans l'efpece entiere ; il n'appartient
point
¡'¡
l'inruvidu;
&
íil'on vouloit attribuerune ame
aux animaux , on feroit obligé
a
n'en faire qu'une
pour chaque efpece,
a
laquelle chaque individu par–
lÍciperoit également. Cette ame feroit done néceífai–
rement diviíible , par confequent elle feroit maté–
rielle
&
fort differente de la notre. Car pourquoi
mettons-nons u contraire tant de ruveríite
&
de va–
riete dans nos produétions
&
dans nosouvrages?Pour–
qnoi l'imitation fervile nous cOllte-t-dle plus qu'un
nouveaudeífein?C'eíl: parce que notre ame eíl:
a
nons,
qu'elle eíl: indépendante de celle d'un autre,
&
que
nous n'avons rien de commun avec notre efpece que
la mat!ere de notre corps: mais quelclue différenee
qu'il y ait entre nous
&
les animaux , on ne peut nier
que nous ne leur tenions de fort pres par les dernie–
res de nos facultes.
On peut donc dire que qnoique les ouvrages du
Createur foient ep. eux-memes tous egalement par–
faits,
l'animal
eíl: , felon notre fa<;on d'appercevoir,
l'ouvrage le plus complet ;
&
que l'homme en eíl: le
chef-d'renvre.
En
effet, pour commencer par
l'
animal
qui eíl: ici
notre objet principal, avantqne de paífer
a
I'nomme ,
que de reíforts , que de forces , que de machines
&
de mouvemens Iont renfermés dans cette petite par–
tie de matiere qui compofe le corps d'un
animal!
Que
de rapports, que d'harmonie , que de correfponclan–
ce entre les parties ! Combien de combinaifons , d'ar–
rangemens, de caufes, d'effets , de principes , qui
tous concourent au meme but,
&
que nous ne con–
noiífons que par des refultats íi difficiles
a
co~pren
dre , qu'ils n'ont ceífé d'etre des merveilles que par
1'habitude c¡ue nous avons prife de n'y point réfle–
chir!
. Cependantc¡uelqu'admirable que cetouvrage nous
paroiífe, ce n eíl: pas dans l'individu c¡u'eíl: la plus
grande merveille ; c'eíl: dans la fucceffion , dans le
renouvellement
&
dans la durée des efpeces que la
nature parolt tout-a-fait inconcevable,
OIt
plútót , en
remontant plus haut
,
dans l'ordre inflitué entre les par-
.•
ties du tout ,par unefageffi infinie
&
par une main toute–
puij[ante; car
Cel
ordre une fois injlitué, le!
~fTets
qud–
queforprenans qu'ils foient
,
font desfuites néc:ff:ires
&
jimples des lois du mouvement. La maelúne e(i 'foite,
&–
les henresfl marquemJous l'atil de L'l,orloger. Mais
entr~
lesJuites du méchanifme
,
ilfaut convenirque cettefoc7Jlté
de produirefon flmblable qui rijid? dans les animau.;r:
&
dans les végétaux
,
ee!te ifPece d'unité toíljoursJubj'iflante
&
qui paroÍt étemelle
;
cette vertu proeréatriee qui s'exer–
ceperpétuellementJans
fl
détruirejamais, ejl pour nous,
quand nous la conjidérons en elle-méme,
&-
fans aucun
rapport a l'ord" inJlituépar le Tout-puij[ant
,
un myjlere
dont il flmble qu'il ne nous
ejl
pas permis
d~
Jonder la
. profondeur.
.
~a
matiere inanimée , eette pierre, cette argille
qul eíl:. fous nos piés, a bien quelques propriétes:
fon eXlíl:ence
f~ule
en fuppofe un tres - grand nom–
bre;
&
la matlere la moins
organífée
ne laiífe pas
A N 1
que d'avoir , en vertu de fon exiil:ence; une infinité
de rapports avec toutes les autres parties de l'lmi–
verso Nous ne dirons pas, avec quelquesPhilofophes,
que la matiere fous quelque forme qu'elle foit, con–
nOlt fon exiíl:ence
&
fes facultes relatives: cette
opinion tient
a
une queíl:ion de métaphyfic¡ue , qu'on
peur voir difcutée
a l'article
AME.
Il nous fuffira de
faire fentir que, n'ayant pas nous-m&mesla connou–
fans:e de tous les rapport5 que nous pouvons avoir.
avec tous les objets exterieurs , nous ne devons pas
douter que la matiere inanimee n'aitinfullmentmoins
de cette eonnoiífance ;
&
c¡ue d'ailleurs nos fenfations
ne reífemblant en aucune fa<;on aux objets CjlÚ les
caufent, nous devons conclurre par analogie , que
la matiere inanimée n'a ni fentiment,
ni
fenfation ,
ni
confcience d'exiíl:ence;
&
que lui attribuer quel–
qtles-unes de ces facultes, ce feroit luí donner celle
de penfer , d'agir
&
de fentir ,
a
peu pres dans le
m~me ordre
&
de la meme fa<;on que nous penfons ,
agiífons
&
fentons, ce qui repugne autant a la raifon
qtl'a la religion.
Mais une eonjtdération qui s'accord,
avec l'une
&
l'autre,
&
qui nous ejlJuggérée par
le
JPsc–
tacle de la naUlre dans tes individus, ·e'e[! que l'état de
eette facuLeJ de penfer, d'agir, dejéntir, réJide dans que!–
ques hommes dans
UIl
degréémimnt, dans un degrémoins
éminenc en
d'
autres hommes, va en s'affoibLij[ant a me–
Jure qU'OIl fuit La ehaím des étres en difcendant,
&
s'é–
teint apparemment dans que/que point de la cll/lme
tr~s
éLoigné: placé entre le regm animal
&
Le regne végétal ,
Jfoint dOIl! nOllS 4pl!rocherons deplusenplusparles obflr–
vatÍons, mais qui nous éellappera ajamais; les expérien,.
ces rejleront toftjours en
-
de9ft,
&
les
fyjl~mes
iront toú-'
jours au-de/a; l'expérience marchant pié a pié,
&
l'ef–
prit defyjleme allallf toujours parJauts
&
par bonds.
Nousdirons donc qtl'étantforrriés de terre,
&
com.
pofes de pouffiere, nous avons en effet avec la terre
&
la poufliere, des rapports communs qui nous lient
a
la matiere en genéral ; tels font l'etendue, I'impé–
nétrabilité, la pefanteur,
&e.
Mais comme nous n 'ap–
percevonspas ces rapports purementmatériels; com–
me ils ne fpnt aucune impreffion au-dedans de nous–
memes ; comme ilsfubíiíl:ent fans notre participation,
&
qu'apres la mort ou avantIa vie , ils exiíl:ent
&
ne
nous afFeétent pointdu tout, on ne peut pas dire qu'ils
faífent partiede notre &tre: c'eíl: donc l'organiIation,
la vie, l'ame , qttÍ fait proprement notre exillence.
La ruatiere coníidérée fous ce point de vlte, en eíl:
moins le flljet que l'acceífoire; c'eíl: une enveloppe
étrartgere dont l'union nous eíl: inconnue
&
la pre–
fenee nuiíible ;
&
cet ordre de penfees c¡ui coníl:itue
notre etre , en eíl: peut-etre tom-a-faít indépendant,
It
meflmbLe que
l'
Hijlorien de la Ilaturt accorde ici aux
Métaphyjiciens bienpLusqu'ils Il'oferoient lui
demand~r.
Que/lequejoit la manieredone nous penferons quand nOtre
amejera débarraffie deJOIl enveloppe ,
&
Joreira de tétae
de ehryfaLide; il ejl conjiant que eme coque méprifabLe
dans laquelle elle rejle detenue pour un ams, influe pro–
digieufementJur l'ordre de penJées qui conjlituejim etre ;
&
maLgré les jilites qlle/qaefois tres
-
fácheufls de eette in–
flaenee, elle n'en montre pas moins évidemment la fageffi
de laprovidellee, quiflflrt de cet aiguillonpour nousrap–
pellerfans ce¡¡.
ti
la conflrvatiollde nous-memes
&
de"oue
ifPece.
Nous exiíl:ons donc fans favoir
c~mment
,
&
n011S
penfons fans favoir pourquoi.
Cmepropojition me pa–
roít évidente; mais onpeut obflrver, 'juallt a la flconde
partie, que l'ame
efl
fujette a une forte d'i!lenie, en con–
Jé'lllente de laquelle ellerejleroitperpétmllementappLiquée
a La meme penJée , peut étre a La mime idée ,ji elle Il'en
itoit tirée par queLque chofe d'extériwr a elle qui l'aver–
tit, Jans toutefois prévaloir jitrfa Liberté.
C'1l
par eeae
demierefoculté qu'elle s'arrúe ou qu'elle paJ[e lég¿rement
d'lIIze eonumplation
ti
une autre. Lorji¡ue l'exerciee de
Celle foculté ceffo, elü rejle ft.xée jitr la méme comempla-
















