
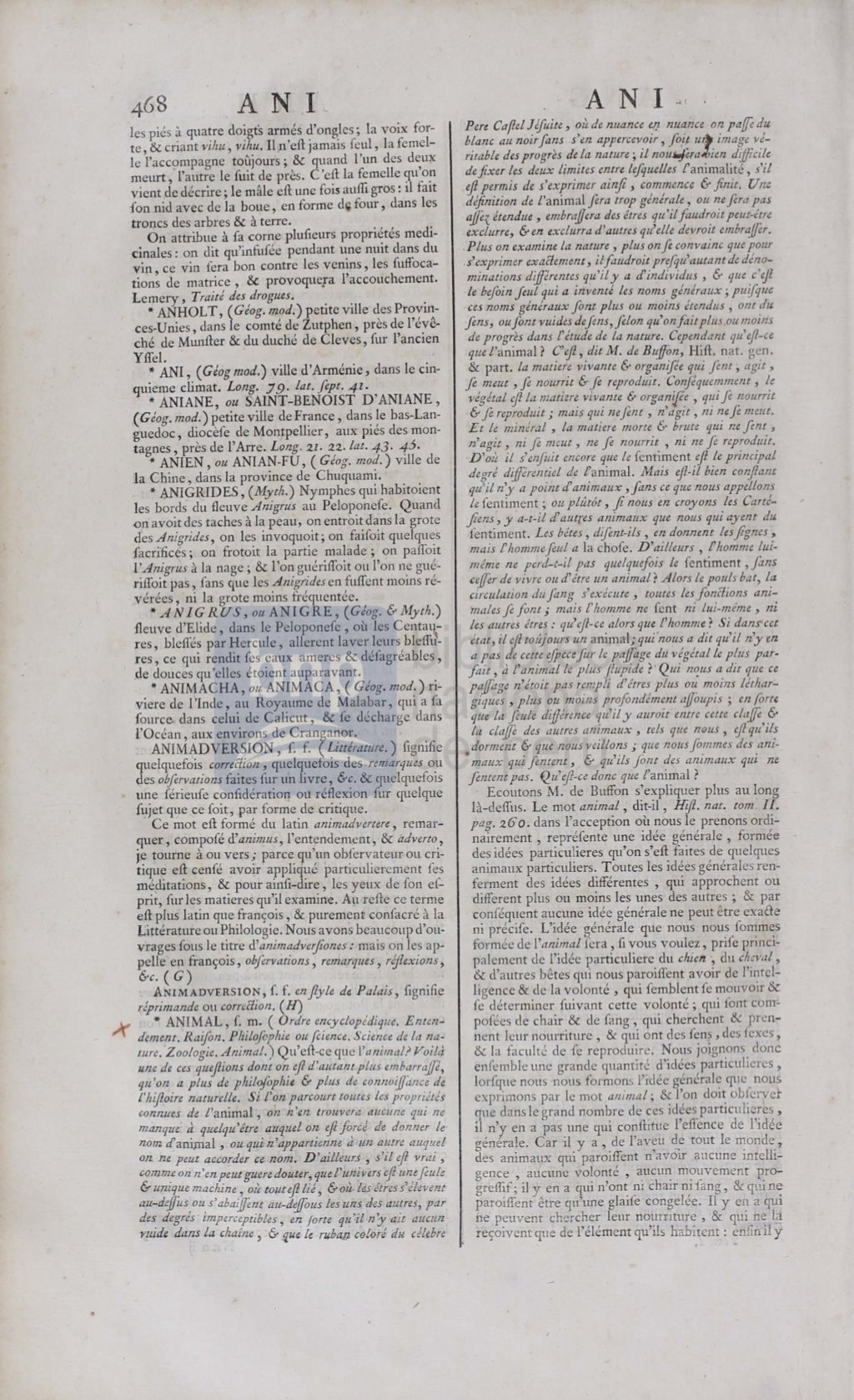
A N 1
les piés
a
quatre doigt's armés d'ongles; la voix for–
te,
&
criant
vill//., vihu.
II n'eíl: jamais feul, la femel–
le l'accompagne toujours;
&
quand I'un des deux
meurt, l'autre le fuit de preso C'eí1: la femelle
9
u'0.n
vient de décrire; le maJe eíl: une fois auffi gros: 1I falt
{on nid ave
e
de la boue, en forme
d~
four, dans les
troncs des arbres
&
aterre.
On attribue
a
fa come plufieurs propriétés medi–
cinales : on dit 'lu'inftúée pendant
u.nenuit dans du
vin, ce vin fera bon contre les venms , les fuffoca–
tions de matrice,
&
provoque.ral'accouchement.
Lemery,
Traité des drogues.
*
ANHOLT,
(Giog. mod.)
petite ville des Provin–
ces-Unies, dans le comté de Zutphen, pres de
l'év~
ché de Munfrer
&
du duché de Cleves,
[m
l'ancien
Yífel.
*
ANI,
(Giog mod.)
ville d'Arménie, dans le cin–
quieme climat.
Long.
:J
9·
lato Jept.
41.
*
ANIANE,
ou
SAINT-BENOIST D'ANIANE,
(Giog. mod.)
petite ville de France, dans le bas-Lan–
guedoc, dioce[e de Montpellier, aux piés des mon–
tagnes, pres de l'Arre.
Long.
2.1.
2.2..
lato
43·
43·
*
ANIEN ,
ou
ANIAN-FU, (
Géog. modo
)
ville de
la Chine, dans la province de Chuquami.
.. ANIGRIDES,
(MytIL.)
Nymphes qui habitoient
les bords du fleuve
Anigrus
au Peloponefe. Quand
on avolt des taches
11
la peau, on entroitdansla grote
des
Anigrides,
on les invoquoit; on faifoit quelques
facri·fices; on frotoít la partie malade; on pa/roit
I'Anigrus
a
la nage;
&
1'0n gllériífoit oul'on ne gué–
riífoit pas, fans que les
Anigrides
en fuífent moins ré–
vérées, ni la grote moins fréquentée.
..
A NIGRUS,
ouANIGRE,
(Géog.
&
Myth.)
fleuve d'Elide, dans le Peloponefe , oa les
Centa~res, bleífés par Hercule, allerent laver leurs bleífu–
res, ce qui rendit fes eaux ameres
&
défagréables,
de douces qtl'elles étoient auparavant.
.. ANIMACHA,
Olt
ANIMACA, (
Géog. mod.)
ri–
viere de
1
'lnde, au Royaume de Malabar, qui a fa
[ource. dans cehú de Calicut,
&
fe décharge dans
l'Océan, aux environs de Cran
9
anor.
ANIMADVERSION,
f.
f. \.
Littératllre.)
fignifie
qttelqtlefois
eomBion,
quelquefois des
remarques
ou
des
obfervations
faites fur un livre,
&e.
&
quelqttefois
une [érieufe conúdération ou réflexion fur qllelqtte
fujet qtle ce foit, par forme de criti(Jue.
Ce mot eíl: formé du latin
animadvertere,
remar–
quer, compo(é
d'animus,
l'entendemem,
&
adverto,
je tourne
a
ou vers; parce qu'un ob(ervatellr ou cri–
tique eíl: cenfé avoir applicfué particulierement fes
méditations,
&
pour ainú-dire, les yeux de fon e(–
prit, fur les matieres qu'il examine. Au reí1:e ce terme
eíl: plus latin que franc;:ois,
&
puremen1! confacré
11
la
Littérature ou Philologie. Nous avons beaucoup d'ou–
vrages fous le titre d'
animadve1iones:
mais on les ap–
pelle en franc;:ois,
obJervations, remarques, rijlexions,
&e. (G)
ANIMADVERSION,
f. f.
enjlyle
de
Palais,
úgnifie
réprimande
ou
eorreBion.
(lf)
"" *
ANIMAL,
r.
m. (
Ordre eneyclopédique. Enten–
demento Raifon. PhilrljOphie ou
fciene~.
Science de la na–
tllre. Zoologie. Animal.)
Qu'eíl:-ce que
I'animal? Voila
une de ces queJlions dont on eJl d'autant plus embarrajfi,
qu'on a plus de philofophie
&
plus
d~
eonlloifliulee de
i'ftijloire naturelle. Si
l'
on pareourt toutes les propri.!tés
connues de
l'animal,
Oll n'en troltvera aTLcune qui ne
manque
a
quelqu'erre auquelon eJl forcJ de donner le
nom
d'animal ,
ou qui n'appartienne a un alltre auquel
on !le peut accorder ce nomo D'ailleurs
,
s'il eJl vrai>
eomm..on n'enpelltgueredouler, que l'ullivers eJluneJeule
& unzque macftine,
Oli
touteJlliJ &ou les
étr~ss'éf¿vent
att-deJ!us,ou. s'abaiffint au-dej{ou; les uns des autres, par
de~ d~gres
tmperceptibüs, en forte qu'il n'y ait aueun
ywde dans la c/zaine)
&
'lue le rubao eolod du dlebre
A NI "
PeTe Caflel
J
ifuia, ou de nuanee
f{f
nuaflee on pa/Jc du
biane aU noirfans s'm appercevoir, foil ul)
imag~
,,¿–
rirable des progres de la nalltre; il nOlu.fera),ien dijJicile
de fixer les deu.'l: limites entre lifiluelles
l'animalité,
s'il
eJlpermis de s'exprimer ainfi, eommcnee
&
finito Um
déjinition de
l'animal
Jera trop générale, ou neflra pas
alfiz étendue
,
embraJlera des étres qu'iljaudroit peut-élre
exclurre, &e,. exclurra d'autres qu'elle devroit embralfir.
.
Plus on examine la nature
,
plus on
fo
eonvainc que pour
s'exprimer exaBement, ilfaudroit prifilu'autantdedéno–
minations difforentes qu'ilya d'individus,
&
que e'eJl
ü
befoin fiul 'fui a inventé les noms génlraux; puifque
ces noms généraux Jont plttS Olt moins étendus
,
om du
Jens, oufom vuides deJens, Jelon 'fu'onfoitplus.oullloins
d~
progres dans l'élltde de la nature. Cependam qu'eJl-ce
quel'animal?
C'eJl, dit M. de Buffon,
Hifr. nato gen.
&
parto
la maliere vivame
&
organifle qui Jent
,
agit>
l'
meut ,fe nourrie &1' reproduit. COlljllquemmeru,
le
1'egetal eJlla matier¿ vivan
te
6-
organifoe
,
quiJe Tlourrit
&Je reproduit; mais qui neJent
,
n'agit, ni nefe mento
El le minéral
,
la matiere morte
&
brure qui ne fint ,
n'agit, ni Je mcut, ne Je Tlourrit
,
ni
Tlf
Je r¿produit.
D'oa il s'enjiút eneore que
le
(entiment
eJlle principal
degré difforentiel de
l'animal.
Mais eJl-il bien conjlant
qu'iln'y a point d'animaux ,fans ce que nous appellons
le
(entiment;
Oll plutót
,
fi nous en croyons les Carté–
fiens,
y
a-t-il d'autres a/2imal/x que nOllS 'fui ayent du
fentiment.
Les bites, diJent-ils
,
en
donnent les¡gnes,
mais l'llOmmeflul a
la chofe.
D'ailleurs
,
l'ftomme lui–
lIléme ne perd-t-it pas quelquefois le
(entiment
,fans
eeffor de vivre ou d'üre un animal? Alors
le
pouls bal, la
circulatlon du fang s'execrae, touees les fonaions ani–
malesJe jont; mais l'Iwmme ne
fent
/2i lui-meme, ni
les autres e-'eres : qu'eJl-ee alors que l'homme? Si danseet
éttlt, il e(t toújours un
animal;
qui nOltS a dit 'fu'il n'yen
a pas
dt
eetce eJPecejitr
le
paJ!age dti v/gétalle plus par–
foit, aL'animal le plus jlupide? Qui
Il~US
a die que ce
paJ!age n'etolt pas rempli d'étres plus ou moins léthar–
giques, pütS ou moills profoTldement aJ!aupis
;
en
(orte
que la JeuLe différuzee 9u'ily auroil
~ntre
ceue clalfi &
la clalfi des
aulr~s
allimaux
,
tels qlU n{)ltS, eJlqtt'ils
•dorment
&
que nousveillons
;
que nOltSJommes des ani–
maux qlti Jentenl,
&
qlt'ils Jont des animal/x qui
TU
Jententpaso Qu'eJl-ee done que
l'animal
?
Ecoutons M. de Buffon s'expliquer plus aulong
Ia-deífus. Le mot
animal,
dit-il,
H.(t. nato tom
Il.
pago
2.60.
dans l'acception oa nous fe prenons ordi–
nairement , repréfente une idée générale, formée
des idées particulieres '1u'on s'eíl: faires de quelques
animaux particuliers. Toutes les idées générales ren–
ferment des idées différentes , qui approchent 01.1
different plus Ol! moins les unes des autres ;
&
par
con(équent aUClme idée générale ne peut
~tre
exaéle
ni
préci(e. L'idée générale que nous nous fommes
formée de l'
animal
lera, ú vous
voulez,
prife princi–
palement de I'idée particuliere du
ehien
,
du
eheval,
&
d'autres
b~tes
qui nous paroiifent avoir de l'intel–
ligence
&
de la volonré , qui femblent fe mouvoir
&
fe déterminer fuivant cetre volonté; 'lui
iont
com"
po(ées de chair
&
de (ang ,
qui
cherchent
&
pren–
nent leur noulTiture ,
&
qui ont des fens, des {excs,
&
la faculté de (e reprodllire. Nous joignoos donc
en/emble une grande qtlanrité d'idées particulieres ,
lor(que nous nous forrnons l'idée générale qtle nous
explimons par le mot
animal;
&
]'on doit ob(erver
qtle dansle grand nombre de ces idées particulieres
>
il
n'y
en a pas une qui confuwe l'eifence de l'idée
génerale. Car il ya, de l'aveu de tout le monde,
des animaux qui paroiífent n'avorr aucune intclli–
gence , aucune volonté , aucun mOllvemenr pro–
greffif;
il
Y
en a qui n'ont ni chair ni {ang,
&
q!!i ne
paroiífent
~tre
qu'une glaife congelée. Il y en a qui
ne pellvenr chercher lem nournnlre ,
&
qtli ne la
rec;:oiventque de I'élémentqu'ils habitcnt: cnfiníly
















