
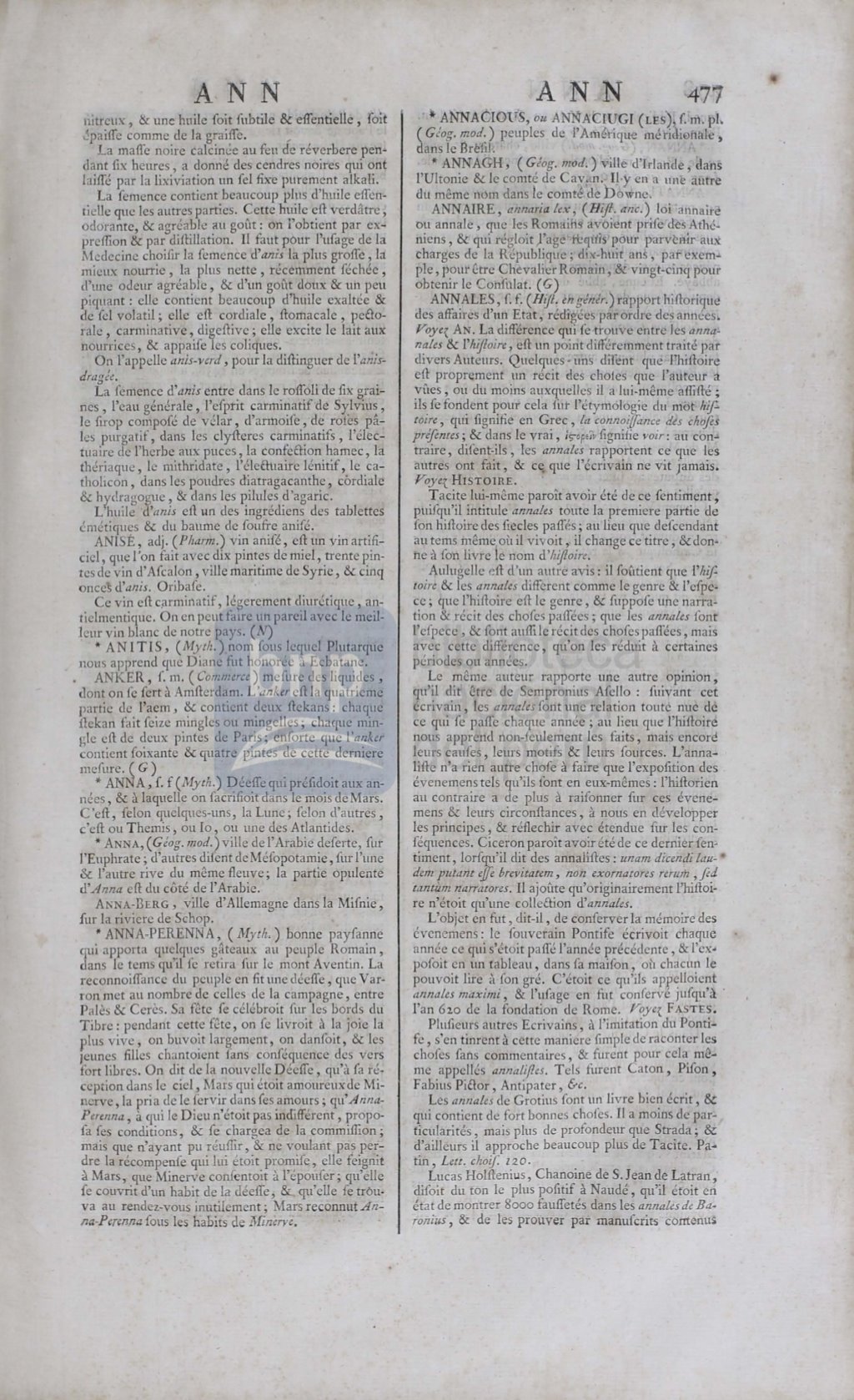
ANN
nitrellx,
&
une Imile foit fubtile
&
eíTentielle, rOlt
.'paiíTe comme de la graiíTe.
La maíTe noire ca1cinée au feu de réverbere pen–
dant fix hemes, a donné des cendres noires qui ont
laiíTé par la lixiviation un fel fixe purement alkali.
La femence contient beaucoup plus d'huile eifen–
tielle que les autres parties. Cette htúle efr verdatre,
odorante, & agréable au goút: on ¡'obtient par ex–
preffion
&
par eliftillation. Il fuut póur I'ufage de la
l\lcdecine choifir la femence d'
tUlis
la plus groíTe, la
miellx nourrie, la plus nette, récemment féchée,
e1'une odellr agréable,
&
d'un goút doux
&
un peu
piC¡lIant : elle contient beaucoup d'huile exaltée
&
de fel volatil; elle efr coreliale, fromacale , peao–
rale, carminative, digefrive ; elle excite le lait aux
nourrices, & appaife l s coliques.
On l'appelle
anís-verd ,
pom la difringuer de
I'anís–
drag¿e.
La fcmence d'
anis
entre dans le rofroli de fix grai–
nes, I'cau générale, I'efprit carminatif de Sylvius ,
le fuop compofé de vélar, d'armoife, de roles pá–
k~
purgatif, dans les clyfreres carminatifs, l'élec–
tuaire de I'herbe aux puces, la confeaion hamec, la
thériaque, le mithridate, l'élcauaire lérútif, le ca–
thohcon, dans les poudres diatragacanthe, c{¡rdiale
& hy,dragogue,
&
dans les pilules d'agaric.
L huile
d'anis
eíl un des ingréeliens des tablettes
émétiques
&
du baume de fourre anifé.
ANL
É,
adj.
(Pharm.)
vin arufé, efrun vinartifi–
ciel, que I'on fait avec elix pintes de miel, trente pin–
tesdevin d'Afcalon,
ville
maritime de Syrie, & cinq
onces
d'anís.
Oribafe.
Ce vin efl: c.arminatif, légerement dimétique, an–
tielmentiquc. On en pellt faire un pareil avec le mcil–
lcur vin blanc de notre pays.
(N)
*
AN 1TIS,
(Myth.)
nom fous leque! Plutarque
JlOUS
apprend que Diane hit honorée
a
Ecbatane.
ANKER,
f.
m.
e
Commerce
)
mefllre des liquides ,
c10nt on fe fel t
a
Amíl:erdam.
L'ankereíl:
la quatrieme
partie de l'aem, & contient deux frekans: chaque
frekan fait feize mingles ou rningelles; chaque min–
gle eíl: de deux pintes de Paris; enlorte que
I'anker
conticnt (oixante & quatre pintes de cette derniere
mefure.
(G)
• ANÑA,
f.
feMyth.)
D éefrequi préfidoit aux an–
nécs , &
a
laquelle on facrilioit dans le mois de Mars.
C'cfl:, felon quclques-uns, la Lune; felon d'autres,
c'eíl: ou Themis, ou
[o,
ou une des Atlantides.
*
ANNA,
eG¿og.mod.) ville
de l'Arabie deferte, fuI'
I'Euphrate ; d'autres difent deMéfopotaI1Úe, fm I'une
&
l'autre rive du meme fleuve; la partie oplúente
d'Anna
eíl: du coté de l'Arabie.
Al\NA-BERG, ville d'Allemagne dans la Mifnie,
fur la rivicre de Schop.
• ANNA-PERENNA,
e
Myth.)
bonne payfanne
qui apporta quelques gateaux au peuple Romain,
dans le tems qu'il
fe
retira fur le mont Aventin. La
reconnoifrance du pcuple en lit une déefre, que Var–
ron met au nombre de celles de la campagne, entre
Pales & Ceres. Sa
~te
fe célébroit ftu les bords du
Tibre: pendant cette fete, on fe livroit
a
la joie la
plus vive,
011
buvoit largement, on daníoit, & les
¡eunes filIes chantoient fans confé9uence des vers
fort libres. On dit de la nouvelle Deefre, qu'a fa ré–
ception dans le ciel, Mars qui étoit amoureuxde Mi–
nerve, la pria de le (ervir dans (es amours;
qll'Anna–
PtreTlna,
a
<fui le Dieu n'étoit pas indifférent , propo–
fa (es conelitions, & fe chargea de la commiffion;
mais que n'ayant pu réuffir,
&
ne voulant pas per–
dre la récompenfe qui luí étoit promife, elle feignit
a
Mars, que Minerve con[entoit
a
l'époufer; qu'elle
fe couvnt d'un habit de la d eífe,
&..
qu'elle fe trcu–
va au rendez-vous inutilem nt; Mars reconnut
An–
na-Pmnna
fous les habits de
Mínerye.
ANN
477
l
ANNACIOFS,
o,.
ANNACIUGI
(LEs),
f.
ni.
pI.
e
GJog. mod.)
peuples de
l'
Amé¡'ique mé ricliElMle ,
dans le Bréfil.
.. ANNAGH,
e
G¿og. mod.)
ville d'Irlande dans
I'Ultonie & le comré de
Cav~ú1.-
1!.)'
en aune'autre
ilu meme nom dans le comté de bowne.
ANNAlRE,
annaría lex,
e
HijA
ane.)
loi annaire
ou annale, que les Romaihs avoienr prife des Athé–
rúens, & qui régloit )'age
Ibpt1s'
pour parvbHI' au;
charges de la Républiqlle; dix-h\Iit ans, par exem–
pIe, pour etre ChevalierRomain,
&
vingt-einq pour
obterur le Confnlat.
(G)
ANNALES,
f.
f.
e
Hijl. tng¿n.!r.)
rapport hiíl:ori9ue
des alfaires d'nn Etat, rédigées par ordre des annees.
Voye{
AN. La dilférence qui fe trollve entre les
anna–
nales
&
1'luJioíre,
efl: un point diftéremment traité par
elivers Auteurs. Que
!9u.es- uns elirent que rhifl:oire
efl: proprement un reclt des choles que l auteur a
:vi'tes, ou du moins auxquelles il a lui-meme affiité ;
lIsfe
fon~ent
rour>cela íilt
l'étymólo~e
du mot
Izif.~
lOlre,
'1m figmfie en Grec,
La cOllnoiJIance
MS
chofis
prifences;
& dans le vrai,
i,op"v
fignifie
yo;r:
au con'"
traire, difent-ils, les
annaLes
rapportent ce que les
autres ont fait,
&
c~
que l'écrivain ne vit jamáis.
Voyt{
HISTOIRE.
Tacite lui-meme paro!t avoir été de ce fentiment,
puifqu'il intitule
annales
toute la prelrúere partie de
ron hiíl:oire des fiecles pallp.s ; aulieu que defcendant
au tems meme 011il vivoit , il change ce titre, &don–
ne
a
ion livre le nom d'
hijloíre.
Aulugelle efr d'un autre avis: il fOlltient que
l'llif
coíre
&
les
annaLcs
different comme le genre
&
l'cfpe–
ce; que I'hiftoire efr le genre, & fuppofe une narra–
tion
&
récit des chofes pafrées ; que les
ann,ales
font
I'e{pece, & font auffile récitdes chofes pafrées, mais
avec certe dilférence , qu'on les réduit
a
certaines
périodes on années.
Le mSme auteur rapporte une autre opirúon,
qu'iI dir etre de Semproruus Afelio: fuivanr cet
écrivain, les
annales
font une relation toute nuc de
ce qui fe pafre chaque année ; au lieu que l'hiftoire
nous apprend non-{elúement les fuits, mais encoré
leurs cau(es, leurs motifs
&
leurs fources. L'anna–
lifte n'a rien autre chofe
a
faire que l'expofition des
évenemens tels qu'ils lont en eux-memes : l'hifrorien
au contraire a de plus
a
raifonner fur ces évene–
mens & lelU's circonfrances,
a
nous en développer
les principes,
&
réflechir avec étendue
fi.lrles con–
féqucnces. Ciceron parolt avoir été de ce dernier{en–
timcnt,
10rf~l'il
elit des annalifres :
unam diandi Lau–
dem
plttltnt
eJJe brevitaum, non exornatores rerUlIz ,fld
t.zntUm narratores.
II ajoíhe qu'originairement l'hiftoi–
re n'étoit qu'une colleilion
d'annales.
L'objet en fut, dit-il, de conferver la mémoire des
évenemens: le fouverain Pontife écrivoie chaque
année ce qui s'étoit pafré l'année précédente,
&
I'ex–
pofoit en un tableau, dans fa maifon, 011 chacnn le
pouvoit lire
a
fon gré. C'étoit ce qu'ils appelloient
annales maxímí,
&
I'ufage en hit con(ervé jufqu'a .
l'an 620 de la fondation de Rome.
Voye{
FASTES.
Plufieurs autres Ecrivains,
a
¡'imitation du Ponti–
fe, s'en tinrent
a
cetre maniere fimple de raconter les
cho(es fans commentaires,
&
furent pOlU' cela me–
me appellés
annalijles.
Tels hlIent Caton, Pifon,
Fabius Piaor, Antipater,
&c.
Les
anTlaLts
de Grotius (ont un livre bien écrit,
&
qui contient de fort honnes chofes. Il a moins de par–
ticlllarités, mais plus de profondeur que Strada; &
d'ailleurs il approche beaucoup plus de Tacite.
Pa~
tin,
Leu.
choif.
l20.
Lucas Holftenius, Chanoine de S.
J
ean de Latran,
Moit du ton le plus pofitif
a
Naudé, qu'il étoit en
état de montrer 8000 faulfetés dans les
annaüs de
Ba–
ronius )
&
de les prouver par manufcrirs c;orrtenuS
















