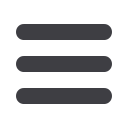
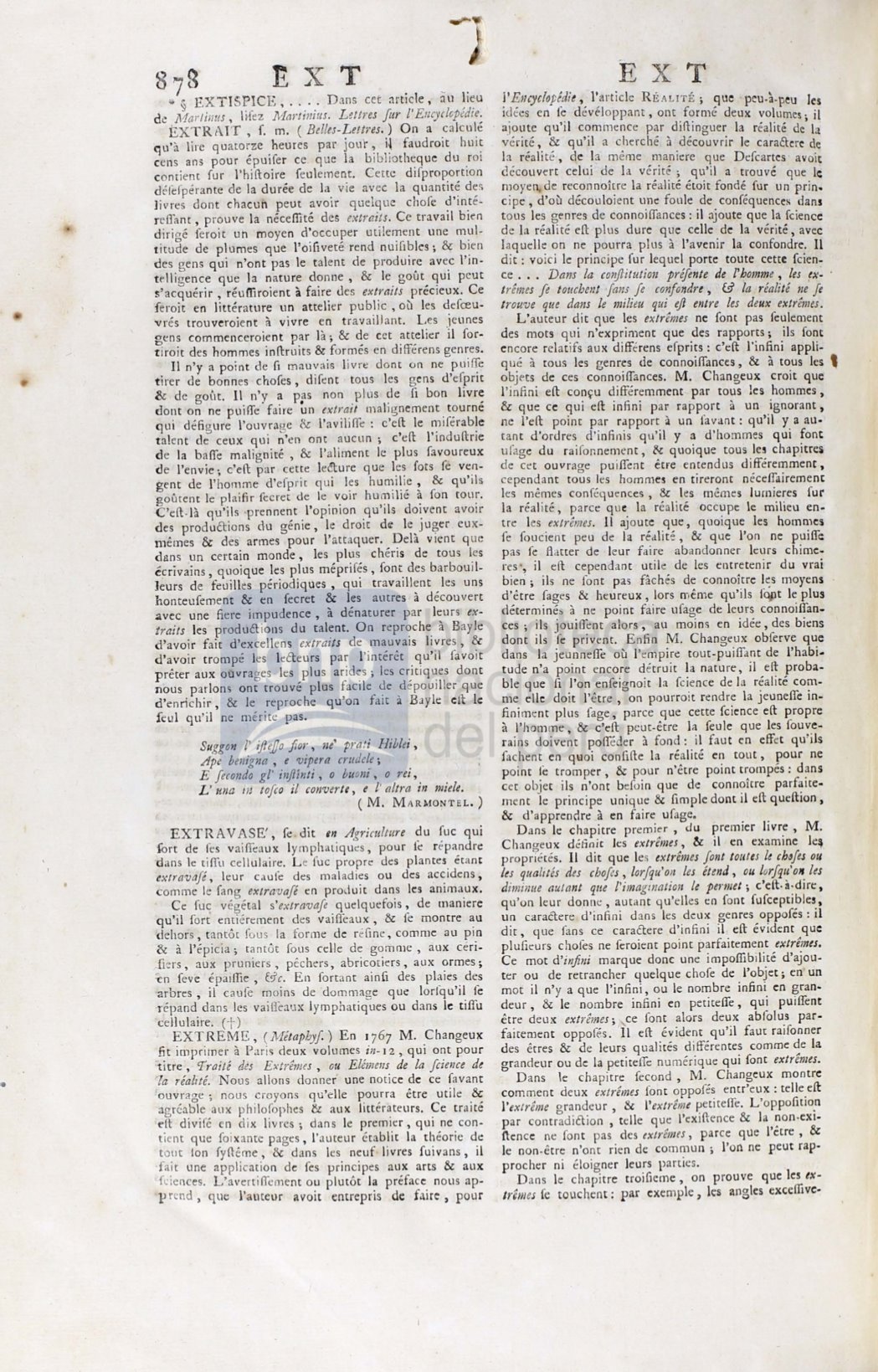
8 78
I!
X T
.
_ .
" §
EXTI
SPICE, . . .. Dans cet article , au lieu
de
/11arti1ms ,
li·fi:z
/lllar1i11iris. Lmres fur l'E11cyclapMie.
EXTRAIT ,
f. m. (
Bel!es-Lettres. )
On a calcule
q u'a lire quatorze heures par jour,
i~
faudroit huit
cens an; pour epuifer ce. q ue la bibliotheq ue du roi
conrient fur
l'hill:oire feulement. Cette difproportion
dffe(perante de la duree de la vie avec la quantite des
Jivres dont chacun peut avoir quelque chafe d'inte–
reffant, prouve la neceffite des
extraits.
Cc travail bien
dirige feroi t uh moyen d'occuper utilement une mul–
titude de phimes que l'oilivete rend nuif1bks;
&
bien
des gens q ui n'ont pas le talent de produire avec l'in–
trlligence q ue la nature donne ,
&
le gout qui peut
s'acquerir , reuOiroient
a
faire Jes
extraits
precieux. Ce
feroit en litterarnre un attelier public , ou les defceu–
vres trou veroient
a
vivre en
travailJant. L es jeunes
gens commenceroient par la;
&
de cct attelier ii for–
t iroit des hommes infhuits
&
formes en di!ferens genres.
II n'y a point de fi mauvais livre dont on ne- puilfe
tirer de bonnes chafes, difcnt
taus Jes gens d'efprit
&
de gout. 11 n'y a pas non plus de
fi bon
livre
dont on ne puiffe faire
~ n
cxtrait
malignement tourne
qui defigure l'ouvrage
&
l'aviliffr: c'efl: le miferable
talent de ceux qui n'en ont aucun ; c'efl:
l'indufl:rie
de la balfe malignice ,
&
!'aliment le plus favoureux
de l'envie; c'efl: par cette leeture que les fats fe ven–
gent de l'homme d'efprit qui
les humi lie ,
&
qu'ils
goutent le plaifir fecret de le voir humilie a fon tour.
C'e!l:- la qu'ils ·prennent !'opinion qu'ils doivent avoir
des produCl:ions du genie , le droit
d~
le juger eux–
memes
&
des armes pour l'attaquer. Dela vient q ue
duns un certain monde, Jes plus cheris de taus les
e~rivains,
quoique les plus meprifes '
font
des barbouil–
leurs de feui lles periodiques , qui
travaillent
les uns
honteufement
&
en
fecret
&
les
amres
a
decouvert
<lVeC une fiere impudence ,
a
denaturer par
leurs
ex–
traits
les produCl:ions du talent. On reproche
a
Bayle
d'avoir fait d'excellens
extraits
de mauvais livres ,
&
d'avoir trompe ks leCl:eurs par
l'intfo~t
qu'il
favoit
preter aux ouvrages les plus arides ; les critiques dont
nous parlons Ont trouve plus facile de depouiller que
d'enrichir ,
&
le
reproche q u'on fait
a
Bayle cit
le
feul qu'il ne merite pas.
Suggon l' iflej}o jior , ne' prati Hiblei ,
Ape
bmigna
,
e vipera crudele;
E
Jecondo gl' inflinti
,
o buoni
,
o rei ,
L '
ttna in
tofto il convertr, e
t·
altra in miele.
( M . M ARMONTE L. )
EXTRAV
ASE' , fe dit
tn
//griwlture
du foe qui
fort
de fes vailfeaux lymphatiques, pour
fr
repandrc:
dans le tilfu cellulaire. L e fuc propre des plantes etant
extravafi ,
leur caufe des maladies ou des accidens ,
cornme le fang
extravafe
en produit clans k s animaux.
Ce
fu~
vegetal
s'extravafe
qudquefois , de maniere
qu'il fort entierement des vailfeaux,
&
fe montre au
clehors , tantot fous la forme de refi ne , cornme au pin
&
a
l'epicia ; rant6t fous cdle de gornme ' aux ceri–
.ilers, aux prnniers , pechers , abricotiers , aux orrnes ;
-en feve epa1ffie ,
f.<Jc.
En fortant ainli des plaies des
arbrcs, ii caufe rnoins de dommagc que
lorlqu'il fe
rcpand clans les vailfea>JX lymphatiques
OU
dJOS le tiJTu
cellulaire.
Ci-)
EXTREME,
(Mitapbyf.)
En 1767 M. Changeux
fit imprimer
a
P.1ris cleux volumes
in-
12, qui ont pour
titre,
'l'raiti des Extremes, ou Elimms de la ftirnce de
'la
rialtte.
Nous allons donner' une notice de ce favant
ouvrage ; nous croyons qu'elle pourra etre utile
&
agreable aux philofophes
&
aux litterateurs. Ce rrai ce
efl: divifc en dix livres ; clans le premier, qui ne con–
tient que foixante pages ' !'auteur crablit la thforie de
tout Ion fyfleme ,
&
clans
les neuf livres fuivans, il
fa!t
une application de fes principes aux arts
&
aux
fr:ences. L 'avertilfement ou plutot la preface nous ap–
p rcnd , que l'ameur avoit entrepris de faire , pour
EXT
l'E11cyc!npfdie,
!'article
R EALITE ;
que pcu-a-peu
Jes
idecs en
fe
developpant , ont forme deux volumes. il
· ajoute qu'il commence par diflinauer la realite de' la
verite'
&
q u'il a cherche
a
deca°uvrir le caraC\:ere de
la realite , de la merne maniere que Defcartes avoit
decouvert celui de la vcrite ; qu'il a
trouve que le
moyen.dereconnoitre la realite etoit fonde fur un prin.
cipe, d'ou decouloient une fonle de confequences dans
taus les genres de connoiffances: ii ajoute que la fcience
de la realite ell: plus dure que celle de la verite ' avec
laquelle on ne pourra plns a l'avenir la confondre.
IL
dit : voici
le
principe fur leq uel porte toute cettc fcien–
ce . ..
Dain la conjlitutio11 prifente de I'homme , !es
e~·-
·
tremes
fe
touchent fans
fe
confondre
,
&
la realite ne'
fa
trouve q11e dans le milieu qui
ejJ
en/re les deux extremes.
L'auteur dit que les
extremes
ne font pas feulement
des mots qui n'expriment que des rapports ;
ils font
encore relatifs aux differens efprits : c'efl:
l'infini appli–
que
a
taus les genres de connoilfances '
&
a
tous les '
objets de ces connoilfances. M. Changeux croit quc
l'infini ell:
con~u
differemment par tous les hommes,
&
q ue ce qui ell:
infini par rapport
a
un ignorant,
ne l'efl: point par rapport
a
un favan t : qu'il
y
a au.
tant d'ordres d'infinis qu'il
y
a d'hommes qui font
ufage du rai(onnement ,
&
quoique tous les chapitre:i
de Cct ouvrage puilfent Ctre entendt1s differemrnenc,
cependant tous Jes hommes en tireront necelfairement
Its memes conftquences,
&
les mcrnes lumieres
fur
la realite, parce que la realite occupe
le
milieu en–
tre
les
extremes.
II ajoute q ue, quoique Jes hommes
fe
foucient peu de la realite ' & que l'on ne puilfc
pas fe
flatter de leur faire abandonner leurs chime.
res', il efl: cependant utile de les entreteni r d u vrai
bieri ; ils ne fon t pas fiiches de connoitre
l~s
moyens
d'etre fages
&
heureux ' !ors meme qu'ils fopt
le
plus
determines
a
ne point faire ufage de Jeurs connoilfan–
ces ; ils jouifll-:nt alors, au moi ns en idee , des bicns
dont ils
fe
privenr. Enfin M. Changeux obferve que
clans
la jeunnelfe ou !'empire tout-puilfant de l'habi–
tude n'a point encore detruit la nature , il ell: proba–
ble q ue fi
l'on enfeignoit la fcience de la realite com-
me elle doit l'etre , on pourroit rendre la jeuaelfe in–
finiment plus fage , parce q ue cette fcience efl: propre
a
l'homme
>
&
c'ell: pcut-erre la feule q ue les fouve–
rains doivcnt polfeder
a
fond: il fau t
en
effct qu'ils
fachent en quoi conlill:e la realite en rout, pour ne
point
le
tramper , & pour n'erre point trompes: clans
cet objet ils n'ont befoin q ue de connoitre parfaite–
ment le principe unique& fimpledont il ell: quell:ion,
&
d'apprendre
a
en fai re ufage.
Dans
le
chapitre premier , du premier livre , M .
Changeux dcfinic Jes
extremes ,
&
ii en examine
le~
proprietes. 11 dit que les
extremes font to/lies le chofes ou
/es qualites des chofes , lorfqu'on !es itend, ou lorfq11'011 les
diminue au/ant que l'imagrnation le pen11et;
c'efl:.a-dire'
q u'on leur donne , autant qu'elles en font fufceptibles,
un caraCl:ere d'infini dans les deux genres oppofes : ii
<lit, que fans ce caraCl:ere d'infini ii ell: evidenr que
plufieurs chafes ne feroient point parfaitement
extremes.
Ce mot
d'i11ji11i
marque done une impoffib1lite d'ajou–
ter ou de retrancher q uelque chofe de l'objct; en un
mot ii n'y a que l'infini , ou le nombre infini en gran·
deur ,
&
le nombre infini en petitelfe , qui puilfent
etre deux
extremes ;
ce font alors deux abfolus par–
faitement oppofes .
11
ell: evident q u'il fam raifonner
des erres
&
de leurs qual ites differences comme de la
grandeur ou de la petitelfe numerique qui font
extremes.
D ans
le chapitre
fecond , M . Changeux montre
comment deux
extremes
fon t oppofes entr'eux : telle ell:
!'extreme
grandeur,
&
!'extreme
pecitelfe. L 'oppofitio.n
p ar contradiccion , telle quc l'exi!l:ence
&
la non-ex1-
Ctence ne fon t pas des
extremes,
parce que l'etre ,
&
le non.fare n'ont rien de commun ; !'on ne peut rap–
procher ni eloianer Jeurs parties.
D ans
le
chaP\tre troifieme, on prouve que Jes
ex–
tremes
fe touchent : par exemple, k s angles exceffive-
















