
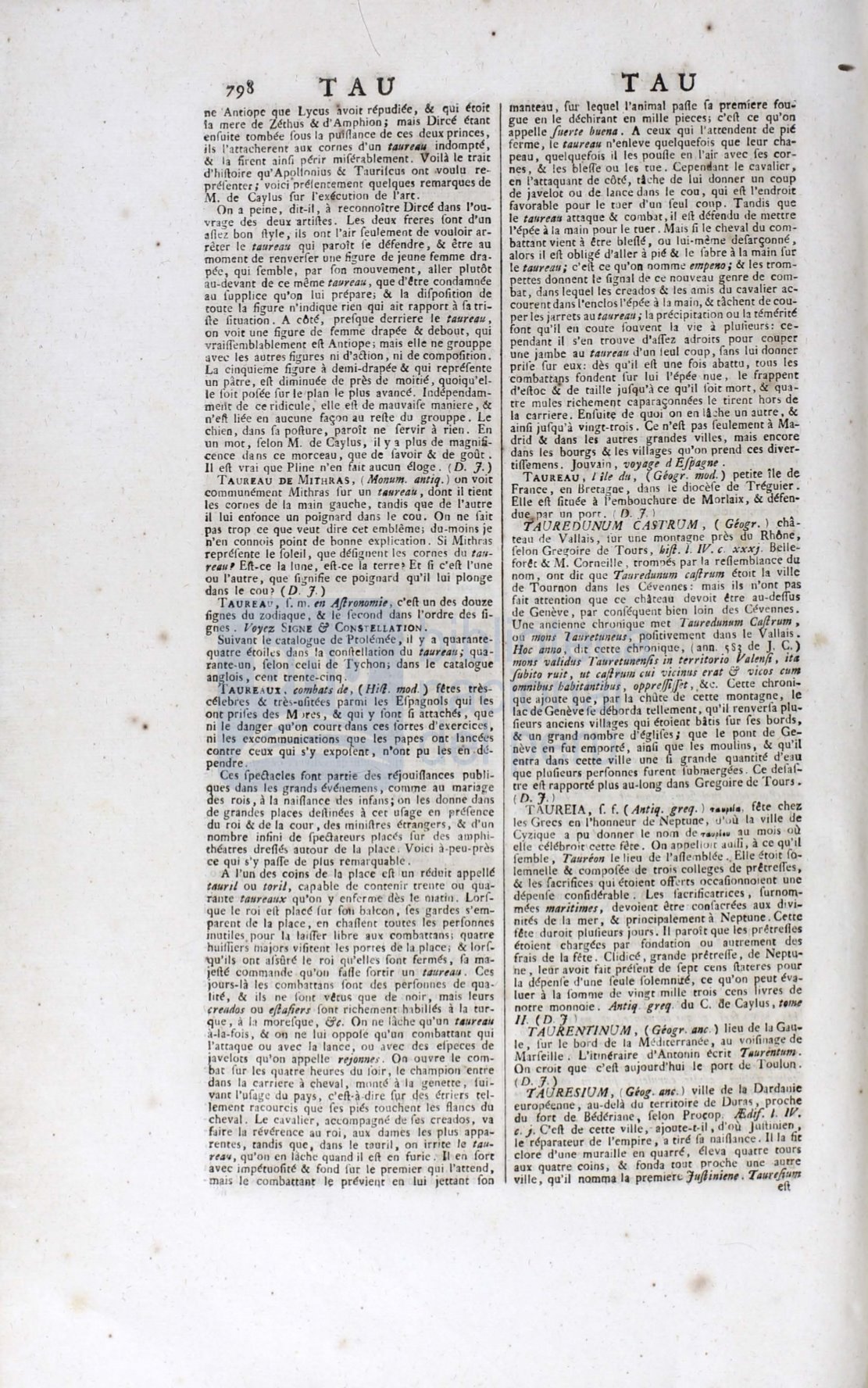
TAU
ne 'Anriopc que Lycus l!voir répudit'e,
&
qui écoit
la
mere de Zérhus
&
d'Amphion; mais Dircé écant
enfuice tombée
(ous
la pu!Oance de
ces
deux princes,
ils l'acracherent aux cornes d'un
tau"""
indompté,
& la ñrenr ainfi périr mi(érablemenc.
V'oil~
le traic
d'hifloire qu' Appltnnius
&
Taurilcus ont
.voul~
re–
préfenter; voici préfememenr quelques remarques de
M.
de Caylus fur l'ex6curion de l'art.
On a peine, dit-il,
a
reconnoitre Dircé dans l'ou–
vrage
des
deu~
-arrifles. Les
deu~
freres fonr d'un
3ílez bon
ílyle,
ils onr l'air feulemen t
de
vouloir ar–
rerer le
tallr~au
qui parolr fe défendre,
&
erre au
rnomenr de renverfer une figure de jeune femme dra–
péc,
qui femble, par fon mouvement, aller plurot
au-devant de ce meme
taureatt.
que
d'~tre
condamnée
au fuppl ice qu'o11
luí prépare;
&
la difpotition de
tou¡e la figure n'indique ríen qui ait rapport
a
fa tri–
fie
firuation. A cOté, prefque derriere le
taurtau,
on voit une figure de femme drapée
&
debour, qui
vraiíli!mblablement eíl Antiope ; mais elle ne grouppe
avec les autres figures ni d'aélion, ni de compotition.
La cinquieme fig ure
a
demi-drapée
&
qui repréfente
un parre, efl diminuée de pres
d~
moitié, quoiqu'el–
le toir pofée (ur le plan le plus avancé. l ndépendam–
m eJit de ce ridicule, elle efl de mauvaife maniere,
&
n'~ll
liée en aucune
fa~IJn
a
u refle du
gr~>Uppe,
Le
chteo, dans fa poílure, parolt ne fervir a ríen . En
un mor, felon
M.
de Caylus, il y
a
plus de magnili–
cence da ns ce morceau, que de favoir
&
de goílt.
11
etl vrai que Pline n'en fait aucun éloge .
( D.
J.)
TAUni!:AU
DE
~ITHII~S,
( Monullf. antiq.)
un voir
communément M tthras {or un
t/IH/'eat•,
done il tiene
!es c.orne.s de la mlin gauche, randis que de l'autre
11
IUI
entonce un poignard dan; le cou. On ne fa ir
pa$ trop ce que veut uire cc:t embleme; du-moins je
~·en
connois point de honne expl ication . Si M irhras
repréfenre le foleil, que Mtignent les cornes du
tatr–
r~lluf
El!-ce la tune, efl -ce la terrel Er
fi
c'efl l'une
ou l'autre, que lignifie ce poignard qu'il luí plonge
daos le cou?
(D .
J.)
TAUREAl1 , f. m.
m
.Ajlronomi~ ,
c'efl un des douze
ligues do zodiaqoe,
&
le fecond daos l'ordre des
ti–
gnes.
Voycz
SJGN!:
&
CoNST!:LLATION.
Suivant le catalog ue de 1'rolémée , il y a quaranre–
quarre éroiles daos la conflellarion du
tauru11;
qua–
rante-un, feloo eel ui de Tychon; daos le catalogue
aoglois , cenr trenre-cinq .
TAUHAUI .
combats
d~.
(
Hi!l. mod. )
f~res
rres–
célebr~~
&
tres-otitées parmi le_s Efpagnols qui les
o~r
prtfes des M Jres,
&
qui
y
lonr
ti
acuchés, qu e
n~
le danger qu'on courr dans ces forres d'exercices ,
nt
les excommunicarions que les papes onr lancées
centre ceux qui
s'y
expofenc, n'onr pu les e'n .dé-
pendre .
·
Ces fpeélacles fonc parti'é des réjouitlances publi–
ques dans les grands évt'nemens , comme au mariaae
des rois,
a
la naiflance des infans ; on les donne
da~tS
de
gr~ndes
places deilinées
a
cer ufage en
~réfence
du rot
&
de
1~
cour, des miniflres étrangcrs,
&
d'un
nombre mfint de fpeéhceurs pl:1cés fur des amphi–
théacres dret!és aurour de la
pla~e .
Voici a·peu- pres
ce qui s'y pa{fe de plus remarquable.
A
l'un des .coins de la place en un réduir appellé
tllunl
ou
tortl,
capable de conrenir trente ou qua–
rante
taur~artx
qu'on y enferme des le macin. Lorf–
que le roí eíl placé for fo11
b~ lcon ,
fes gardes s'em–
par~nt
de
la place , en chaílenr routes les perfonnes
muttles, rour IJ lattfer libre aox combattans; quaere
huiffiers hla jors vititeut les porres de la rloce;
&
lorf–
~u'ils
onc atruré le roí qu'elles fonr fermés, fa ma–
¡eflé
c~mmancle
qu'ou fatie fo rrir un
tartrtall .
Ces
¡ours-la les comhattans fonr des perfou nes de qua–
lité ,
&
tls ne tonr
v~rus
que de noir, mais leurs
fTttldOs
OU
dlafierr
font richemeor h1biJJés a Ja tur–
!Jlie, :\ la morefque,
&c.
On ne lache qu'un
t/1/lrtall
a-la-fois,
&
on ne luí oppole qu'un combattanr qui
!'atraque ou avec la lance , ou
~\lec
des ef'peccs de
¡avelors qu'on appelle
rejom1u .
On ouvre le com–
bar fu r
les
qoatre heures du 10ír , le champion entre
dans la carriere a cheval, mnnté
a
lo generre. fui–
yanr l'ufage du pays , c'efl·a .dire fpr <fes érriers rel–
lement racourcis
qu~
fes plés rouchenr les flanes du
cheval . Le CJVJiier,
ac~ompagné
de (ds creados , va
fatre la révé:encc au roí, aux domes les plus appa–
rentes, tandts que, daos le raoril, on irrite le
tau–
ua~,
qu'on en lache quand il
efl
en
fu
ríe . 11 en forr
avec impéruotiré
&
fond fur le premier qui l'atrend,
maiS le combattanr
le prévieqc en luí
jetrant foo
TAU
Jnanttau ,
fw-
lequel .l'animal pat!e fa premítre
fou~
gue en le déchirant en mille pieces; c'efl ce qu'on
appelle
fittrtt buena.
A
ceux qui l'attendenr de pil!
fcrme, le
taureau
n'ehleve quelqoefois que leur cha–
pea u,
quelqu~fois
il les pouíle en l'air avec fes cor–
n~s ,
&
les bletl'e ou les rue.
Cepen~~nr
le cavalier,
en
l'atraquanr de d\té, rlche de luí donner un coup
de javelot ou de IJnce daos le cou, qui e{l l'endroit
favorable pour le roer <l' un feul conp . T andis que
le
taur~11u
atraque
&
combar, il efl défendu de meme
l'épée
a
la main pour le ruer . Mais
ti
le cheval do com–
batrant viene
a
Etre bletlé, ou lui-m2me defan:¡onné,
alors il efl obligé d'aller
a
piá
&
le fabre
a
la main for
le
taur~ar1;
c'ett ce qu'on oomme
~mp~no;
&
les trom–
petees donnent le úgnal
d~
ce nouveau genre de com–
bar, daos lequelles creados
&
les
nmis du cavalier ac–
courentdans l'enclos l'épée
a
la main,
&
rachene de cou–
per les jarrers au
ta11r~a11;
la précipirarion ou la cémérirl!
font qu'il en coute (ouvent la vic
a
plutieurs: ce–
pendanr il s'en rroove d'atfcz adroirs pour couper
une jambe au
taureatl
J'un leul coup, fans luí clonner
prile íur eux :
d~s
qo'il efl une fois abattu, rons les
combatt'Ws fondent titr luí l'épée nue ,
le frappent
d'ef\oc
&
de taille jufqu';\ ce qu'il loit morr ,
&
qua–
tre mules richemer¡r
capara~onnées
le tirenr horo de
la carrierc . En
luir~
de quui on en li : he un
a
uere,
&
ainti jufqu'ii vingr-rrois. Ce n'efl pas feulement
a
Ma–
drid
&
dans les aurres grandes villes, mais encore
dans les
bourg~
&
les vilfages
qu'oo prend ces diver–
titfi!mens . Jouvain,
voyag~
d
E.fi!agn~.
TAUREAU,
1
~~~
d1 ,
(
Góogr. mod. )
petite ile de
France, en Breragoe, daos le dioceíe de Tréguier .
Elle en ticuée
~
l'embouchure de M nrlaix,
&
d~fen
due par un porr. (
O.
't
l
TAUREDUNUM CASTIWM,
(
Gtogr. )
cha–
tean
d~
Yallais, fur une monragne pres du Rhóne,
felon G re¡¡-oire de Tours ,
Ñijl. }.
IV.&. xxxj.
B;:lle–
for~r
&
M . Corneille , rrom'lés par la reílemblance du
nom, onr dir que
Tauredunum cajlriJin
étott la ville
de Tournon daos les Cévennes : mais ils n'ont pas
fait atrention que ce chheau dcvoir
~tre
ao-detfus
de Geneve, par conféquent bien loin des Cévennes.
Une ancienne chrunique mer
Tattredrmum Ca/lrum
•
ou
mous
1
aurttrmeru,
potirivemenr dans le Vallais.
Hoc amlo,
d1t cctre chronique, ( ano.
~Sl
de
J.
C. )
mons va/idus Taurttunmjis in
t~rritorio
Valmji, it11
fobito ruit, ttt ca/lriiJIJ cui vicinus erat
&
vicos
cum
omnibtls habitantibus, oppr4/iffot, ,
&c. Cene chroni–
que ajoure que, par la chute íle cerce monragne, le
lae de Geneve
fe
déborda tellemenr , qu' il renverfa plu–
lieurs anciens villages qui étoient bitis fur fes bords,
&
un grand nombre d'églifes; que le pone de Ge–
neve en fue emporré, aioti que les moulins ,
&
qu'il
entra dans cecre ville une
!i
grancle quanrité d'em
que plutieurs perfonnes furenr fubmergées .
Ce
defaf–
tre efl rapporré plus au-long dans Gregoire de Tours.
( D.
J.!
T AU
RE[
A,
f.
f. (
Antir¡.
gr~q.
) •••
1
,1e,
f~re
e
hez
les Grecs en l'honneur de Nepcune ,
u'uu
la ville lle
Cyzique a pu donner le nom de ••,
1
¡.,
a
u mois
ou
elle célébroir cerre fere. O
o
appelluiC
ao!li,
a
ce qu'tl
femble,
Taurton
le lieu de l'at!emblée .. Elle étoit fo–
lemnelle
&
compofée de troi<collegcs de
pr~rretfcs,
&
les facrifices qui éroient offl'l'ts occatinnnotent une
dépenfe contidérable . Les
lacrilicarrices, fornom–
mées
maritimes,
devoienc erre coofacrées aux divi–
nirés de la mer.
&
principalement
a
Neptune . CNte
féte duroit plulieu,:s jours.
11
parolt que les prérret!es
écoienr chargécs par
fondarion ou aurrement des
frais de la féte . Clidicé , grande precretfe, de Neptu·
ne, leur avoir faic _prélent de fept cens tlareres pour
la dépenle d'une feule folemniré , ce qu'on peut éva–
luer a la {omme de vingr mille trois cens livres de
notre monnoie .
Antit¡. greq.
·
du C. l!e Caylus,
fiiH.t
1/.
(D.
J
l
·
TAURENriNUM,
(
Géogr.
""' · )
lieu de la Gau–
le , t'ur le bord de la Médtrerranée , au voitinage de
Marfeille .
L'itm~raire
d'Anronin écrit
T11urtnttt11J .
On croit que c'etl aujourd'hui le porr de Toolun .
( D . } . )
'1'
AURES!UM,
(
Gfog. llnr. )
ville ele la DJrdanie
européenoe, au-dcllt du cerritoire de Duras,. proche
du fort de Bédériane , fe ion Protop.
/Edif. 1.
IV.
c.
j.
C'efl de cette ville,· ajoote-t-il, d'nu J utlinien,
le réparateur de l'empire, a tiré fa naiíll nce. lila lit
clore d'une muraille en
quarr~,
éleva quarre cours
aux quarre coios,
&
fonda cout proche une aorre
ville, qu'il nQmQla la premierc
]uflinient . Taurefimn
etl
















