
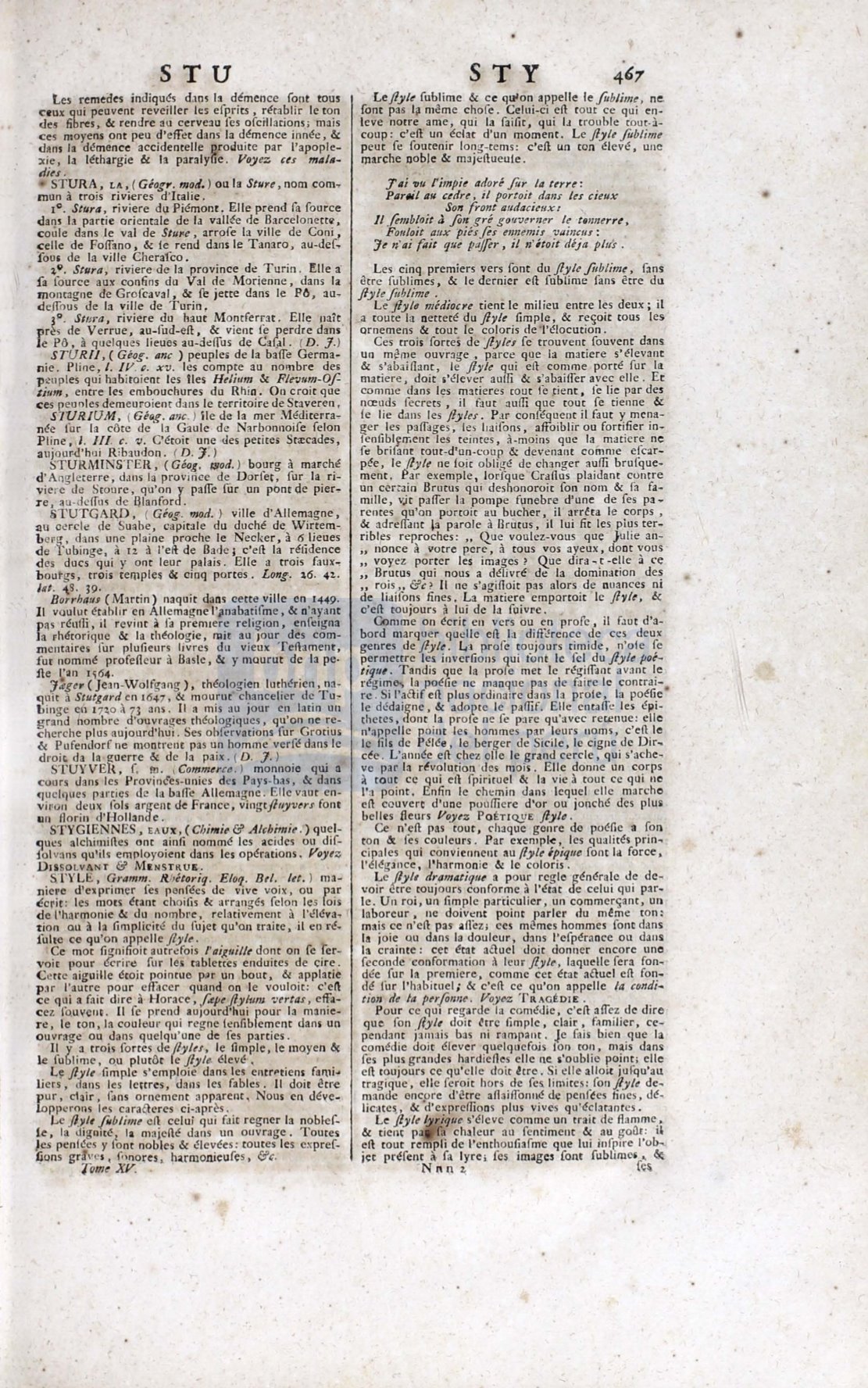
STU
tes
remeéles
indiqués dans la démence font tous
ceux <¡Ui peuvent reveiller les efprics, rétablir le ton
de! fibres,
&
rendre au cerveau fes o(dllarions ; mais
ces moyens ont peu d'elfec daos la démence innée,
&
dftns la démence accidencelle l!roduite par l'apople–
:xie, la
léthargie
&
la paralyfie.
Voyez cu mlllll–
tliu .
STURA,
LA,
(
Géogr. moti.)
ou la
Stul'e,
nom
com~
mun
a
erais rivieres d'ltalie.
¡
0 •
Stura,
riviere du Piémont. Elle pr.end fa í'ource
da~s
la partí
e
orientale de la vallée de
Barcelonett~,
coule dans )e val de
Stu~e,
arrale
la
ville de Coni
1
celle de Fol!:1no,
&
fe rend dans le Tanaro,
a
u-de[,
fous de la vílle Chcrafco.
~1'.
Stura,
riviere de la province de Turin. !lle a
fa íource ame conlins du
V
al de Morienne, dans la
moncagne de Grofcaval,
&
Ce
jette dans le
Pó,
au–
d elfous de la ville de Turin,
3"·
Stm·a,
riviere du haut Montferrat. Elle ¡1a?r
pres de
V
errue, au-fud-efl:,
&
viene fe perdce daos ·
Je
PO,
a
quelques lieues au-de{fus de Cal]ll .
¡D. ] .)
STUR!J,
(
Géog.
atJc
)
peuples de la balfe Germa–
nie . Pline ,
/. JI/. ¡;.
xv.
les aompte au nombre des
p 2uples qui habiroienc les !les
Helium
&
Flevm1J-0.f–
tittm,
entre les embouchures du Rhin. On croic que
ces peunles demeuroienc dans le cer.ritoir.e de Staveren ,
S1UIHUM,
(
6é"'.1f· anc.)
ile de la mer .\1édicerra–
née for la cOte de
la Gaule de
'arbonnoife felon
Pline, l.
JI!.
c.
v. C'étoit une des petices Sca:cades,
atrjour.J' hui Ribaudon.
( D . ] .
)
STURMfNSTER, (
Géog.
fJ!Od.)
bourg
a
mar-ché
d' Anglecerr.e, dans la
provrri~e
de Dorfet, íur la ri–
viere de Swure, qu'on
J
palfe íur un pone de
pier~
re ,
~u.dcfrus
de l)lanfor
.
STUTGAR,D, {
Gfog.
rnod.
)
ville d'Allemagne,
au
o~rcle ~e
Suabe, capital e du duché de Winem–
b Qr•g, dans une plaine proche le Necker,
a
6
lieues
d e l'ubinge ,
a
12
a
l'e¡¡ de Bacle
¡
c'efl: la rétidence
d es ducs qui
y
ont leur palais. Elle
¡¡
trois fa u
K~
boutgs, rrois temples
&
ainq portes.
Long-.
l6. 42.
INI.
"S.
39·
•
Borrhattg
(Martín ) naquit dans cecee vil!e en
1449.
Il voulut étdbllr
en
Allemagne l'¡mabacifme,
&
n'ayant
p~s
réufli , il revinr
a
la premrert! religion,
enf<lig<~a
la r-hácorique
&
la rhéologie, mit au ¡our des com–
rnemaires fur plufieurs livres do vieox Tefl:a\Tlenr,
fut nommé profelleur
a
Baste,
&
y
mourut de la pe.
fte
~an
t)Ó<I·
'}teger
(
Jean-Wolfgang ), théologien lurhérien, na–
quir
i\
Stutgard
en
1647,
&
mourm chance1ier de Tu–
binge e/1
171,0
a
73 ans. 11 a mis :JU jour en latín un
grand hombre d'ouvr·ages chéologiques, qu'on ne re–
cherche plus aujourd'hui. Ses ohíe-rvacions íur Grocius
&
Pufendorf ne o1o ntrent pas un homme veríé dans le
droit da In goerrc
&
de la paix.
( D .
J.)
STUYVER, í,
lll.
1
Commerco.
J
monnoie qui a
cours dans les Provjné'es-unies des Pays-bas,
&
dans
quclques panies de la balfe Allemagne . Elle vaue en–
vir•on deux íols argenc de France, vingtjh¡yw:n· font
am florín d'Hollande.
STYGIENNES,
EAUX, (
Cbimie-
&
Alcbimie . )
quel–
~ucs
alchimifl:es onc ainfi nommé les acides
Oll
dif–
fol vans qu'il• employoienc dans les opérations.
Voyez
DtSSOLVANT
&
Mll>!STRUit;.
TYLE,
Gramm. R.IJétoriq . Etu'l.. Btl. ltt. )
ma–
niere d
1
exprimer fes penfées de Vtve V.OÍX, OU par
éorit : les mors étant choifis
&
arrangés íelon les lois
de l'harmonie
&
du nombre, relativemcnt
a
l't!léva,
tÍO
O
QU
a
fa fimpficité du fu jet qu'·on traire,
.j¡
en ré.
fulte oo qu'on nppelle
flyl<'.
Ce mor fi_gnifioic aucrefois /'
aÍI(IIÍJJe
dont en fe fer–
voit pour ecrir.: fur les rablecres enduices de c;ire .
e~
ere aiguille étoit pointue
p~r
un bout,
&
applatie
p~r
l'aurre pour effacer quand on le vouloic: c'etl
ce
qui afaic dire
a·
Horace,
fope jlyffmJ vereas,
elfa–
cez
lo.ui(CnP. 11 fe prend au¡ourd'hui peur la manie–
re, le con, la couleur qui regne lenfiblemenc dans un
ouvrage ou dans quelqu' une de fes parties.
11
y
a erais forres de
/bvlu.,
le fimple, le mo.yen
&
le fublime ,
o.u plutBr
fe-jlyte.
élevé,
l..!!
jlyle
fimp.les'emploie dans les entrPtiens fa111i•
liers , dans les leHres, dans les fa bies. 11 doir
e
ere
pur, ctair, fa ns ornemenr apparenc , Nous en
déve~
l.opperons les
cara~eres
ci-apres .
J...e
flylt
foblime
ell celui qui fait regner la noblef–
{e,
la digniré
la mnjefl:é dans un ouvrage . Toutes
~ pen{~es
y
fonr nobles
&
élevées: toutes les cxpref–
~Qns
graves , fn.nores , ha.rmonieufes,
&&.
'[ume XV.
STY
Le
jlyf<'
íublimc
&
ce qu'on appelle le
jüblime ,
ne
font pa6
1~
meme chofe. CeiLli-ei efl: tour ce qui en–
leve narre ame, qui la faifir, qui
IJ
crouhle rour.a–
coup: c'efl: un édac d'un moment. Le
jlyle foblime
peut
r~
foucenir long-tems: c'ell un con élevé , une
marche nob)e
&
majellueule .
j
11Í
'"'
l'ímpie adoré for fa tare:
PariJÍ/ au cedre, il portoit dan.r /u cieux
Son front audacic11x
r
J/.femb/OÍf
a
f
on gré
gotJVC>'IleT
/e
•tfllllCTT<!' ,
Fottloit attx
pié.rf'..r emtemif wlinetu :
Je
11'
ai fait que pajfer, il
n'
ítoit déja plu'.r
.
Les ainq premiers vers fonc du
jlyle Ji•blime,
fans
iltre fublimes,
&
le dernier efl: fublime fans erre du
jlyleJi.biime
.
Le
flyle mMioct'e
tient le mil ieu entre les deux;
il
a toute la Qetteté du
jly/e
fimple,
&
resoit toUS
les
arnemens
&
tour le coloris de "l'élocurion .
Ces rrois forres de
flylu
fe trouvenc (ouvenc dans
un me(lle ouvrage ' paree que la maciere
s'~levant
&
s'abaillanc,
le
jlyle
qui ell comme porté fur la
maciere, doit s'élever auffi
&
s'abailler avec elle. Et
comme dans les marieres rout
fe
tiene , le líe par des
nreuds íecrecs ,
il
fauc auffi que tour fe rienne
&
fe lie dans les
jlylu.
P:tr oonlequenr il fa ue
y
mcna–
ger les
palf~ges ,
les ltaifons, affoiblir ou fortifier in.
lenfibl~rr.enc
les ceintes , il-moins que la maciere ne
fe briíanr rout-d'un-coup
&
devenant
~omnrc efc~r
pée, le
(/y
le
ue {qir obligé de ohanger auffi bru{que.
mene , fiar eKemple , lorlque Crallus plaidant conrre
un cerrain Brucus qui deshonoroic fon norn
&
fa
fa–
mille, vjc palfer la pompe f1mebre d'une de fes pa.
rentes qu'on p<Jrroic au bucher, il arrtra le corps ,
&
adrelfdnt
la
parole
a
Brutos,
i1
tui tic les pius
ter~
ribles reproches : , Que voulez-vous que Julie an–
" llOnCe
a
Votre pere,
a
COUS vos ayeux, doot VOUS
, voyez porrer les
ima~es
?
Que dira, e -elle 3
l'c
, Brutos qui nous a délivré
d~
la dominarion des
,
rois,
&e?
11
ne s'agilloic pas alors de nuances ni
de liaiíons fines, La maciere empanoic le
jlyl~. ~
o'efl:
~oujours ~
lui de la Íóivre.
Gomme on écrit en vers ou en profc, 11
fJ ut d'a–
bord marquer t¡uelle efl:
la di lrérence de ces deux
genres de
jlyle.
[.¡:1
profe coujo urs cimide, n'ofe fe
permerfre les inverfions qui iom le fel du
jlyle po(...
tiqr11.
Tandis que la prole met le régilfanr ava nr le
régime., la poéfie ne manque pas de faire le concrai–
rc . Si l'aélif ell plus ordinairc daos la prole , la poéfie
le dédaigne ,
&
adopte le paffif. Elle cnrafl'e les épi–
checes , done la profe ne fe pare qu'avcc
re~nue:
elle
n'appelle point
~e~
hommes par leurs noms, c'ellle
le lils de Pélée , le berger de Sicile, le cig11e de
Dir~
c~e .
L'année efl: che:ó elle le grand cercle, qui s'ache–
v.e par la
r~volucion.
des mois. Elle darme un corps
a
rouc ce qui etl fpirituel
&
la vie
a
tout ce qui ne
l'a point, Enfin
le ohtmin dans lequel elle marcho
cft couvert d'uoe p
uuffiere d'o r oujo¡¡ché des plu¡
bell~s
tleurs
1/~yez
PotnQ.YE jly.le.
Ce
n'efl: pas tour,
e haque genre
de
p.oélle a íon
ton
6t
íes couleurs.
P.arexemple, les qualicés prin,
cipales qui conviennem au
flyle ;pique
(onc
la force ,
l'élégance, l'harmonie
&
le coloris.
Le
/ly/1
dr~matiqu~
a pour regle générale de de,
voir
~rre
wujours conforme
a
l'érac de celui qui par–
le . Un roi, un limpie paniculier, un commersanc, un
laboreur, ne doivt:nt poinr parler du méme
con~
mais ce n'efl: pas allez; ees memes hommes íom dans
la joie o.u dans la douleur-, dans l'c(pérnnce ou dans
la crainte : cet état aéluel doic donner encare uno
feconde eonformacio n
~
leur
jlylf!l,
laquelle íera fon–
dée fur la premiere, comme cec écar aélucl efl: fon–
clé lur l'habicuel;
&
c'efl: ce qu'on appelle
la
condi–
tion de fa pu.(otme .
V~yeoz
TR AG.ÉDtE .
Pour ce qur regarde la comédie, c'efl: alfez de dire
que ron
!fyü
doir
~fre
limpie' clair. familier, ce–
pendane jarnais bas ni ramparn . Je fais b.ien que la
comédie
doi~
élever quelquefois Ion t{)n, mais dans
fes plus grandes hardiefles elle ne s'oublie peine; elle
efl roujours ce c¡u'elle doir lcre. Si elle alloi.t juíqu'au
tragique , elle íereit hors de fes limites: íon
jlyie
de,
mande enc,ore d'i!tre aflaillonrlé de peníées fines, dé–
licace~ ,
&
d'expreffions plus
vives
qu'éclarantes .
Le
flyle
t
rique
s'élevc cemme un rrait de flamme ,
&
cien> p
fa chaleur au fentimenc
&
au
~oll.f:
i~
efl: rout rempli de l'enchouúafme
que luí infp1re l'ob-..
j~t pr~íenr ~
fa lyre; fes images
fo.nt fublimei ,
~
.N
1'0
z,
~~~
















