
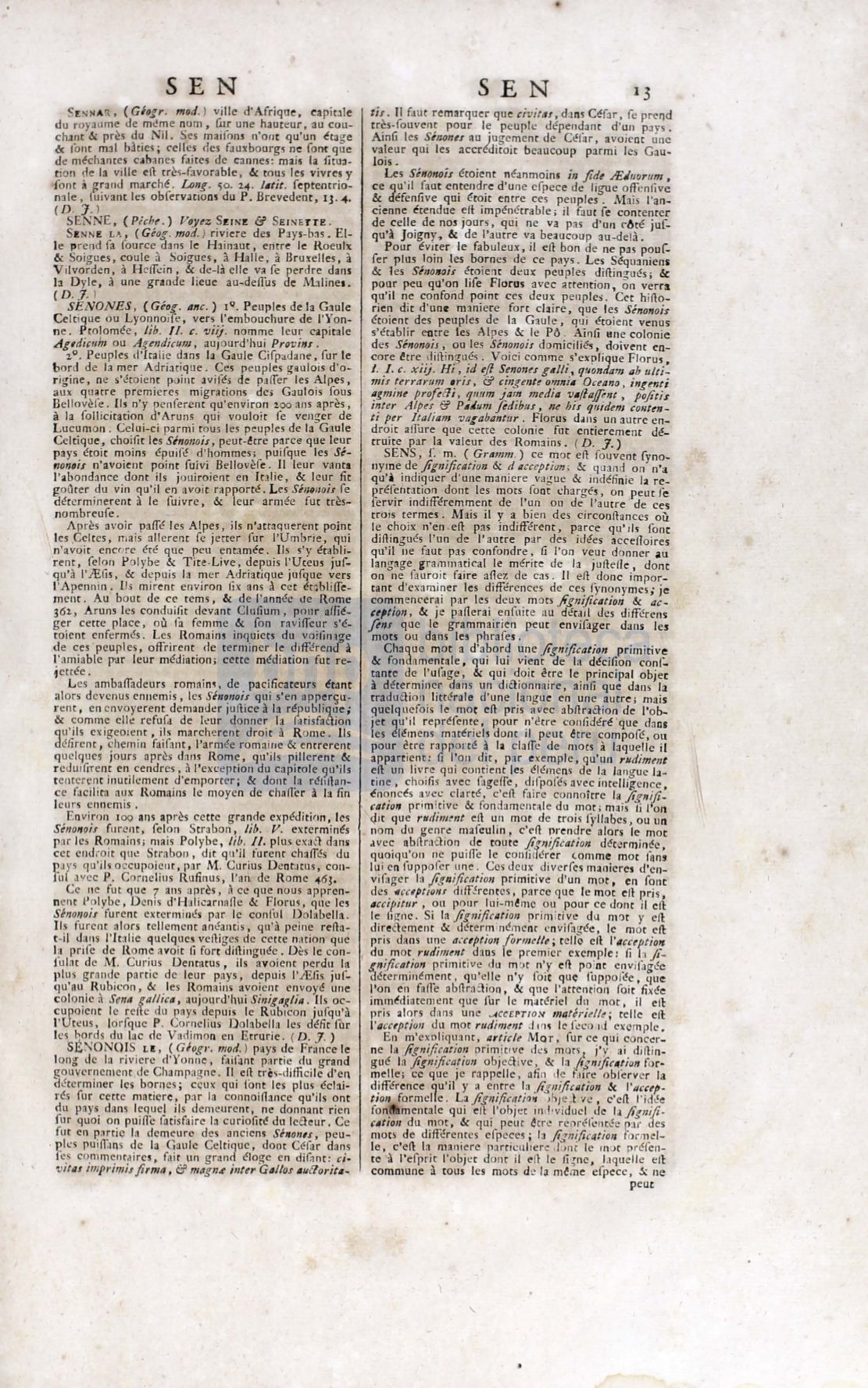
S
E N
SEst<AR,
(Gío¡r. mod.)
villc d'Afrique, eapiule
du roya
u
me de me!me nom,
Úlr
une haoreur, au cou–
chant
&
pres do Ni!. Ses maifrms n'ont qu'un
~r:age
(le
tone m3l baties; ccllcs des fauxboorgs ne font que
de méchanccs cabanes faires de cannes: mais la fitua–
tion rle la volle en
crc~-favorable'
&
tous les vivres y
font
1í
grand marché .
Long.
so.
2-4.
l11tit.
feptemrio–
n31e, fuivant les obfervacooos duP. Brcvedent,
IJ .
-4·
(D.
J.)
SE NE, (
PtciJf.) Voyfz
S~:
os E
&
SeoNET TI! .
LNNI!
LA, (
G;og. mod. )
riviere des
Pays-b~s.
El–
le prend fa fource daos le H1inaut, entre le Roeulx
&
oigues, coule
a
Soígues,
¡¡
Halle,
a
llruxelles,
a
Volvorden,
~
H clfdn,
&
de-la elle va fe perdre dans
la
D yle ,
~
une grande licue au-dell'us de Mllines.
(D.
7.
l
SENONES,
{
G;og. 11nc. )
1 11 •
Peuples de la Gaule
Celnque ou Lyonnoofe, vers l'embouchure de I'Yon–
ne. Pcolomée,
lib.
/1.
c. viij.
nomme leur
ca
pitale
Agtdimh•
ou
Agmdicum,
au¡ourd'hui
Provins
.
:z.
0 •
Peuples d'ltalie daos la Gaule Cifpadane, fur le
bord de la mer Adriacique. Ces peuples gaulois d'o–
r ígine, ne s'écoienc p ine avifés de palfer les Alpes,
aux quacre premieres migrations de; Gauloi
fous
BellovHe. lis n'y penfercnt qu'cnviron
:z.~
ans apres,
a
la follicitacion d' Aruns qui vouloit fe venger de
Lucomon . Celui-ci parmi tous
les
peuples de la Gaule
Ce!tique, choifit les
Sínonois,
peuc-~cre
paree que leur
pays étoic moins épuifé d'homrnes; puifque les
s;–
tiOnoi.r
n'avoient point fui vi Bellovefe .
11
leur vanea
l'abondancc done ils
jouiroient en lt:1lie,
&
leur fic
goOrer du vin qu'il en avoie rapporté. Les
SÍIIfiiOÍr
fe
oéterminerent
a
le fuivre'
&
leur armée
fue cres–
nombreufe.
Apres avoir palfé les Alpes, ils
n'acraquer~nt
poinc
les .Ccltes, ona is allerenc fe jerrer fur I'Umbne , qui
n'avoic encore éré que peu enumée. lis s'y étahli.
'rene, fclon Polybe
&
Tice. Live, depois I'Uceus juf–
qu'a 1'
l'Efis,
&
depuis la mer Adriatique jufque vers
I'Apennon.
[1;
mirene environ fix ans
a
cet énblilfe–
menc. Au bouc de ce cems,
&
de l'année <le Rome
36:z.,
Aruns les conduifit devane Clufium, pour aflié–
ger cecre place, ou la femme
&
fon
ravi(feur s'é–
coienc
cnferm~s .
Les Romains inquicts du voilin-we
de ces pcuples, offrirenc de cerminer le dif!'érenct
a
l'amiable par leur médiation; cecee médiacion fue re–
;crcée.
Les ambalfadeurs romni"', de pacilicaeeurs étant
alors devenus enncmis, les
Shto11oir
qui
s'en
apperc;u–
renc, en cnvoyerenc demander jullice
a
la républ ique;
&
comme
el!~
refufa de
l~ur
donner la fatisfaétion
qu'ils c'igeooent, ils marcherent droit
a
R ome . lis
défirenc, chemin faifant, l'armée romaine
&
encrereqt
quelques jours
apr~s
dans Roml!, qu'ils pillerent
&
r eduifrrem en cendres'
a
l'exeeption du capirote qu'ils
rentcrenc inucilcmenc d'emporter;
&
dont la rétit\an–
ce facilica aux
Rom~ins
le moyen de challer
a
11
fin
Jcurs ennemis .
Envimn
100
ans apres certe grande expédirinn, les
s;IIOIJOÍf
fureolt, fel on Strabon,
lib.
V.
exterminés
par les Rnnl3ins ; mais Polybe,
lib.
1/.
plus. exa(l daos
cet endroit qu" Strabon, dit q u'il furenc chalfés du
(>J
ys qu'ils occupoicnt, par M. Curius D enratus, con–
fui avcc
P.
Cornelius Rufinus , l'an de Rome
-4ÓJ.
Ce
ne fue que
7
ans apres,
~
ce que nous appren–
nent t.'olvbc, D enis d'Halicarnalle
&
Florus, que les
Séllollois
'furent excermint!s par le conful Dolabella .
lis fu rene alors tellemenc anéancis, qu'a peine rella–
t-il dans l'lc:olie quelqoes vefliges
de
cerce nation que
la
prife de Rome avoit
ti
forc dillingut!e. Des le con–
fu lae de M. Curius Dencacus, ils avoienr perdu la
plus grande partie de leur pays, depuis
1'
.!Eiis juf–
qu'au Rubicon,
&
les Romains ;lVOienc cnvoyé une
colonie
a
Setur gallic11 ,
aujourd'hui
Sinigag/ia.
lis oc–
cupoient le rene rlu pays depuis le Rubocon jufqo'a
I'Uceus, Jorfque
P.
Cornelius D olabella les dt'fit IOr
les 1-ords du lae de Vacfimon en Ecrurie.
{D.
J.
)
SÉ. '0
OIS
u: , (
Glogr. mod.)
pays de France le
long de la riviere d'Yonne, f•ifant partie du grand
gouvcrnemenc de Champag ne.
fl
ell crcs-difficile d'en
d écerminer les borqes ; ccux qui tont les plus échi–
rés fur cecee maciere, par la connoillance qu'ils ont
do pays dans lequel ils demeurenc, ne donnant rien
fur quoi on puille tatisfaire la curiofité du teaeur. Ce
fue en partiQ la demcure des ancicns
Shtonts,
peu-
. pies puilfJns de la Guule Celtique, done Céfar daos
fe
commenc•ircs, fair un grand éloge en difant:
ú–
vitas imprimiJ firma,
&
n111gn.e inter Gallos- 11uflorita-
S E N
tis.
11 f•ut remarquer que
civitas,
dans Cé'far, fe
pre~d
tres-fouvenc pour
le peuple dépendanc d'un pays .
Ainú les
s;nonu
au jugemenc de Célar, avoieoc une
valeur qui les accrédieoit beaucoup parmi les Gau–
Jois.
Les
Shto,oís
étoient néanmoins
in jidf ./Eiuorum
,
ce qu'il faut encendre d'une efpece de ligue offenfive
&
défenúve qui écoic enrre ces penples . Mais l'an–
cienne érendue efl impénétrable; il fau t fe contemer
de celle de nos jours, qui ne va pas d'un rOté ju[–
qu'a Joigny•
&
de l'autre va beaucoup au-dela .
Pour évicer le fabul eux , il en bon de ne pas pouf–
fer plus loin les bornes de ce pays. Les Séquaniens
&
les
Sé11o11oir
étoienc dt:ux peuples dillin"ués;
&
pour peu qu'on life Florus avec arrencion, on verrll
qu'il ne confond poinc ces deux penples .
c~c
hino–
rien die d'unR maniere forr
el
aire, que les
Sénonoi:r
étoienc des peuples de la Gaule, qui étoienc venus
s'établir entre les Alpes
&
le PO . Ainfi une colonie
des
Sénonois'
ou le
s;nonois
domiciliés. doivenc
cn–
cnre l!tre dillingués. Voici comme s'cxolique Florus,
/.
/ .c. xiij. Hi, id
~fl
Smones g111/i, quondarn ab lllti–
nlif
~~rrar11m ~rir,
&
cfngelltt
o~nni•
Oceano ,
in.renti
llgTJune proftflt, qwtm ¡arn medta Vll(laJPnt
,
pojitis–
inter Alpes
&
P11ium ftdibtu, ne bis q11idem contm–
ti ptr l tali11m varab4ntllr.
Florus
d~ns
un aurre cn–
droic aflure que cene colonie fue cncieremenc dé–
cruice par la valeur des Romains.
(D.
J. )
SEl S,
!:
m. (
Grlfmm. )
ce moc ell fouvent fyno–
nyone de
ji¡;11ijication
&
d acception ;
&
qu~nd
on n':t
qu'a indiqucr d'une maniere vague
&
indélinie la re–
¡>réfentation done les mors fonc
charg~s ,
on peut fe
fervir indifféremment de l'un ou de l'aucre de ces
troos termes. Mais il y
a
bien des circonllances ou
le choix n'en .ell pas indiffércnc, paree qu' ols
font
dillingués l'un de 1' autre par des
idées accelloires
qu'il ne faut pas confondre,
li
l'on veuc donner
a
u
langage ¡rammacical le mérite de
la
julleffe, done
on ne fauroit fa ire aflez de cas .
11
efl done impor–
canc d'eX3miner les diff¿rences de ces fi•non¡•mes; je
commencerai par les deux mors
.tfgnification
&
ac–
u,tio/1,
&
je pallerai enfnire au dc!Cdll des différcns
ftns
que le grammairien peuc envifager dans
les
mou ou dans les phrafes.
Chaque mot a d'abord une
.fignification
primirive
&
fond•1mentale, qui luí viene de la décifion conJ:.
cante de l' ufage,
&
qui doit
~ere
le principal objec
a
déterminer dans un diaionnaire' ainfi que dans la
craduaion littérale d'une langue en une aucre; mais
quelqnefois le mot cll pris avec abllroélion de l'ob-
!
.et qu'il repréfcnte, pour n'<!cre confidéré 'que daos
es élémens matérids done il peu t
~ere
compofé,
mt
pour erre rappoi'Cé
a
la clalfe de mocs
a
laquelle
j)
appartien~:
fi
l'on die, par exemple, qu'un
rudiment
ell un livrc qui contiene les élémens de la lang ue la–
cine , choifis avec fagelfe, difpofés avec incelligence,
~n~ncés
ay;,c. clareé, e'en fa ire connoicre la
jignif!–
catto11
prom:covc
&
fondamenrale du mot; mais ti
1
on
<jot que
r11dimmt
en un mat de trois fi,llabes, ou un
nom du genre mafeulin, c'ell prendre alors le moc
dVec abllrafrion de touíe
ji~,¡ification
décerminée
quoiqu'on ne puille le conliuérer
'omme mot
fan~
tu i en fuppofer une . Ces deux diverfes manieres d'en–
v ifager la
jiguificntiofl
primirive d'un ll)Ot, en font
des
ilfctptionr
doff!renrcs, pgrce que le mot etl pris ,
11ccipit11r,
ou pou r
loi-m~me
ou pour ce done il cfl:
le
fi~nc.
Si la
jigllijiCIItion
primirive du mor y en
direélement
&
decermonémcnr cnvifagée ,
le
mot en
pris dans une
ncaptio1¡ formdle;
tcll<l ell
l'11cception
du moc
rudimmt
daos te premier exemple :
ti
b
fi–
.{llificlltion
primicive du mot
n'y
en point envifagée
aéterminément, qu'elle n'y foit
qu~
l'i.1ppofée,
<JU<t
l'on en falle abflraaion,
&
que
l'ancn~ion
foic lixée
immédiacemenc que for le rnat
ériel du moc,
il
ell:
pris alors daos une
.ACCEPTto.v
ma.tb'ielle;
te!le efl
l'acetption
du rnot
rudimt>lt
:Io n
< le !'eco od ex()mplc.
En m'exoliquanc,
articlf
Mor,
fur ce qoi
conc~r
ne la
fign ijicatioll
orim¡c,ve rles mors
j'y ai dillin–
gué la
JignificafÍOII
objeaive,
&
la
:f,fniji.c11~ion
fo r–
melle; ce que ¡e rappelle, afin de i'a'íre oblerver la
d)fféronce qu'il y a
e~cre
l.a
.fignifiuttion
&
l'acufJ–
tiOI!
formclle . La
jigmfict~tton
,f>¡e-1
ve ,
e•
en l'idt!e
fon mencale qui efl
l'obj~c
ind>viduel de la
jlgni/i–
(l!tioll
du mot,
&
qui peur
~tr~
re réfcncée par
<Íes
mocs
de
différences efpeces ; la
.fign~/ica.tion
f<
rmel–
le, e•en la maniere parciculoerc .hnr le onoc
pr~ren
te
a
l'efprit l'objec donr il en le
fi·~nc '
laquelle
~ll
commune
ii
cous les mots de la
m~me
efpece,
~
ne
peut
















