
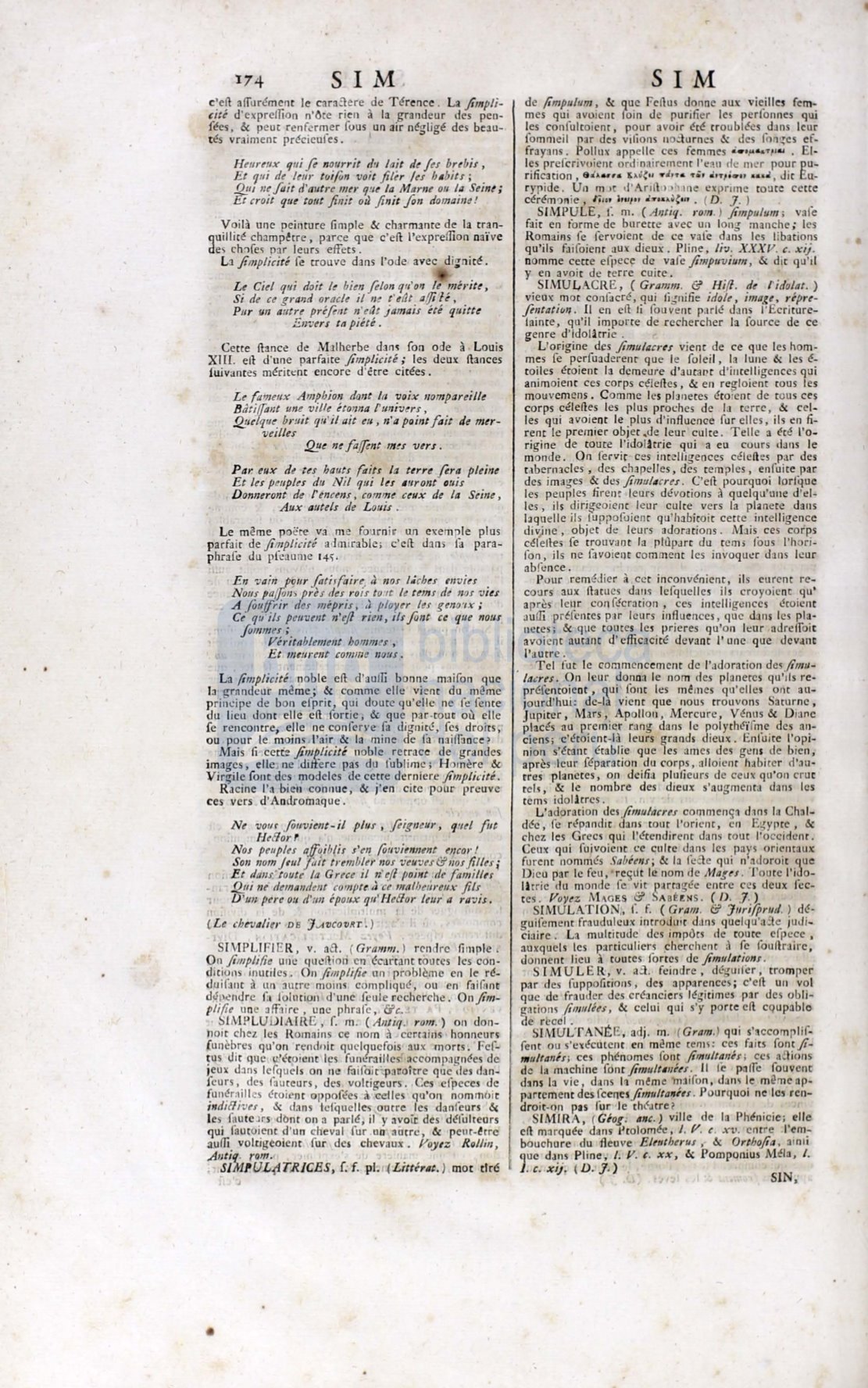
174
SI M
c'e!l atrurément le caratlere de Térence . La
jimpli–
cité
d'exprelTion n'óce ríen
a
la grandeur des pen–
fées ,
&
peuc
renf~rmer
fous un air négligé des belu-
tés
vraimenr précicufes.
1
H~11r~!IX
q11i fi no11rrit d11 lait
ti~
f u brtbir,
Et
'!"¡
d~
lt11r toifon voit filrr fu h•bitr
;
Qu¡
''~
jiút
tl'autrc
m~r t¡ll~
la Mame 011
f¡z
s~inf ;
J!J
croit
t¡fl~
tottt finit oJI finit fin domaine!
Voila une peinture fimple
&
charmlnte de la rran–
quillicé
champ~rre,
paree que c'e!l l'expreffion nai've
de< ch'l[e< par leurs elfcrs.
La
jimplicité
[e
crouve dans l'ode avec
di~ni té.
L~
Cid qui doit lt bien filon qu'011
le mériu ,
Si de ce grand ornc!t il
m
t'ef2t
~t/jiU,
P11r un nutre préfint n'
e~1t
jamais été quitte
Euver.r tn
pitté.
Cecee
!lanc~
d<! M:1 lherbe dlns fon ode
a
Louis
Xlli.
en d'une parfaite
jimplicité;
les deux !lances
fui
vanees méritenr cncorc d'ecre cirées.
Le
fammx
Amphion do!Jt lrt voix nomparei/le
Báti(fimt une vi/te étonna ftmivers,
Qfiilque. bruit qu'il ait
m ,
ti'a point foit de
m~r
vcJI/es
Q!le ne foffont
mu verr.
Par. eux de :es bauts faits la ture fira pleine
Et /u pe11plu du N i/ qui lu 6ttro11t o11is
Donneront de fenct1u, comme ce11x de la Stine ,
A11x a11te/s de Louis
.
Le
m~me
poece
va
me fo
rni~
un exem le plus
parfaic de
jimplicité
adm1rable ; c'c!l dam la para–
phrafe du pfcaume
14\'.
En vain_ _po/lr ,{tttirfaire.
a
1/0S /Áchu m viu
Notu pa{jutl>pres dtr rois to ·tt le tems de 11os vie.r
A .fot!tfrir dos mépris,
~~
ployer les geno•tx;
Ct qu'tls pettvmt n'efl rtm, tls flnt
ce
qtu no11s
fomme.r;
Véritab/emmt bomm s
,
Et llltllrent comme
IJOIIf.
La
(tmplicité
noble e!l d'aulli bonne maifon que
13
grnndeur meme;
&
comme elle viene du mí!me
principe de bon efpric, qui douce qu'elle ne fe fen ce
du lieu J ont elle efl fortie,
&
que par -toUD OU elle
fe rencontre, elle ne conferve ía dignicé, fes droics,
ou pour le moins, l'air
&
la mine de la naiílaoce?
Mais fi certe
jimplicité
noble retrace de grandes
images, elle, ne ditfere pas du (ublimc; Homere
&
Vir~ile
fonr des lfiOdeles de cecee derniere
jimpli.-it¿.
R acine l'a bieh coonue,
&
j'en cite pour preuve
ces vers d'Andromaque.
Nt vottr .fotwimt- il pl11s , Jeigneur,
qttel
fue
Hd lor f
Nos peuplcs affqib(is r'ct¡
(or~vÍ!IIIJent
mcor!
So11 11om
jtt~l
fott trtmbt.r 110s veuues&nosfil/ui
E t tla11s"toute /a Grece il tt'•fl poiHt .de familln
Q!ti
lit
demaltdellt comptt
ace
malbetlrettx fiü
D'utJpere 011
d'1m
époux
r¡u'
fletlor leur a rauis,
~Le
•·beva/ier
D B
J.-.vcovRT .)
Sf<\<lPLrF! ER , v. aét
(
Gramm. )
rendre limpie .
O n
jimpli{ie
une qul! inri en
~car'cant
rouces les aon–
dit!ons inuciles _ On
.ftmplijie
un probleme en le ré–
dUJfanc
a
lln aurrc moins compliqué, ou en fa ifiont
d.!
endre
fa
lolncion d'unc íeu·le recherche.
Onjim–
plifie
une affaire, une phrafc ,.
&e-.
SIMPLU
!AIRE._, f. m. (
A.11Jiq.• rom. )
on don–
no•c chez les Romams
ce
nom
il
ecrcain
honneurs
une~res
qu'on rendnlt quclqoefois• aux mores. Fef–
~us
d1t que ·u'écoienc les funé'miHe •
accompagn~es
de
1eux dans lefquels on ne fu ifoit'<panoitre que des dan–
fcurs, des fau ceurs, des voltigeurs. Ces efpece.s de
~un~r~_illes
écoienc oppofées ;\, ce!les qu'on nommoit
tndttltvts,
&
dans i c(quelles oocre les danfeurs
&
les li!UteJrs dbm on a parlé, il
y
avolt. des délulreurs
qui faucoi_enc d'un cheval fur un aücre ,
&
peuc-~cre
auffi. volr•geolem íur des cbevaux.
Voytz Rollitl,
AntJq. rom.
,
•
~JM!{;}L{lT.RJCBS,
(.f.
pl. r~ Littér11t. )
mot tiré
S 1M
de
(tmpttlum,
&
que Fellus donne nux vieilles fem–
mes
qui avoienc foin de purifier les perfonnes qui
les confulcoienr, pour avoir écé croublées dJn
leur
fommeil par des vilions no.:lurnes
&
de
fon~es
ef–
frayans. Pollux appelle ces femmes
.:..1'...
~1'"'
.
El–
les preícrivoienc ordinairemenr
l'~~u
d.: mer pour pu–
rific3tion '
QJ),._-,..
I.A.Í~II
• • ,,•
.....
a,T,••.,
uc..l
J
Jir
Eu–
rypide. Un mJ t
d'
Anll
>
•·11ne expr•me ro
u
ce cecee
cérémonie ,
r¡,.,
¡,.,,.,
.......
A~'"'
.
( D.
J.
)
SIMPULE,
1:
m. (
At1tiq. rom.) fimpulum ;
vnle
fai c
e~
fo rme de ?urene avec
u~o
Ion,; manche; les
Roma1ns fe
fervo•enc de ce vale dans
les libacions
qo'ils fJifoienc aux dieux . Pline ,
liv.
XXXV.
c. xij.
oomme cecee
efpec~
da vafe
jimpuvium ,
do
e
qu'1l
y
en avoir de terre cuire.
SIMU I.,. CRE,
(
Gramm.
&
Hi(l. de
f idolitt. )
vieux .mor eontacré , 9ui li,;nifie
ido/e, ima,(e, dpre–
fintatm¡ .
11
en ell
h
fou
venc
parlé dJns
1'
Ecricure–
laince, qu'il importe de rcchercher la fource de ce
genre d'ldolacrie .
L or-igine des
jimu/¡ze~·n
viene de ce que les hom–
mes fe perfuaderenr que le foleil, la lune
&
les é–
roiles écoient la demeure d'aurarH d'incell igences qui
animoienc ces corps
e~!
elles,
&
en reg-loienc cous les
mouvcmcns . Comme les pbnetes éto1cnc de cous ces
corps c¿le!les les plus prochcs de IJ ccrrc,
&
cel–
les qui avoient le plus cl'inRucnae fur elles, ils
~n
fi–
renr le premier objet ,de leur culee. Telle a écé !'o–
rigine de toute l'idoUcrie qui a eu
cours tlans le
m nde . On fervi c ces incelligences céleíles par des
rabernacles,
des
chapelles, des temples, enfuice par
des images
&
dos
jimuüJCru .
C'e!l pourquoi lorli¡ue
les peuples lirenc leurs dévocions
il
quclqu'une
d'~l
les, il s di rigeoienr leur culee vers la planece dans
laquellc il s _luppofuienc qu'habicoit cecee incelligence
di v) ne , ob¡ct
de:
leurs adoracions . Mais
ces
corps
célell-e
fe crouvaoc la ph1pJrt du cems fous l'h ri–
fon, il
ne f.1V01enc commenc les invoqucr dans kur
abíi:nce.
P-.lur reméJ ier
a
ccr inconvénient, il
eurcnc re–
cours aux !lacue
dau~
lefquelles ils croyoienr qu'
apres
lel¡r col] fécracion , ces
incelligences écoienc
:lllili
préfences par leurs inRuences, que dans les pla–
neces;
&
q¡•e couces les prieres qu'on l.:ur adretroit
avoient aucanr d' efficaciré devane
1'
une que dev.111t
l'autre.
Tel fue le commencement de l'adoracion des
{tmu–
/acrts.
On
lcur donna le nom eles planeres qu'lls re–
préfentoieoc,
~ui
fom les memes qu'elles onc au–
jourd'hui: de-la viene que nous crouvons
acurnc,
J upiter, Mars, Apollon, Mcrcure , Vénus
&
Oi:Jne
placés 11u
premi~r
rang dans le polychéi'fme des an–
ciens; c'écoienc-h\ leurs grands dieux. Ent'uice l'opi–
nion s'éronc écabl ie que les ames des
g~ns
de bien,
apres leur fépara cion du C'orps, alloienc habicer el'
a
u–
tres 1>laneces, on deifia plufieurs de ceux qu'on crut
cels,
&
le nombre des dieux s'augmenca dans los
cems idol icres.
L'adoracion
dcsjimu!acres
oornmen~p
dans la Chal–
dt'e, fe n'pandir dans tour l'orienc, en Egypte ,
&
e
hez les Grecs qui l'étendirenc dans couc l'oC'cidenr .
Ceux qui fuivoient ce culee dans les pays oriencaux
fu rene nommés
Sabéms;
&
la feéle qui n'adoroit que
D ieu par le feu, re<,¡út le nom de
Ma.res .
T oute l'ido–
Ucrie du monde fe vit parragée encre ces deux
Cee–
tes.
Voyez
M AOES
&
SAsÉI!:NS .
(D.
J. )
SfMULATIO
¡, [
f.
(
Gram.
&
Jurifimul. )
dé–
guifement frauduleux incroduit dáns quelqu'a.:le juJi–
ciaire . La mulcicude des impocs ele couce efpece ,
auxquels les parciculiers cherchent
~
fe fou!lrlirc,
donnenc Jieu
a
coutes (orces de
jimullltion; .
SIMULER,
V.
aa. feindre, déauder, crompcr
par des fuppofi rions, des apparences ; c'e!l un vol
que de fraudcr des crélneiers légitimes par des obli–
gations
jimu/éu,
&
celui qui
s'y
porte efl CQUpablo
Cle
reael .
SIMULTA
ÉE,
adj. m.
(Gram. )
qui s'accomplif–
(enc
ou
s'e~écu¡enr
en
m
eme
cem<:
ces fai cs fonc
Ji–
ltlulttmh;
ces phénomes fonc
jimu/tattés ;
ces a ions
de la machine fonc
jimult•utes .
ll le
patre
fouvcnr
d!nS la
vi
e, dans
13
mtme lnlifon, dam le ml!me ap–
parcement des
[cenesjimu/tallhr .
Pourquoi ne les ren–
droit-on pas fur le cht'-Jrre l
1M
IRA, (
Géog. ""'· )
ville de la Phénicie; elle
e!l marquée dans l'rolomée,
/, V .
c.
xv.
entre
l'em–
bouchu re du ofleuve
Elmtlurur
,
&
Ortbojia,
a1n1i
que dans Pline, /.
f/.
&.
xx,
&
Pompqnius Ml!la, /.
J.
e. xij.
( o.
J.)
SIN,
















