
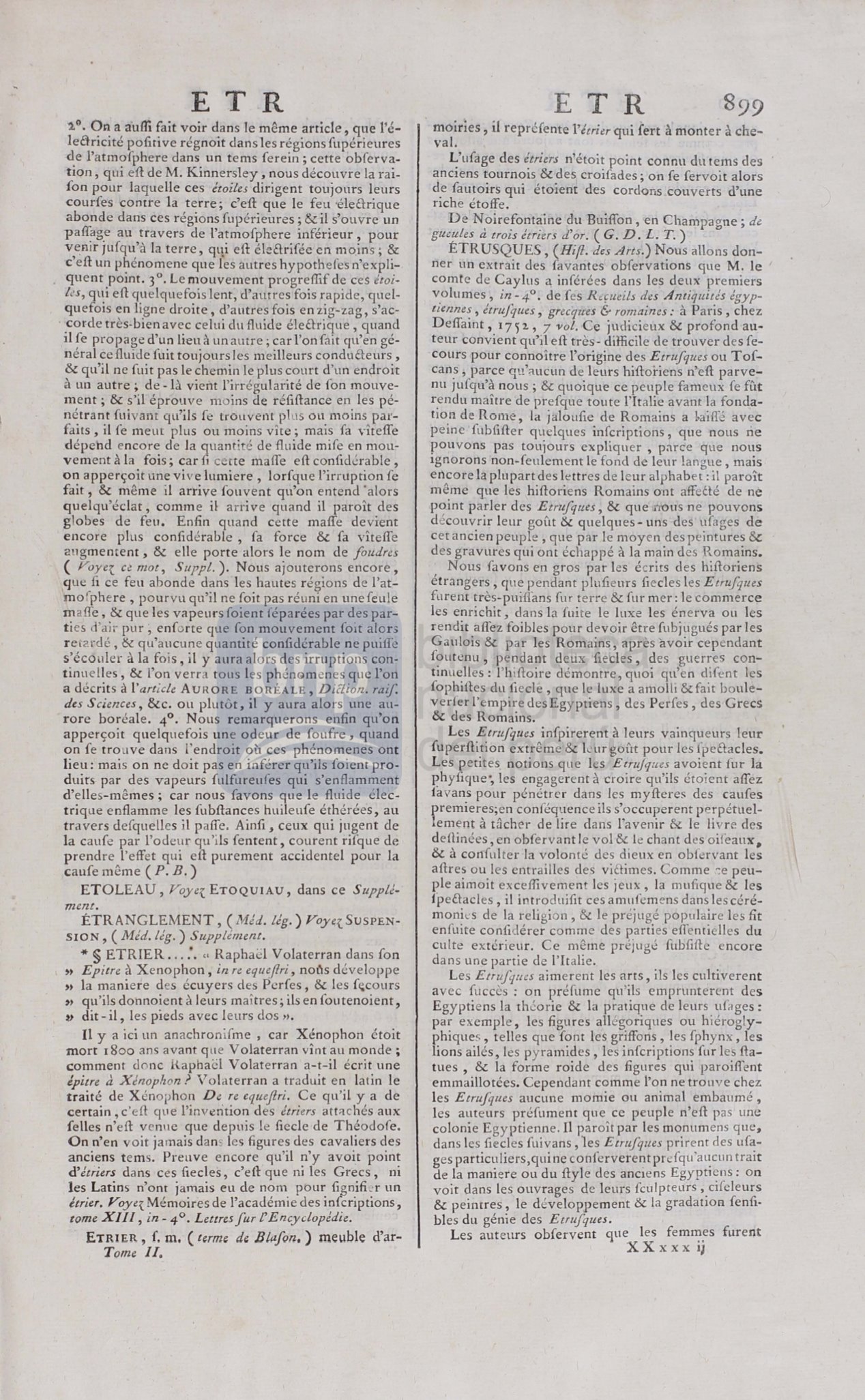
ETR
1.
0 •
On a auffi
fait voir dans le mSme article, que
l'é–
leéhicité pofirive régnoit dans les régions fupéríenres
<le l'atmofphere dans un tems ferein; cette obferva–
tion, qui efi de M. Kinnersley, nous découvre la rai–
fon pour laquelle ces
étoiles
dirigent toujours leurs
courfes contre la terre; c'efr que le fe
u
·éleéhique
ahonde dans ces régions fupérieures; &il s'ouvre un
paa:ag_e au travers de l'atmofphere inférieur , pour
v~n1r
Jufqu'a la terre, qui efr éleéhifée en moins;
&
c'efr un phénomene que les autres hypothefes n'expli–
quent point. 3°. Lemouvement progreflif de ces
étoi–
Les,
qt~i
efr quelquefois lent, d'autres fois rapide, quel–
quefOis en ligne droite, d'autres fois en zig-zag, s'ac–
_corde tres-bienavec celui du fluide éleéhique, quand
11
fe propage d'un lieu
a
unautre; carl'on fait qu'en gé–
néral ce fluid e fuit toujours les meilleurs conduéteurs,
&
qu'il ne fuit pas le chemin le plus court d'un endroit
a
un autre ; de-
la
vient l'irrégularité de fon mouve–
ment;
&
s'il éprouve m ins de r 'íiíl:ance en les pé–
nétrant fuivant qu'ils fe trouvem plus ou moins par–
faits , il fe meut plus ou moins vi te; mais fa viteífe
dépehd encore de la quanti é de fluide mife en mou–
vement
a
la fois; car fi e
e
te maífe eíl: confidérable,
on apperc;:oit une vi ve lumiere , lorfque l'irruption fe
fait'
&
meme
il
anive fouvent qu'on entend. alors
quelqu'éclat, comme il arrive quand
11
paroit des
globes de feu. Enfin qnand cette maífe devient
encore plus confidérable , fa force
&
fa viteífe
a
tgmen
ent,
&
elle porte alors le nom de
foudres
e
Yoyez
Cl!
mot' Suppl.
).
Nous ajouterons encore '
que
fi
ce feu ahonde dans les hautes régions de l'at–
moíphere , pourvu qu'il ne
foit
pas réuni en unefeule
maífe,
&
que les vapeurs foient féparées par des par–
ti
es d'air pur, enforte que fon mouvement foit alors
ret2rdé , & qu'aucune quantiré confidérable ne puiífe
s'éco tler a la fois'
il
y
aura alors des irruptions con–
tinuelles,
&
l'on verra tous les
phén~menes
que l'on
a décrits
a
l'article
AURORE BORÉALE,
Diaion. raif.
des Sciences,
&c. o u plutot, il
y
aura alors une au–
rore boréale.
4°.
Nous remarquerons enfin qu'on
appen;oit quelquefois une odeur de foufre, quand
on fe tro ve dans
'endroit oi1 ces phénomenes ont
lieu: mais on ne doit pasen inférer qu'ils foient pro–
duirs- par des vapeurs fulfureufes qui s'enflamment
d'elles-memes; car nous favons que le fluide élec–
trique enflamme les fuhfrances huileufe éthérées, au
travers defquelles 'l paífe. Ainíi, ceux qui jugent de
la caufe par l'odeur qu'ils fentent, courent rifque de
prendre l'effet qui ei1 purement accidente! pour la
caufe meme
(P. B.)
ETOLEAU,
Voyez
ETOQUIAU, dans ce
Supplé–
ment.
ÉTRANGLEMENT, (
Méd. Lég.)
Voy~{
SUSPEN–
SION, (
Méd.Lég.) Supplément.
*
§
ETRIER ...
:.
"Raphael Volaterran dans fon
~>
Epítre
a Xenophon,
in re equejlri,
nofls développe
,) la maniere des écuyers des Perfes,
&
les
f~cours
,
qu'ils donnoient a leurs maitres; ils en foutenoient'
v
dit-il, les pieds avec leurs dos''·
11
y
a ici un anachron ·fme , car Xénophon étoit
mort
1
8oo ans avant qu e Volaterran vinta u monde ;
comment done Kaphael Volaterran a-t-il écrit une
épitre
a
Xénophon?
Volaterran a traduit en latín le
traité de Xénophon
De re equeftri.
Ce qu'il y a de
certain, c'eíl: q\Je
l'inv~rition
des
étriers
att~chés
aux
felles n'eíl: venue que depnis le fiecle de Théodofe.
On n'en voit jamais dan. les figures des cavaliers des
anciens tem . Preuve encore qu'il n'y avoi_t point
d'
étriers
dans ces fiecles, c'eft que ni les Grecs, ni
les Latins n'ont jamais eu de nom pour
fignifi. ~ r
un
ürier. Yoyez
Mémoires de l'académie des infcriptions,
tome
XI11,
in-
4
°.
Lettres Jur
L'
E ncyclopédie.
ETRIER,
f.
m. (
terme
de
Blafon,)
meuhle d'ar–
Tome
JI.
ETR
moiries'
íl
repréfente
l'étrier
qui fert a montera
che–
val.
L'ufage des
étriers
n'étoit point connn du tems des
anciens tournois
&
des croifades; on fe fervoit alors
de fautoirs qui étoient des cordons couverts d'une
riche étoífe.
De Noirefontaine du Buiífon, en Champagne;
de
gueules
a
trois étriers
d'
or.
(
G. D.
L.
T.
)
ÉTRUSQUES,
(Hifl. des Arts.)
Nous allons don–
ner un extrait des favantes ohfervations que M. le
comte de Caylus
a,
inférées dans les deux premiers
volumes,
in-4°.
de fes
Refueils des Antiquités égyp–
tiennes_, étrufques, grecques
&
romaines:
a
París , chez
De:ífamt ,
17 52 ,
7 11ol.
Ce judicieux
&
profond au–
teur convient qu'il efr tres- difficile de trouver des fe–
cours pour connoitre l'origine des
Etrufques
ou Tof–
can?, paree
qu'~ucun
de leurs hifroriens
n~eft
parve–
nu Jufqu'a nous;
&
quoique ce peuple fameux fe fut
r~ndu
maitre de prefque toute l'Italie avant la fonda–
tton de Rome, la jaloufie de Romains a l·aiíft' avec
peine fubfifier quelques infcriptions, que nous rie
pouvons pas toujours expliquer , paree que nous
tgnorons non-feulement le fond de leur langue, mais
encore la plupart des lettres de leur alphabet:
il
paroit
meme que les hiíl:oriens Romains o·nt aífeélé de ne
point parler des
Etrufques,
&
que
nous
ne pouvons
découvrir leur goftt
&
quelques- uns des ufages de
cet ancien peuple, que par Je moyen des peintures
&
des gravures qui ont échappé
a
la main des Romains.
Nous favons en gros par les écrirs des hifroriens
étrangers, que pendant pluíieurs fi ecles les
Etrufques
furent tres-puiíi'ans fur terre
&
fur mer: le commerce
les enriehit, dans la fui te le luxe les énerva o u les
rendit aílez foibles pour devoir etre fubju gués par les
Gaulois
&
p ar les Romains, apres avoir cependant
foutenu, pendant deux fiecles, des guerres con–
tinuelles: l'hiíl:oire démonrre, quoi qn'en difent les
fophifl:es du fi ecle , que le luxe
a
amolti &fait boule–
verfer l'empire des Egyptiens, des Perfes, des Grecs
&
des Romains.
Les
Etrufques
infpirerent
a
leurs vainqueurs leur
fuperílition extr"me
&
h.urgo{'tt pour les fpeétacles.
Les petites notions que les
E
trufques
avoient fur la
~hyfique·,
les engagerent a croire qu'ils étoient aífez
fa ans pour pénétrer dans les myfieres des caufes
premieres;en conféq tence ils s'occuperent p rpétuel–
lement
a
dkher delire dans !'avenir
&
le livre des
deflinées, en ohfervant
le
vol &
le
chant des oifeaux •
&
a
confulter la volonté des dieux en oh{; rvant les
aíl:res ou les enrrailles des viélimes. Comme -:e peu–
ple aimoit exceffivemen les jeux, la mufique
&
les
fpeétacl es , il introduifit
ces
amufemens dans les céré–
monies de la relígion,
&
le préjugé populaire les fit
enfuite conftdérer comme des parties e:ífentielles du
culte extérieur. Ce
merne
préjug~
fuhfifte encore
dans une partie de l'Italie.
Les
Etrufques
aimerent les arts, ils les cultiverent
avec fucces
:
on préfume qu'ils emprunterent des
Egyptiens la théorie
&
la pratique de leurs ufages:
par exemple, les figures allegoriques ou hiérogly–
phiques , telles que font les griffons , les fphynx, les
lions ailés, les pyramides, les infcriptions fur le íl:a–
tues ,
&
la forme roide des figures qui paroi1rent
emmaillotées. Cependant comme l'on ne tro u e chez
les
Etrufques
aucune momie ou animal embaumé,
les auteurs préfument que ce peuple n'eíl: pas une
colonie Egyptienne.
Il
paroit par les monumens que,
dans les fiecles fuivans, les
Etrufques
prirent des ufa–
ges particuliers,qui ne conferverent pr
[
qu
a~cun
trait
de la maniere ou du fryle des anc1ens
Egyptt~ns:
on
voit dans les ouvrages de leurs fe u
1
preurs ,.c1feleurs
&
peintres, le d 'veloppement
&
la gradauon
feníi~
bies du génie des
Etrufques.
Les auteurs ohfervent que les femmes furent
XX
XXX
ij
















