
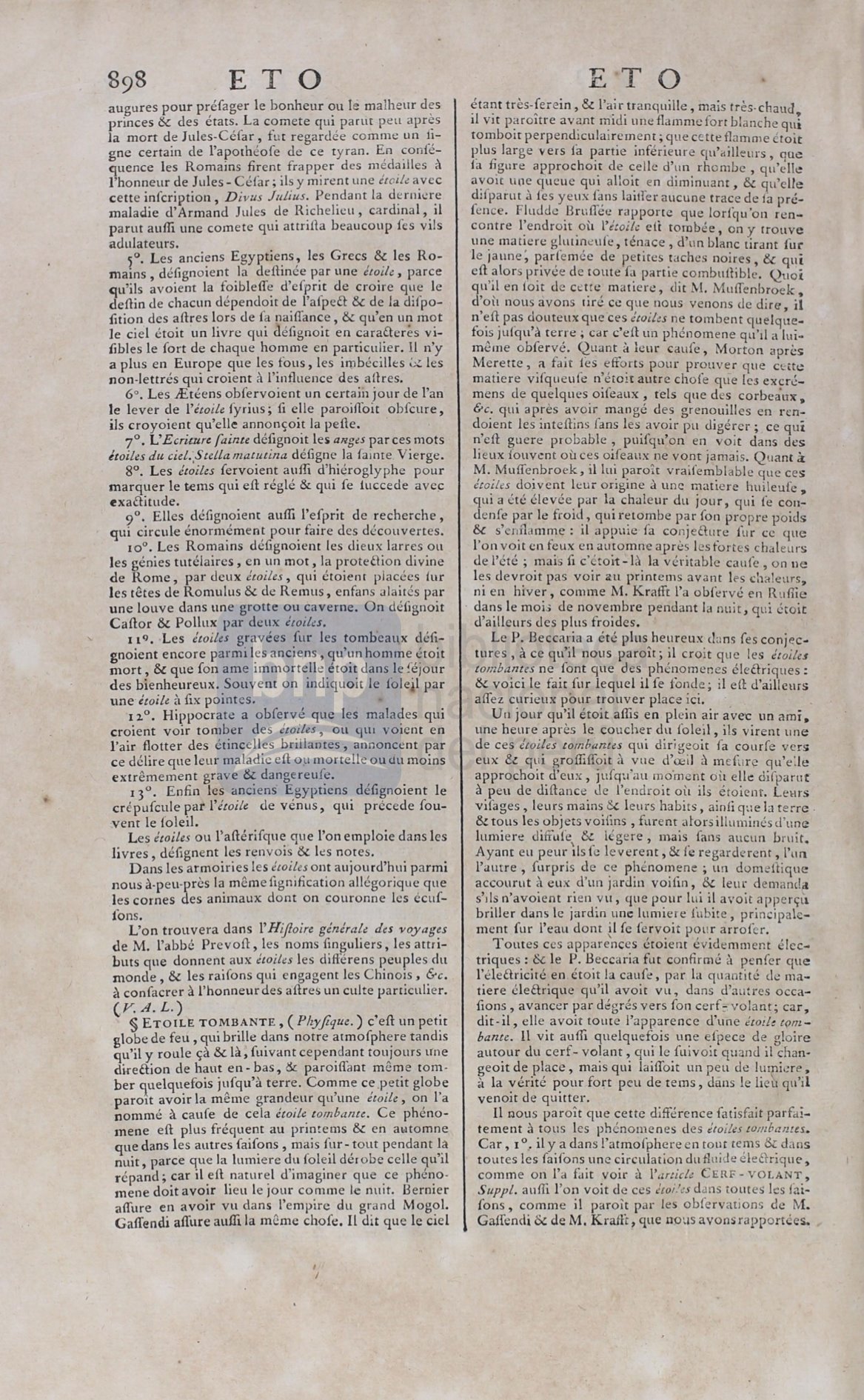
. E T O
augures pour
p~éfager
le bonheur <?u
lé
malheur
d~s
princes
&
des etats. La comete
qm
pantt peu apres
la mort de Jules-Céfar, fut regardée comme un
fi–
gne certain ele l'apothéofe de ce tyran. E,n
~onfé
quence les Romains firent frapper des medatlles a
l'honneur de
J
ules- Céütr; ils y mirent une
étoiü
ave e
cette infcription,
Divus Julius:
Pe~dant
la
d~rnier~
maladie d'Armand Jules de R1cheheu, cardmal,
Il
parut auffi une comete qui attrifia beaucoup fes vils
adulateurs.
5°. Les anciens Egyptiens, les Grecs
&
les
Ro–
rnains , déftgnoient _la
defti~ée p~r
une
ét~ile,
paree
qu'ils avoient la
f?1bleíf~
d efP,nt de crone ql:e le
defiin de chacun dependOit de
1
afpeél:
&
de la d1fpo–
íition des afires lors de fa naiífance,
&
qu'en un mot
le ciel étoit ·un livre qui déftgnoit en caraél:erés vi–
íibles le fort de chaque homme en
particuli.er.
ll
n'y
a
plus en Europe que les fous, les il{lbécilles
lx.
le.s
non-lettrés qui croient a l'influence des aíl:res.
6°.
Les 1Etéens obfervoient un cerrain jour de l'an
le lever de
1'
étoi.lefyrius; fi elle paroiíloir obfcure,
ils croyoienr qu'elle annons:oit la pefie.
7°.
L'Ecrit:ure fainte
défignoit les
anges
parees mots
étoiles du ciel.,Stetlamatutina
défigne la fainre Vierge.
8°.
Les
étoiles
fervoient auffi d'hiéroglyphe pour
marquer le tems qui eft réglé
&
qui fe fuccede aves;
exaél:itude.
9
o.
Elles déftgnoient auffi l'efprit de recherche,
qui
circule énormément pour faire des découvertes.
1
o
0
•
Les Romains déíignoiem les dieux !arres
OLL
les génies tutélaires, en un mot, la proteélion divine
de Rome, par deux
étoiles,
qui
~toient
placées íur
les tetes de Romulus
&
de Remus, enfans alairés par
une louve dans une grotte ou caverne. On déíignoit
Cafior
&
Pollux par deux
étoiles.
1 t9.
Les
étoiles
gravé
es
fur les tomheat\X
déíi–
gnoient encore parmi les anciens, qu'un homme éroit
mort,
&
que fon ame immortelle étoit dans le féjour
des bienheureux. Souvent on indiquoit
le
íoleil par
une·
étoile
a
íix
pointes.
1 2
°.
Hippocrate a
obfer~é
que les malades qui
croient voir tomber des
étoiles,
on qu1 voient en
l'air flotter des étincelles brillantes ·, annoncent par
ce délire que leur maladie eíl: ou mortelle oudu moins
extremement grave
&
dangereufe.
1
3°.
Enfin les anciens· Egyptiens déftgnoient le
crépufcule par
1'
étoile
de vénus, qui précede fou–
·vent le foleil.
Les
étoiles
ou raíl:érifque que l'on emploie dans les
lívres défignent les renvois
&
les notes.
Da~s
les armoiries les
étoiles
ont aujourd'hui parmi
nous a-peu-pres la meme íignification allégorique que
les cornes des animaux dont on couronne les écuf–
fons.
L'on trouvera dans
1'
Hijloire généraltt-
des
voyages
<le
M.
l'abbé Prevofi, les noms finguliers, les attri–
buts que donnent aux
étoiles
les différens peuples du
monde,
&
les raifons qui engagent les Chinois,
&c.
a
confacrer a l'honneurdes afires un culte panicnlier.
(V.
A. L.)
§
ETOILI?. TOMBANTE, (
Phyjique.)
c'efi un petit
globe de feu, qui brille
~ans
notre
atmofph~re
tandis
qu'il y roule c;a
&
la, fUivant
cepe~d~nt tol~ours
trne
direél:ion de haut en- bas,
&
par01ffant meme tom–
ber c¡uelquefois jufqu'a terre. Comme ce petit globe
parOit avoir la meme grandeur qu'une
éteile,
on l'a
nommé
a
caufe de cela
étoile lOf!lbante.
Ce phéno–
rnene eft plus fréquent au priotems
&
en awtomne
que dans les autres
fai~ons,
mais
~ur-,tout
pendant
~-a
nuit paree que la lum1ere du folell derobe celle qu
1l
répa'nd; car
il
eft naturel d'imaginer que ce
phéno~
mene doit avoir lieu le jour eomme
le nnit.
Bernier
aífure en avoir vu dans l'empire
du
grand Mogol.
Gaffendi affure
auffi la meme chofe. Il dit que le ciel
,
1
ETO
étant tres-ferein,
&
l'a1
r tranquille, mais
tres-
chaucl
íl vit paroitre avant midi une flamme forr blanche
gtJ
tomboir perpend!culairernent; que eette t1amme ' toit
l?lus Iarge vers
Úl
~artie
inférieure qu'ailleurs,
que
ía fi.gure a12prochot_r
d7
~elle
d'un rhombe,
qu'ell~
ayou
llll~
queue qm aLo1t en diminuanr,
&
qu'elle
d1fparut
a
fes yeux
f~ns
laitfer aucune trace de fa pré–
fence. Fludde Bruífee rappone que lorfqu 'on ren–
contre
l~endroit
_oil
l'étoi~~;
eíi tombée,
on
y rrouve
une mat1ere glunneufe, tenace, d'un blanc tirant fur
1e jaune;
~ar,Cemée
de perites _raches noires,
&
qui
eft alors pnvee de route fa partte combuftible.
Quoi
qu'il en foit de cette matiere, dit
M.
Muífenbroek
d ' \
.
1
,
ou nous avons ure ce que nous venons de di
re~
il
n'~~
pas
~outeux
que
·ce,s
étoites
n~
tombent quelque–
fOis JUfqu
a
terre; car e efi un phenomene qu'tl a Iui–
meme obfervé. Quant
a
leur caufe, Morton apres
Me~ette,
_a
fait fes
,~ff~rts
pour pronver que cette
mat1ere vtfqueufe n etolt autre chofe que les excré–
mens de quelques oifeaux, t'els que d
s
corbeaux
&c.
qui apres avoir mangé des grenouilles
en ren:
doient les intefiins fans les avoir
pu
digérer ; ce qui
n'cft guere probable , puifqu'on en voit dans des
líeux {ouvent ou ces oifeaux ne vont jamais. Quanr
a
~· .MuKe~broek_, illu~ ~aro1t
vraifem?Iable que ces
etotfes
dO.lVent leur ongme
a
une mat1ere huileufe
qui a été élevée_ par
1~
chaleur du jour, qui fe con:
denfe par le fro1d, qm retombe par fon propre poids
&
s' nflamme:
il
appuie· fa conjeéture fur ce que
l'on voit en feux en automne a_pres les tortes chaleurs
del'été; mais fi
e'
' toit-la la véritable caufe,
on ne
les devroit pas voir
au
printems avant les chaleurs,
ni en hiver, comme M. Krafft l'a ob{ervé en
Ruffie
· dans le mois de novembre pendant
la nuit,
qui
écoic
d'ailleurs des plus froides.
Le
P~
Becca,t:ia a été
plus"he~treux.
chns fes
conj~c
tures, a ce qu tl nous paro1t;
1l
crolt que les
étoile:~
tombames
ne font que des phénomenes élethiques:
&
voici le fait fur lequel
il
fe fonde; il
e
O:
d'ail!eurs
aífez curieux pour trouver place ici.
.
,
Un jour qu'il étoit affis en plein air ave'C un ami •
une beure apres le_eoucher du foleil,
i1s
virent une
de ces
étoiles tombantes
qui dirigeoit fa courfe
ver.~
eux
{!-{.
qui
groffiífoit
a
vue d'rei]
a
mefur~
qu'e:le
approchoit d'eux, jufqu'au mo·ment
oü
elle difparut"
a
peu de difiance Je l'endroit
Oll
ils étoient. LeHrS
vifages
~
leurs mains
&
leurs habits, ainíi
que la
terre .
&tous
les
objetsvoiüns, furent atorsilluminésd'unc:
lumiere dittufe
&
légere, mais fans aucun
bruit..
Ayant en peur
~ls
fe leverent,
&
fe regarderent, l'un
l'autre, furpris de ce
ph
'nomene ;
un
domei1ique
accourut
a
eux d'un jardín voifin,
&
leur demandé'
s'ils n'avoient ríen
vu,
que pour lui il avoit
apper~u
briller dans
le
jardin une lumiere fubite,
principal~ment fur l'eat.l dont il fe fervoit pour arrofer.
Toutes ces apparences étoient évidemment élec...
triques:
&
le
P.
Beccaria fut confirmé
a
penfer
que
l'éleél:ricité en étoit la caufe, par
la
quantité
el
ma–
tiere éleétrique qu'il avoit vu, dans d'autres occa–
fions, avancer par d"égrés vers fon cerf= volant; car,
dit-il, elle avoit tome l'apparence d'une
étoile t(Jm–
bante.
ll
vit auffi quelquefois une efpece de gloire
autour du cerf- volant, qui. le fuivoit quand il
~han~
geoit de place, mais qui laiífoit un pe
u
de luxpiere,
á
la vérité
pouLfo.rtpeu de te
m~,
dans le
lieu
qn'il
venoir de quicter.
I1
tlOUS
paroit que cette différence fatisfait parfai–
tement
a
tQUS les phénomenes des
éfoíles
tombames..
Car,
1°.
il y a dans l'atmofphere en
tour
tems
&
dans
toutes les faifons une circulation du
fluid
e éleéhique,
comme on l'a fait voir
a
1'
article
CERF- VOLANT,
Suppl.
au.ffi l'on voit de ces
étoi.'es
dans
tomes les
úü–
[ons,
comme
il
paroit par les obfervations
de M.
Gaffendi
&
de M. Krafft? qne npus a vons
ra
pport
'es~
















