
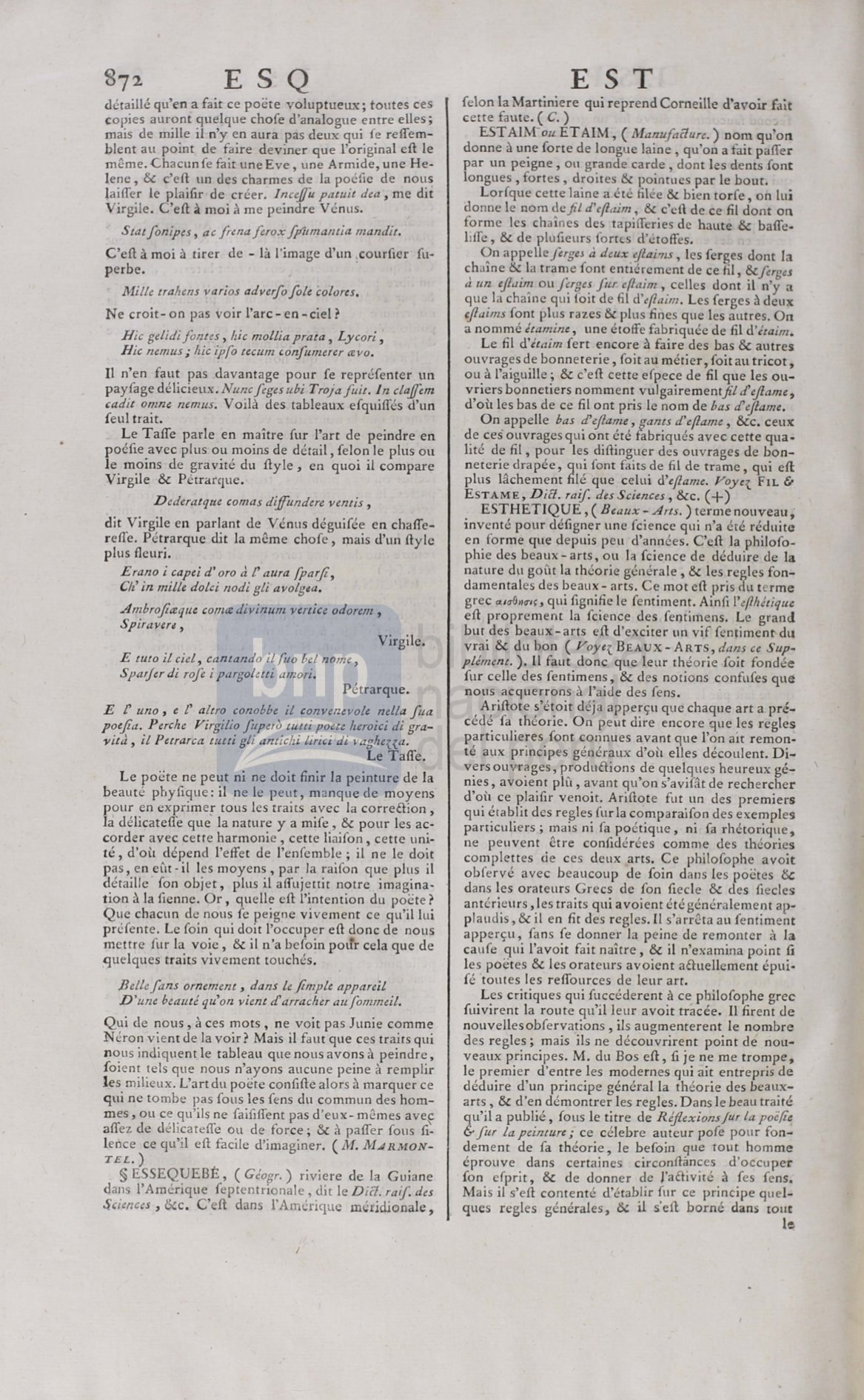
ESQ
d
1
raillé qu' na fait ce poete voluptueux; toutes ces
copies auront quelque chofe d'analogue entre elles;
mais de mille
il
n'y en aura pas deux qui fe reffem–
blent au point de faire deviner que !'original eíl: le
m "me. .Chacun fe fait une Eve, une Armide, une He–
lene,
&
c'eft
un
des channes de
la
poéi1e de nous
laiífer le plaifir de créer.
lncef{u patuit dea,
me dit
irgile. C'efi
a
moi
a
me peindre
V
énus.
Stat fonipes, ae frma firox f¡lítmantia mandit.
C'efi
a
moi
a
tirer de -
la
l'image d'un :courfier fu–
perbe.
Mille trahens varios adverfo fole colores.
N
e croit- on pas voir l'arc- en- ciel?
Hic gelidi font es, lzic mollia prata, Lycori,
Hic nemus; hic ipfo tecum Gonfu.merer awo.
11
n'en faut pas davantage pour fe repréfenter un
payfage délicieux.
N
une feges ubi Trojafuit.
ln
claffim
cadit omn' nemus.
Voila des tableaux efquiítls d'un
feul trait.
Le Taífe parle en maitre fur l'art de peindre en
poéfie avec plus o u moins de détail, felon le plus on
le moíns de gravité du ftyle
~
en quoi
il
compare
V
irgile
&
P ' trarque.
Dederatqtte comas dijfundere yentis,
dit Virgüe en parlant de
V
énus déguifée en chaífe–
reífe. Pétrarque dit la meme chofe, mais d'un fiyle
plus fleuri.
E
rano
i
capei d, oro
aL'
aura fparji,
Ch'
in mille dolci nodi gli avoLgea.
Ambrofiaque coma divinum vereice odorem,
Spiraverl$,
Virgile.
E
tuto il ciel, cantando il fuo
bel
nome,
Sparfer di ro
fe
i
pargoletti amori.
Pétrarque.
E
l'
uno
,
e
L'
altro conobbe iL convenevole nella foa
porfia. Perche Virgilio fupero tutti poete heroici
di
gra–
yita, iL Petrarca tutti gli anticlzi tirici di vaghe{{a.
Le Taífe.
Le poete ne peut ni ne doit finir la peinture de la
beaut' pbyíique: il ne le peut, manque de moyens
pour en exprimer tous les traits avec la correélion,
la d 'licateífe que la nature y a mife,
&
pour les ac–
corder avec cette harmonie, cette liaifon, cette uní–
té, d'oi1 dépend l'effet de l'enfemble; il ne le doit
pas, en efu- il les moyens , par la raifon que plus il
détaille fon objet, plus il aífujettit notre imagina·
tion
a
la fienne. Or, quelle efi l'intention du poete?
Que chacun de nous fe peigne vivement ce qu'illui
préfente. Le foin qui doit l'occuper eíl: done de nous
rnettre fur la voie ,
&
il n 'a befoin pour cela que de
quelques traits viv.ement touchés.
B
ellefans ornement
,
dans Le jimple appareil
D'une beauté qu'on vient d'arracher au fommeil.
Qui de nous,
a
ces mots, ne voit pas Junie comme
N
1
ron vient de la voir? Mais il faut que ces trairs qui
nous indiquent le tablea u que nous a vons
a
peindre,
foient tels que nous n'ayons aucune peine
a
remplir
les milieux. L'art du poete confifte alors
a
marquer ce
qui ne tombe pas fous les fens du commun des hom–
mes, ou ce qu'ils ne faifiífent pas d'eux- m "mes avec
aífez de d ' lica teífe ou de force;
&
a
paífer fous
fi.
lence ce qu'il eft facile d'imaginer.
(M. M..t
RMON–
TEL.)
§
ESSEQUEBÉ, (
Géogr.)
riviere de la Guiane
dans
1'
Amérique fepten triona le, dit le
D i fl. raif. des
S cienc s
~&c.
C'eft dans l'Am 'rique m ' ridionale,
EST
felon la Martiniere qui reprend Corneille d'avoir
fait
e tte faut .
(C.)
ESTAIM
ou
ETAIM,
e
11-fanufi.aur
. ) nom qu'on
donne
a
une forte de longue laine ' qu'on a
fait
paífer
par un peigne, ou grande carde, dont les dents font
longues , forres , droites
&
poinru s par le bout.
Lorfque cette laine a
' e'
fil
e
&
bien torfe, on
[uj
donne le nom
defil d'eflaim'
&
e'
a
de ce fil dont on
forme les chaines des tapiít ries de haute
&
baífe..
liífe,
&
de pluúeurs forrc.s
d' ·
roffes.
On appelle
firgeJ
a
deux iflai·n.s,
les ferges dont
la
chaine
&
la trame font enti
' r
ment de ce
fil,
&ferges
a
un e.flaim
ou
ferges fur eflaim
' celles dont
il
n'y
a
que la chaine qui foit de fil
d'eflaim.
Les ferges
a
deux
ejlaims
font plus razes
&
plus fines que les autres. On
a nommé
étamine,
une étoffe fabriquée de
fil
d'
écaim.
Le fil
d
'étn.imfert encore
a
faire des has
&
autres
ouvrages de bonneterie, foit a
u
métier, foit a
u
tricot,
Olla
l'aiguille;
&
c'efr Cette efpece de fil que les
OU–
vrÍers bonnetiers nomment vulgairementfil
d'
e.flame,
d'oirles bas de ce fil ont pris le no
m
debas d'ejlame.
On appelle
bas d'ejlame, gants d'eflame,
&c. ceux
de ces ouvrages qui onr été fabriqués ave
e
cette qua·
lité de fil, pour les difiinguer des ouvrages de bon–
neterie drapée, qni font faits de
fil
de trame, qui efl:
plus lachement filé que celui
d'eflame. Voyez
FIL
&
ESTAM E,
Dia. raif. des Sciences'
&c.
e+)
ESTHETIQUE, (
Beaux- Arts.)
terme nouveau,
inventé pour défigner une fcience qui n'a été réduite
en forme que depuis peu d'années. C'efi la philofo–
phie des beaux- arts, o u la fcience de déduire de la
nature du goftt la rh 'orie générale ,
&
les regles fon–
damentales des beaux- arts. Ce mot eíl: pris du terme
grec
ct.lafJnlít~,
qui fignifie le fentiment. Ainfi
1'
4lhétique
eíl: proprement la fcience des fentimens. Le granel
bur des beaux- arts
e.íl: d'excirer un vif
{¡
ntimenf' du
vrai
&
du bon (
VoyezBEAUX-ARTS,dans ce Sup–
ptément.
). ll faut done que leur théorie foit fondée
fur celle des fentimens,
&
des notions confnfes que
nous acquerrons
a
l'aide des fens.
'
Ariftote s'étoit déja
apper~u
que chaque arta pré–
cédé fa théorie. On peut dire encore que les regles
particulieres font connues avant que l'on aít remon–
té aux principes généraux d'oi1 elles découlent. Di–
vers ouvrages, produétions de quelques heureux gé–
nies, avoient plf1, avant qu'on s'aviült de rechercher
d'ou ce plaifir venoit. Ariíl:ote fut un des premiers
qui érablit des regles fur la comparaifon des exemples
parriculiers ; mais ni fa poétique, ni fa rhétorique,
ne peuvent etre confidérées comme des th
1
ories
complettes de ces deux arts. Ce philofophe avoit
obfervé avec beaucoup de foin dans les poetes
&
dans les orateurs Grecs de fon fiecle
&
des fiecles
antérieurs, les traits qui a voient été généralement
ap~
plaudis,
&
il
en fit des regles.
Il
s'arreta au fentiment
apper~u'
fans fe donner la peine de remonter
a
la
caufe qui l'avoit fait naitre,
&
il n'examina point
fi
les poetes
&
les orateurs avoient aétuellement épui·
fé toutes les reífources de leur art.
Les critiques qui fuccéderent
a
ce pbilofophe grec
fuivirent la route qu'illeur avoit tracée. 11 firent de
nouvelles obfervations , ils augmenterent le nombre
des regles; maís ils ne découvrirenr point de nou–
veaux príncipes. M. du Bos efi, fije neme trompe,
le premier d'entre les modernes qui ait entrepris de
déduire d'un príncipe généralla théorie des beaux–
arts,
&
d'en démontrer les regles. Dans le beau traité
qu'il a publié, {ous le titre de
Rijlexionsjur La poe{ie
&
fur La
peintu.re;
ce célebre auteur pofe pour fon–
dement
de fa théorie, le befoin que tout homme
éprouve dans certaines circoníl<'mces d'occuper
fon efprit'
&
de donner de J'aélivité
a
fes fens.
Mais il s'efr comenté d'établir fnr ce príncipe quel–
ques regles générales,
&
i1
s'eft borné dans tout
le
















