
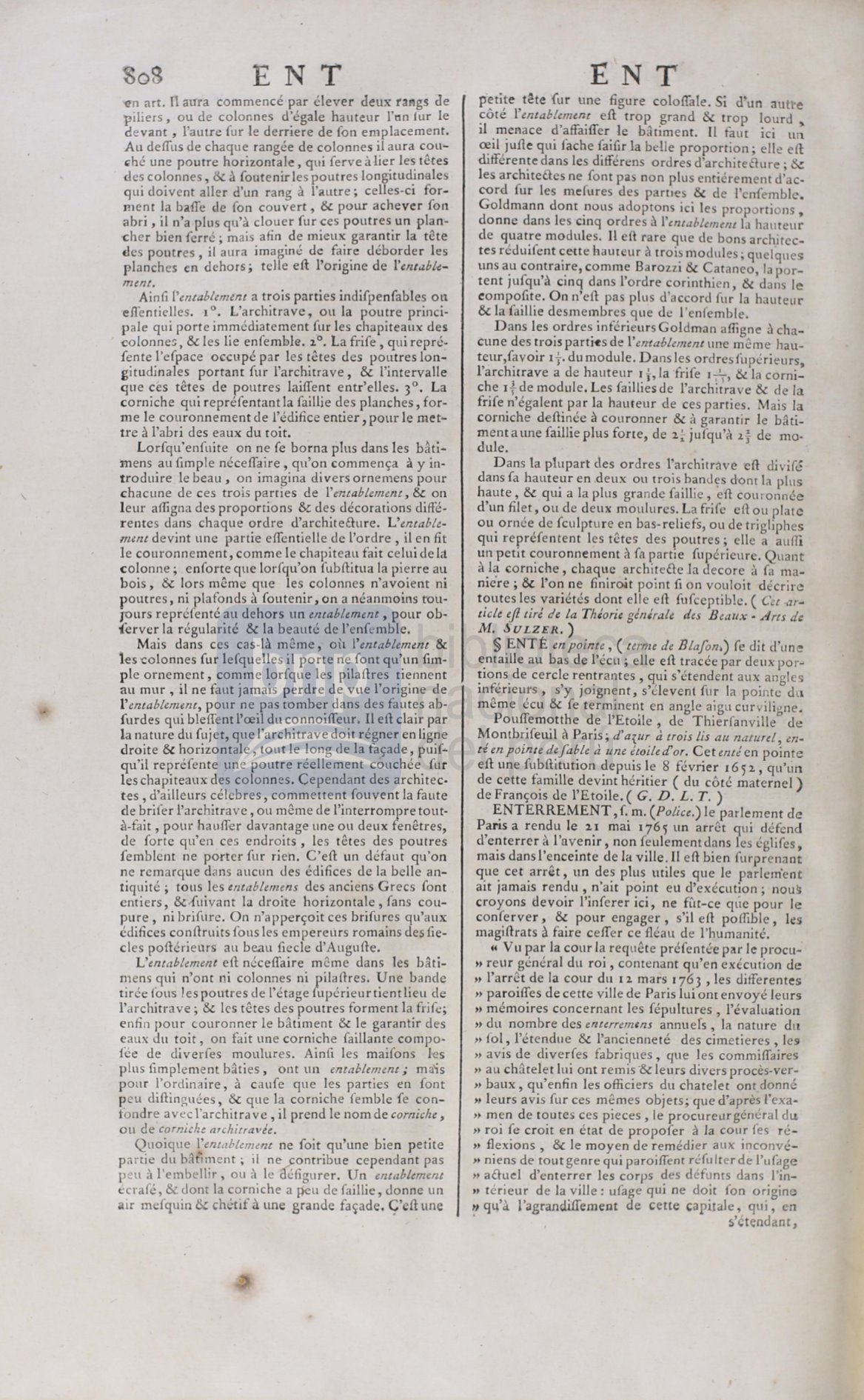
o
ENT
<!n art.
r1
atrra commencé par 'le er
deux ra ·
g
de
p1hers , ou de colonnes d'égale hau eur 1nn
lur
le
devane , l'autre fur le derriere de on emplacement.
A
u
deífus de chaque rang 'e de colonoes
il
aura cou–
"hé une poutre horizonrale, qui ferve
ftli
.r
le~
tAtes
d
S
colonnes,
&
a foutenir les poutres longttud!oole
qui
doivent aller d un rang a l'autre; celles-c1 for–
menr la baífe de fon couvert,
&
pour achever fon
abrí,
il
n'a plus qu'a clouer fur .ces poutres_un plan–
-cher bien{; rré; mais a fin de m1eux garanttr la tete
d
s poutres
il
aura imagin
1
de faire déborder les
planches n' dehor5; telle eft !'origine de
l'entabl-r:--.
ment.
Ainfi
l'entablement
a trois parties indifpenfables ou
elfentielles.
1°.
L'architrave o
u
la poutre princi–
pale qui porte immédiatement fur les chapiteaux des
colonne~,
&
les lie enfemble.
2°.
La frife, qui
repré~
{ente l'efpace occupé par les tetes des poutres lon–
gitudinales portanr fur
1
architrave,
&
l'intervalle
que ces tetes de poutres laiíient entr'elles.
3°.
La
corniche qui repréfentant la faillie des planches, for–
me le couronnement de l'édifice entier, ponr le met–
tre a l'abri des eaux du roit.
Lorfqu'enfuire on ne fe borna plus daos les bati·
mens au íimple n
1
ceífaire, qu'on
commen~a
a
y in–
troduire le beau, on imagina divers ornemens pour
chacune de ces trois parties de
l'entablement,
&
on
leur aíiigna des proportions
&
des décorations diffé–
rentes dans chaque ordre d'architetl:ure. L'
entable–
ment
devint une partie eífentielle de l'ordre,
il
en fit
le couronnement, comme le chapiteau fair celui de
la
colonne; enforte que lorfqu'on fubftitua la pierre au
bois,
&
lors mAme que les colonnes n'avoient ni
poutres' ni plafonds a foutenir' on a néanmoins tou–
jours repréfenté au dehors un
entablement,
pour ob–
{erver la régularité
&
la beauté de l'enfemble.
Mais
dans ces cas-la meme, oü
l'entablement
&
1es 'Colonnes fur lefquelles il porte ne font qu'un íim–
ple ornement, comme lorfque les pilafires riennent
au mur,
il
ne faut jamais perdre de vue !'origine de
l'entablemene,
pour ne pas tomber dans des fautes ab–
furdes qui bleífent l'reil du connoiífeur.
Il
efi: clair par
la
nature du fu jet, que l'architrave do
ir
régner en ligoe
droite
&
horizontale, to ur le long de la fac;ade, puif·
qu'il repréfente une poutre réellement couchée fur
les chapiteaux des colonnes. Cependant des archirec–
tes, d'ailleurs célebres, commettent fouvent la fa
u
te
de brifer i'architrave' ou meme de l'interrompretout–
a-fait' pollr hauffi
r
davantage une ou deux fenetres,
de forre qu'en ces endroits, les tetes des poutres
femblent ne poner fur ríen. C'efi: un défaut qu'on
ne remarque daos aucun des édifices de la belle an–
tiquité; tous les
entablemens
des anciens Grecs font
entiers, &,fuivant
la
droite horizontale, fans cou–
pure, ni brifure. On
n'apper~oit
ces brifurcs qu'aux
édifices confiruits fous les empereurs rornains des íie–
cles poft 'rietlrs a
u
beau fiecle d'Augufie.
L'entabüment
eft n 'ceífaire
m
eme dans les bati–
mens qui n'onc
1
i colonnes ni pilafires. Une bande
tirée (ous espoutres de l'étage fupérieurtientlieu de
1
archirra
e;
&
les tetes des poutres formenr la fri{; ;
enfin pour couronner le batiment
&
le garan ir des
eaux du toit, on fait une corniche faillante compo–
f
e de di erfes moulures. Ainíi les maifons
les
plus íimplement baties , ont un
emablemmt ;
ma'is
onr l'ordin Íre
a
caufe que ]e partÍ
S
en font
p
u
difringuée ,
que la corniche femble fe con–
fondre a e l'architra ve,
il
prend le nomde
corniche,
ou de
corni he m hitral'te.
uoique
l
emablermnt
ne foit qu une bien pe tite
p
rtie duba menr ·
tl
ne contribue cependant pas
e
1
a
l'embetrr ou
a
le
d
' figurer.
n
entablement
era(' ,
&
dont la corniche a
peu
de faillie, donne un
lr
m (quin
r
'h
tl
un grande fa<¡ade.
<;
fi
une
EN
¡ye ite tete fur
n
figure cololfa[e.
1
u
a
1
t
·e
~Ót
'
l
ntabl~nun_t
fi
trop grand
' trop
lot rd
~
1l
m nace d
affa~íier
1
h<himent.
ll
tam
i i
u1
1
~il
)ufle
qui
fache
~aifir
la b ·!le proponion ·
lle
{t
diffi
reme dan le diff¡ ren ordre d'ar hite ur ·
'r
les archite
s ne font pa non plus enr· reme
m
d.'
~
cord fur les mefures des parue
de
l
nfembl •
Goldmann dont nou adopten i i le
roporti ns
donn dans les cinq ordres
l
entu_bl ment
l..t
hat teu;
de quatre modules.
11
e
l
rare que de bon archttcc–
tes r
1
duifent :eue
R
LH
ur
a
troi_ module ; quelques
uns a.u
co
~trat.re,
comme
B
rozz1
&
Caraneo,
la
por–
tent Jufq
u a cmqdans l ordre corinrhien
&
dan le
eompofite. On n'efi: pas plu d'accord fu;
la
hauteur
&
la faillie desmernbres que
d
l'enfemble.
Daos les ordre infi' rieurs Goldman affigne ¡)eh
a–
cune des trois
parti~s
de
1'
enta!Jl ment
une ml;me hau–
t;ur,f~voir
xf.
du module. Dans le. ordr
fupaieurs,
1
archurave
a
d hauteur
r
j,
la fnfe
1
T-,
la corni–
che
If
de module. Les faillies de
1
archi;rave
de la
frife n'égalent par la hau{eur de ces partie . Mais
1
corniche deílinée
a
couronner &
a
gélrantir le
b~ti
ment
a
une faillie plus fone, de
2~
jufqu
a
2}-
d mo–
dule.
Dans la plupart des ordres
1
architrave
fi
di
ifé
daos fa hauteur en deux ou trois banue dont
la
plus
haute,
&
qui a la plus grande faillie, efi cou tono'
e
d'un filet, o
u
de deux moulures. La frife efi o
u
pi
re
ou ornée de fculpture en bas-reliefs, ou de trigliphes
qui repréfentenr les t"tes des potttres; elle
auffi
un petít couronnement
<l
fa partie fup
'ri
ur .
uant
a
la corniche' chaque archireéte
Ja
decore
a
[;
ma–
nie're;
&
l'on ne finiroit point íi on vouloit d 'crire
tout
esles variétés dont elle efi fufceptibl . (
C·t ar–
ticle
e.fltiré de la Théorie génírale
de
B lallx
•
Arts
d
M.
SULZER.)
§
ENTÉ
en pointe,
(
terrne de Blafon)
fe dit
d
un
~ntaille
au has de
1' ·
cu ; elle efi: tracée par
deux
po ·–
!IOns. de cercl,e
r~n~rantes
, q,ui s'
1
tend nt aux angl
s
mféneurs,
s
y
¡o1gnent, s'elevent fur la pointc dll
m
"me 'cu
&
fe terminent en angle aigu cur ili.,ne.
Pouífemotthe de l'Etoile , de Thierfanville
o
de
Montbrifeuil
a
París;
d' azur
a
trois Lis aa nauud, en..
ti
en poinre
d~fakle
a
une
~toiled'or;
Cet
ente'
en pointe
efi: une
fub!t~tut1on
depms le
8
fevrier
16
52,
qu'un
de cette famllle devint héritier ( du coté maternel)
de
Fran~ois
de l'Etoile. (
G. D. L. T.
)
~NTERREMENT,
f.
m.
(Police.)
le parlement
de
Pans
a
rendu
le
21
mai
176)
un arret qui défend
d'enterrer
a
l'nvenir' non feulement dans les églifes'
mais daos l'enceinte de
la
ville.
Il
eíl bien furprenant
que cet arret' un des plus uriles que le
arlem'ent
ait jamais rendu , n'ait point eu d'exécution;
nou~
croyons devoir l'inferer ici, ne fí'Ir-ce qúe pour le
conferver, & pour engager, s'il efi: poffible, les
magiíhats
a
faire ceJfer ce fléau de l'humanit,.
ce
V
u par la cour la requete préfent
1
e par le procu–
~)
reur
g
'néral
du
roi, contenant qu'en exécurion de
H
l'arret de la cour du
1 2
mars
176
3 ,
les differentes
,.,
paroiífes de cette ville de Paris lui o
m
envoyé leurs
~>
mémoires concernant les {¡lpultures, l'évaluacion
>t
dn nombre des
enurremtns
annuefs, la nature dn
,.
fol, l'étendue
&
l'ancienneré des cimetieres , les
»avis de diverfes fabriques, que le commilfaires
'' a
u
chatelet lui ont remis ·& leurs div rs proces-ver–
'' baux,
qu
enfin les officiers du chatelet onr donn
1
,..
leurs avis fur ces memes objets; que d'apres l'e. a–
)) men de toute ces pieces, le procureur général d
>>roí fe croit en 'rar de propofer
a
la
cour fe
e;
ré–
H
flexions
&
le moyen de remédier aux inconvé–
,.,
niens de toutgenre qui paroiffem refulterde l'ufage
aétuel d enterrer les corps des défunrs daos l'in–
'' t rieur de la ville: ufage qui ne doit fon origin
t)
qu'
l'agrandilfement
de
cette
capi ale
q u
en
s'
tendant,
















