
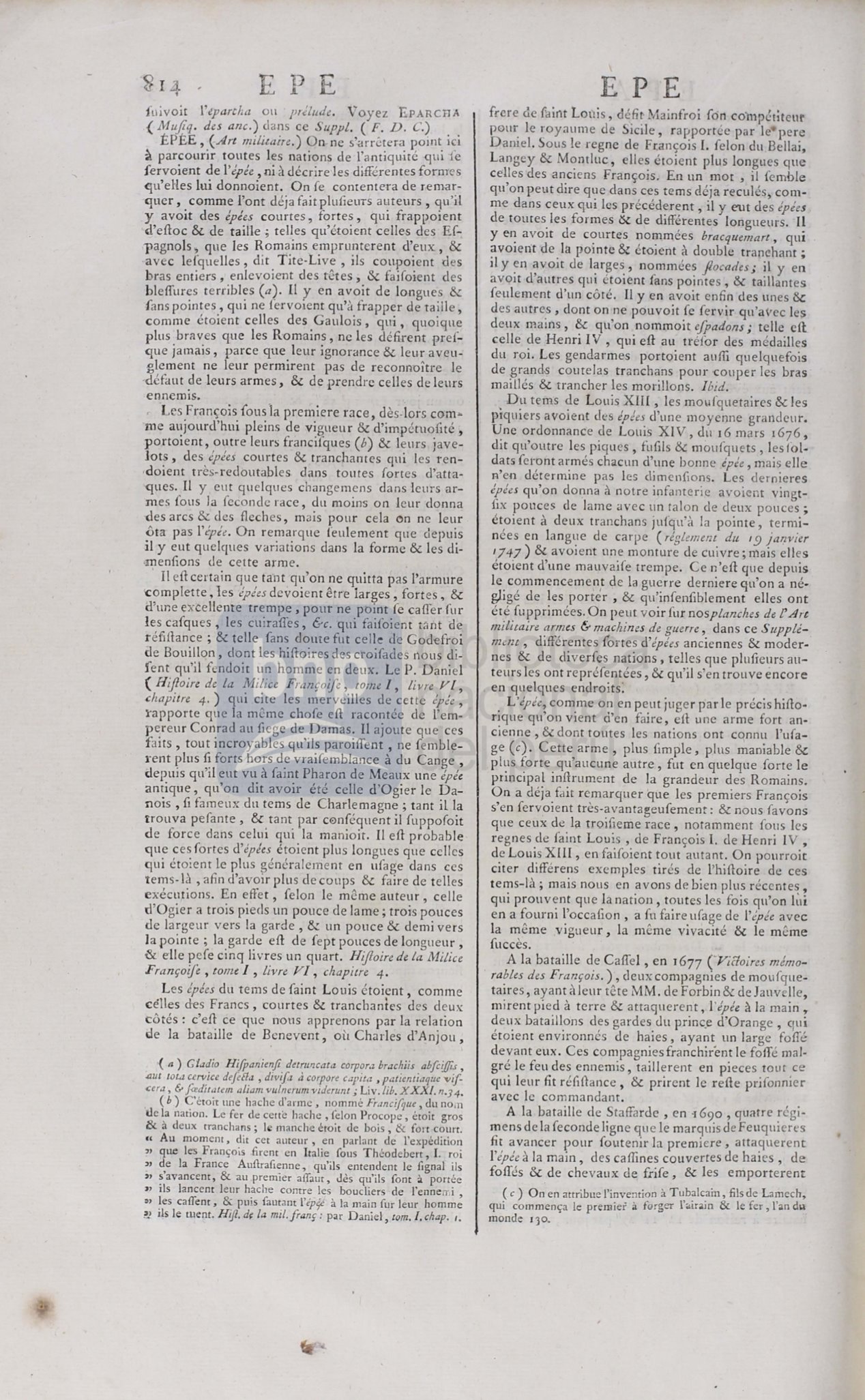
o
I4
EPE
fuivoit
1
tparcha
Olt
pr./Lude.
Voyez
EPARCH
A
{
Mufiq . des anc.)
dans ce
SuppL.
(
F. D . C.)
..
ÉPÉE,
(Art militaire.)
On-ne s-arr
"ter
a point.
1~1
2
parcourir tomes les nations ele l'antiquíté qm :ie
fervoient de
1'
épie
'ni
a
décrire les différentes formes
qu'eHes lui donnoient. On fe content era de remar–
quer, comme l'ont déja faitplufieuTs at!teurs, qu'il
y
avoit des
ipées
courtes, fortes, qlll frapp01ent
d'efioc
&
de taille ; telles qu' 'toient celles des Ef–
-pagnols, que les
~om?.ins
e_mpru?terent d'_eux ,
&
avec lefquelles, d1t.
Tite-Ltv~
, 1ls coupo:ent des
bras entiers, enlevo1ent des
t
tes>
&
fa1f01ent des
bleífures terribles
(a).
Il
y
en avoit de longues
&
fans pointes, qui ne fervoient qu'a frapper cle taille,
comme étoient celles des Gaulois, qui, quoiqne
plus braves que les Romaios, ne les défirent pref–
que jamais, paree que leur ignorance
&
leur aveu–
glement ne leur permirent pas de recoormltre le
-défaut de leurs armes,
&
de prendre celles de leurs
ennem1s.
Les Frans:ois {ous ·la premiere raee, des-lors com–
me aujourd'hni pleins de vigueur
&
d'impétuofité ,
portoient, outre leurs francifques
(b)
&
leurs jave–
lots, des
épées
courtes
&
tranchanres qui les ren–
·doient tres- redoutables clans toutes forres d'atta–
~ues.
I1
y
eut quelques changemens da ns leurs ar–
mes
fous Ja feconde race, du moins on leur donna
des ares
&
des fleches, mais pour cela en ne leur
óta pa-s
l'éple .
On
remarque feulement que depuis
il
y
eut quelques variations daos la forme
&
les di–
.rnenfions de cette arme.
Il efi certain que tant qu'on ne quitta pas l'armure
compiette, les
épées
devoient
~tr·e
larges, forres ,
&
d'ur.e excellente trempe, pour ne point fe caífer fur
les cafques , les cuiraífes, &c. qui faiíoient tailt de
r éfifiance ;
&
telle fans doute fut celle d·e Godefroi
de Bouiilon, dont les hifioires des ct·oifades nous dí–
fent qu'il fendoit un homme en deux. Le
P.
Dani el
(
Hifloire de La Milice Fran9oife
,
tome
1,
livre
r
1,
.chapitre
4·
)
qui cite les merveilles de cette
épée
,
tapporte que la meme chofe eíl: racontée de l'em–
pereur Conrad au fiege de Damas. Il ajoute que ces
faits, tout incroyables qu ils paroiífent , ne
fembl~rent plus fi forts hors de vraifemblance
a
du Cange ,
depuis qu'il eut vu
a
fa int Pharon de Meaux une
épée
antique, qu'on dit avoir été celle d'Ogier le Da–
nois , fi fameux dn tems de Charlemagne; tant illa
trouva pefante ,
&
tant par c0nféquent il fuppofoit
de force dans celui qui la manioit. 11 efi probable
que ces fort es
d'épées
étoient plus longues que cell es
qui étoient
Le
plus généralement en ufage dans ces
tems-la , afi n d'avoir plus de coups
&
faire de telles
exécufions. En effet , felon le meme auteur, celle
tl'Ogier a trois pieds un pouce de lame; trois pouces
de largeur vers la garde,
&
un pouce
&
demi vers
la pointe ; la garde efi de fept pouces de longueur,
&
elle pefe cinq livres un quart.
H ifloire de la MiLice
Fram;oife
,
tome
1
,
Livre
VI,
chapitre
4·
Les
épées
du tems de faint Louis étoient, comme
célles d-es Francs , courtes
&
tranchantes des deux
t:otés: c'eíl: ce que nous apprenons par la relation
cle la bataille de Bcnevent, ou Charles d'Anjou,
(
a
)
G
fadio Hifpanienfi detrurzcata corpor.z brachiis abfcijfzs
,
~Ut
IO!.d
c.ervice defefla
,
divifa
a
carpore capita , patÍentiaque
'q¡if–
cera,
&
f.a.dítatem aliam vuln rum viderunt;
Liv
.lib. X XXI.
n~J
4·
( b)
C'etoit une hache d'arme, nommé
Francifllue ,
du no,n
·u
e la nation. Le fer de cette hache , felon Procope, étoit gros
&
a
deux cranchans;
1
manche éroit de bois ,
&
forr courr.
ce
Au momem, dit cet auteur , en parlant
de
l'expédition
,, que les Franc;ois firem en Iralie fous Théodebert ,
l.
roi
:" de
la
France Auftraúenne., qu'ils entendem le ílgnal ils
,
s'avancem,
&
él.llpremier aífam, Jes qu'ils font
a
portée
,, ils lancem le
ur hache contre les bouclier de l'ennemi ,
;1)
les caífenr,
&:
pn's fautant
l'ép~
a
la main fur )eur homme
?l
ils le
Ulent.
Hijl.
d~
la mil.
frans:
par Daniel,
tQm.
l.
chap.
1.
EPE
frere de faint
Loü.is, défit .Jainfroi fon comp 'tite
u
pour le royau
me de
icile , rapporrée par le pere
Daniel. Sous le regne de Frans:ois
I.
felon du Bellai,
Langey
&
Montluc, elles étoient plus longues que
celles des anciens Frans:ois. En un mor , il femble
qu'on peut dire que dans ces
t~ms
d 'ja recul 's , com–
me dans ceux qui les précéderent, il
y
eut des
épées
de toures les formes
&
de différentes longueurs. Il
y
en avoit de courtes nommées
bracquemart,
qui
avoient de la. pointe
&
étoient
a
double tranehant;
il
y
en avoit de larges, nommées
jlocades ;
il
y
en
avoit d'antres qui étoient fans pointes ,
&
taillantes
fe·ulement d'un córé. Il y en avoit enfin des unes
&
des autres, dont on ne pouvoit fe fervir qu'avec les
deux mains,
&
qu'on nommoit
efpadons;
telle eft
celle de Henri
IV,
qui efi au tréfor des médailles
du roi. Les gendarmes portoient auffi quelquefois
de
grand~
-courelas tranchans pour coupe r les bras
maillés
&
trancher les morillons.
! bid.
Du tems de Louis
XIU,
les mol,lfquetaires
&
les
piquíers avoient des
épées
d'une moyenne grandeut.
Une ordonoance de Louis
XIV,
du
16
mars
1676 ,
dit qu'outre les piques , fufils
&
moufquets , les fol–
dats feront armés chacun d'une bonne
épée,
mais elle
R'en déterm.ine pas les dimeníions. Les dernieres
épées
qu'on dO!fna
a
notre infanterie avoient víngt–
fix pouces de lame (.JVec un talon de deux pouces ;
étoient
a
deux tranchans
juíqn'a
la poínte' termi–
nées en langue de carpe (
réglemem du
'9
)a7J.vier
1747)
&
avoi ent une monture de cuivre; rnais elles
étoient d'une mauvaífe trempe. Ce n'efi que depuis
le commencement de la guerre derniere qu'on a né–
gligé de les porter ,
&
qu'infenfiblement elles ont
été fupprimées. On peut voir fur nos
pLanches deL'.Art
militaire armes
&
machines de guerre,
dans ce
S upplé–
mem,
différentes (ones
d'ép ées
anciennes
&
moder–
nes
&
de diverfes nations, telles que plufiel;lrS au–
teurs les ont repréfentées,
&
qu'il s'en trouve encore
en quelques endroits:
.
L'épée,
comme on en peut juger parle précis hifio–
rique qu'on vient d'en faire, eíl une arme fort an–
cienne,
&
dont toutes les nations ont connu l'ufa–
ge
(e).
Cette arme, plus fimple, plus maniable
&
plus forte qu'aucune autre, fut en quelque forre le
principal infirument de la grandeur des Romains.
On a déja fait remarquer que les premiers Fran<;ois
s'en fervoi ent tres-avantageufement:
&
nous favons
que ceux de la troifieme race , notamment fons les
regnes de faint Louis , de Fran<_;:ois
l.
de Henri
IV ,
de Louis
XUI,
en faifoient tout autant. On pourro it
citer différens exemples tirés de l'hiítoire de ces
tems-la; mais nous en avons de bien plus
réc ente~ ,
qui prouvent que la nation, toutes les fois qu'on lui
en a fourni l'occaíion, a fu faireufage de
l'épée
avec
la meme vigueur' la meme vivacité
&
le m"me
fucces.
A
la bataille de Caífel , en 1677
C'ViCloires mémo–
rables des Frant;ois.),
deuxcompagnies de moufque–
taires , ayant
a
leur tete MM. de Forbin
&
de
Janv
lle,
mirent pied
a
terre
&
attaqnerent '
l'épée
a
la main'
deux bataillons des gardes du princ_e d Orange , qui
étoient environnés de haies, ayant un large foífé
devant eux.
Ces
compagniesfranchirentle foffé mal–
gré le feu des ennemis, taillerent en pieces tour _ce
qui leur fit réfifiance ,
&
prirent le refie prifonmer
avec le comma ndanr.
A la bataille de Staffarde , en
i
690 , quatre
~égi
mens de la feconde ligne que le marq uis de Feuqmeres
fit
avancer pour fout enir la premiere, atta9uerent
1
épée
a
la main, des caffines
COU
verteS de
haleS ,
de
foffés
&
de chevaux de frife,
&
les emporterent
( e)
On en atcribue l'invemion
a
Tubalcain, fils de Lamech,
qui commenqa le premier
a
forger l'airain
&
le fer, l'an du
monde
qo.
















