
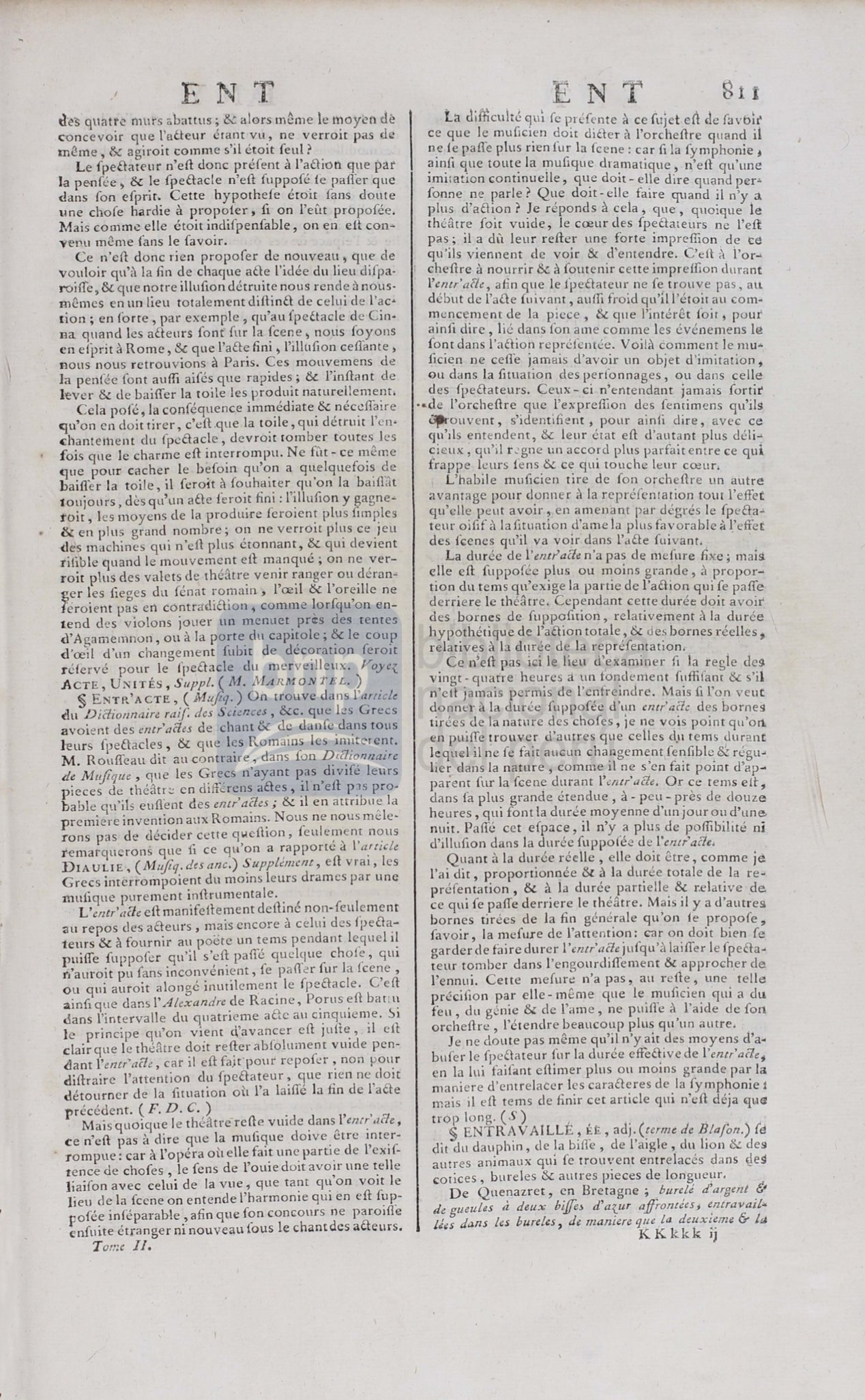
/
ENT
tle'S
qttattc rnurs
;:.battus;
&
alers méme le
moy~n
dé
concevoir que l'aéteur érant vu, ne verroit
pas de
m@rne,
&
agiroit comme s'il étoit feul?
Le fpeüateur n'efi done préfent a l'aétion '}Ue
par
la
pe-nfée,
&
le fpeétacle n'efl: fuppofé fe paífer que
-dans fon efprir.. Cette hypothefe éroit fans doute
une chofe hardie
a
propofer, fi on l'eut propofée.
Mais comrne elle étoit indifpenfable, on en eH con–
l'enu
meme fans le favoir.
Ce n'eíl: done ríen propofer de nouveau, que de
voutoir qu'a la fin de chaque aéte l'idée dulieu difpa–
roiífe,
&
que notre illufion détruite nous rende
a
nous–
memes en un !ieu totalernent clifiinét de celui de l'ac..a.
tion; en forre, par exernple, qu'au Ípeétacle de Cin–
na
quanclles aéteurs font fur la fcene
~
nous foyons
en
efprit
a
Rome,
&
que l'atl:e fini
~
l'illnfion ceífante
~
nous nous retrouvions
a
Paris. Ces rnouvemens de
la
penfée font auffi aifés que rapicles;
&
l'iníl:ant de
lever
&
de baiífer la toite les produit narurellement1
Cela pofé,
la
conféquence imrnédiate
&
néccífa ire
qu'on en doit tirer, c'efi .que la toile, qui déttuit l'en–
<:ban et11ent du fpeél:acle, devroit romber tomes les
fois qne le charme efi inrerrompu. Ne
flh-ce
m "me
que pour cacher le befoin gu'on a qn.elquefois de
baiíl'e r la toile' il fero!t
a
fouhairer qu 'on la hai{l'at
t.oujotlrs, des qu'un aét
e feroit fini: l'illufion
y
gagne–
:toit, les moyens de la produi.re feroient plus íirnples
&
en plus granel nombre; on ne verróir plus (;:e jeu
-des machines qui n'eft plus éronnant,
&
qui devient
Iiilble quand le mouvernent efr manqué; on ne ver–
reir plus des valets de théatre venir ranger ou déron-=
ger les fieges du
{¡'
nat romair1, l'reil
&
l'oreille ne
.féroient pas en contradiél:ion, comme lorfqu'on en–
tend des violons jouer un menuet
pr~s
des remes
<l'Agamemnon, ou
a
fa porte du capitole;
&
le coup
d 'reil d'un changement fubit de décoration feroit
r éfervé pour le fpeétacle du merveilleux.
P'"óye{
.AcrE,
U~ T ITÉS,
Sup
pl. (M.
MARMON1'EL.)
§
E
lTR'A CTE'
e
.
lr1u.fo¡.)
On trouve dans
l'article.
dn
Diélionnaire raíf. des
Sciences,
&c. que les Grecs
avoieM des
entr'aéles
de chant
&
de danfe dans tous
leurs fpeEtacles,
&
qne les Romains les imiterenr.
M.
Rouífeau dit au contraire, dans fon
Dlaionnaire
de
Mujique,
que
les Grecs n'ayant pas divifé leurs
pieces de
théfttr~
en différens aétes, il n'efi p3s pro·
bable qu'ils euílent des
entr'aaes;
&
il en attribue la
premiereinvention aux Romains. Nous ne nousme le·
rons pas de décider cette
q~oiefiion,
feulement nous
r-emarquerons que
íi
ce qu'on a rapporté
a
l'
article
DIAULIE,
(Mujiq.
des
anc.)
~upplbncnt,
efi: vrai, les
Grecs interrompoient du m01ns leurs dramcs par une
mufique purement infirumentale.
L'
entr'
(la
e
efi manifeHement defiiné non-feule
ment
a u
repos des aél:eurs, mais encore
a
celui des íi)
eé.ta-–
teurs
&
a
fournir au poete un tems pendant lequel il
puiffe fuppofer qu'il s'efr paífé qu elque
~hofe,
qui
r-/auroit pu fans inconvénient, fe paífcr fur la fcene ,
ou
qui auroit alongé
inurilem~ n~
le fpettacle. C'eO:
2tinfi.que dansl'Aüxandre_de Racwe,
P<?rus~fi bata~
ans l'intervalle du quatneme aB:c au cmqmeme.
~I
le
príncipe qu'on vient ci,'avancer eíl: jufte, il
efr
clair que
le
théatre doit reíl:er abfolumenr vuid€ pen–
dant
l'erttr'aRe ,
car
il efr fajt:pour repo{;
r,
non pou r
tiifi:raire l'attention du fpetl:ateur, que ríen ne doit
rlétourner de la fitnation oit l'a laiífé
la
fin de l'aéte
précédent.
(F. D. C.
)
Mais
quoi:Iu~
le théatre refre vuide
?ans}'ent~'.tae,
ce n'efr pas a d1re que la muúque do1ve erre tnter–
rompue: cara l'opéra
Oll
elle fait une partie de l'exi f–
tence de ehofes
le fens de l'ouie doit avoir une telle
líaifon avec
cel~i
de la vue; que tant qu.'on voit le
lieu de la fcene on entende l'harmonie guíen efi fup–
pofée inféparab-le; afinque fon concours ne paroiíl€
enfuite étranger ni"nouveau fous le chantdcs aaeurs.
Tome _JI.
/
EN
Bt
ta
di:fficuhé
9u~fe
~r
' f:nte
a
ce ft
jet
efi de ftivbit
ce que le
mufi~
l.endon dléter
a
l'orche.fire quand ii
n_e íe paífe
plus
neo fur
la
fcene: car fila fymphonie;
~1C:fi
que
tour~
la t:nuúque dra_rnatique
~
n'efi qu'une
Imllatwn contmuelle, qu.e clou-
el~e
dire quand p€r...
fono e
~e
parle?
Qt~e
dOit- elle. fa¡ re quand il n'y
a
plus d aéhon
?
Je
r
ponds
a
cela' que
quoique
le
th ·arre
foit
vuide,
le
cceur des fpeétat'eurs ne l'efi
pa~.;
il
.a du leur refie,r une forte impreffion de
te
qu 1ls
v1ennent
de
votr
&
d'entendre.
'efr
~ Í'or~
~he1he
a
no ~1rrir
&
a
foutenir cette irnpreHion durant
l
emr,aéle,
afin que le fpeél:ateur ne fe trouve pas a
u
début de l'atle fuivant, auffi froid qu'il l'éwir a
u
c~m
D?ence.ment_
~€
la piece,
&
que l'intéret
·{o
ir;
pour
a1nfi d1re, h e dans fon ame comme les événemens
1~
font dans l'aétion repré{; nt ' e. Voila cornment ie
m u...
ficien ne ceHe jamais d'avoir un objet d'irnitatíon
ou daos la fituarion des per onnages, ou dans cell;
des fpeétateurs. Ceux-
ú
n'enrendant jamais fortir
·--de
l'on;hefire,.que .l'expreffion des fenrimens qu'ils
0prouvent, s 1dentdient, pour ainfi dire
ave<:: ce
q~1'ils
ente,?dent,
&
leur état efi d'autant
~lus
el
'li-:
~:€ux,
qu 1l
r ~gne
un
aG:co_rd plu_s parfait entre ce qui
frappe leurs íens
&
te
qm
touche leur
creur~
L'habile rtmfi(;:ien tir€ de fon orchefire un autre
avantage pour donner
a
la repréfentation tour l'effet
qu'€11~
pe,ut avoir
~en ~menant
pa1·
dégrés le fp eaa ...
teur OJfif a lafitutltlGn dame la plus favorable
a
l'effet
des
f~enes qu'i~
va voir dans l'dtte fuivant.
·
La durée de
l'entlaéle
n'a pas
d~
mefure 6xe · mai9..
c_lle eft
fuppof~e
rtus
ou
~oins
grande'
a
pr~por
tiOf.l
du tems qn exige la pat·tte de l'aétion qui fe paífe
d€rriere le théatre. Cependant €ette durée
doit
avoir'
des bornes de fuppoíition' relativement
a
la durée
hypothétique de l'aétion totale,
&
de
bornes réelles
relatives
a
la
dt!rée de la repréfenration.
'
. Ce
n~efi
pas ici le lieu d',examiner
fl
la regie
de~
vmgt- quatre heures
á
un tonde_ment fuffifanr
&
s'il
n'eit jarnais permis de l'enfreindre.
Mais
úl'on ve ut
donner a la durée fuppofée d'un
entr'aélc.
des bornes
tirées. de la nature des chofes, je
~e
vqis point qu'on
en pmíTe !rouver d'aurres que celles d,u tems durant
l~qu~l
il ne fe fait auG:un cha.
gem~nt f~I?-íible.
&
régu.o~
l1e~
clans la nature, cornme.
Il
ne
s
en falt point
d'ap ~
parent fur la fcene dnt-ant
1'
e.ntr'(Jéle,
Or
ce
tems
eit
dans fa plus grande étendue'
a-
peu- pres de
douz~
he
u
res, qui font la dur 'e moyenne d'un jour
o u
d'une
nuit. Paífé cet e{pace, il n'y a pius de poffibilité
ni
d'illufion dans la durée fuppo(ée de
l·erur'aéle.
Qua
m
a
la durée réeUe, elle doit etre, comme
je
l'ai dit' proportionnée
&
a
la durée totale de la re–
préfentation'
&
a la durée partielle
&
r.elative de
ce qui fe paífe derrier€ le rhéatre. Mais
il
y
a
d'autres
bornes tirées de la fin générale qu'on íe propofe
favoir, la mefure de l'attention: €<Ir on doit bien
f~
garder de faire durer l
'entr'ac1e
jufqu'a Iaiífer le fpeél:a–
reur tomber dans l'engourdiífement
&
approcher de.
l'ennui. Cette mefure n'a pas, au refie, une tetle
précifion par elle-
m
eme que l€ muíieien qui a dtt
feu'
du
génie
&
de l'ame' ne puiífe a l'aide de fort
orchefire, l'étendre beaucoup plus qu 'un autre.
Je ne doute pas meme qu'íl n'y_ait des moyens cÍ'a...
bufer le fpettateur fur
la
duré e effettive de
1'
entr'
aéle*
en la lui faifant efitmer plus ou moins granel€ par la
maniere d'entrelacer les caraéteres de
la
fymphonie
1
mais íl efi tems de finir cet article qui n
dt
déja
<qt:HR
trop long.
e
S)
.
§
ENTRAVAILLÉ;
Ét,
adj.
(terme
de
.Élafon.)
(e
dit du dauphin, de la biíf€, de l'aigle, du lion
&
des
a utres animaux qui fe trouvent enrrelac
's
daos
~e s
cotices, bureles
&
anu·es pieces de
longue~n·,
De Quenazret, en Breragn€ ;
.bureLé
d'argent
&
de gueulas
a
deax bi.f!es d'
az.uraffrontl~s; entravait~
JJ~s
dans les bureles, de maniere q!..te La
deux~e_me
&
1~
KK kkk
11
















