
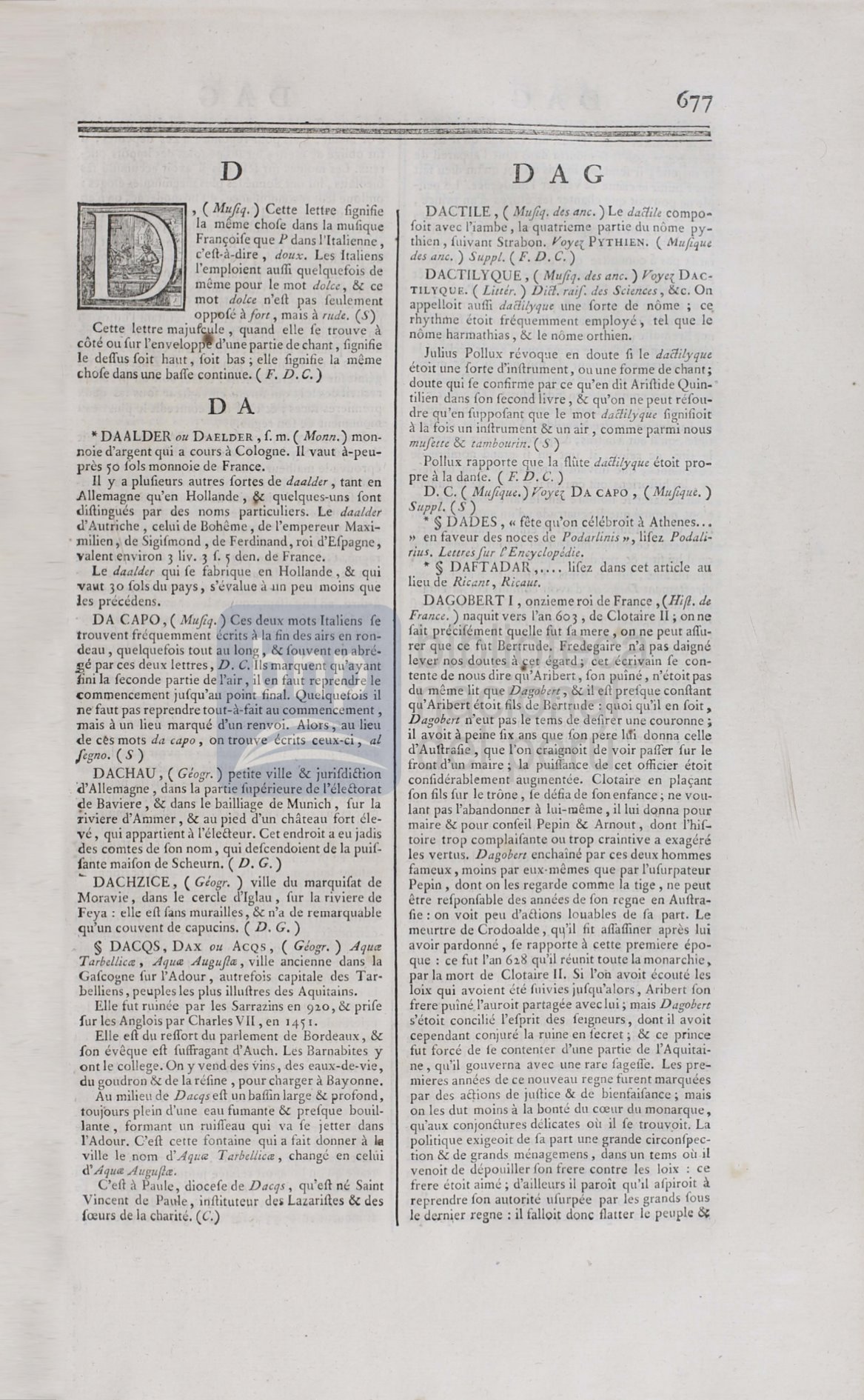
D
~!;!~~~~~
, (
Mujiq.
)
Cette lettPe fignifie
la
me~e
chofe dans la mufique
Fran<;01fe que
P
dans l'ltalienne
'il'di
'
e
ea-a-
re ,
doux.
Les Iraliens
l'emploient auffi quelquefois de
meme pour le mot
dolce'
&
ce
mot
dolce
n'eíl pas feulement
oppofé a
fort,
mais
a
mde.
(S)
Cett~
lettre majuecule , quand elle fe trouve
a
coté ou fur l'envelopp d'nne partie de chant' fignifie
le deífus foit haut' foit has; elle fignifie la meme
chofe dans une baífe c0ntinue.
(F. D. C.)
DA
*
DAALDER
ou
DAELDER,
f.
m. (
Monn.)
mon–
noie d'argent qui
a
cours
a
Cologne.
Il
vaut a-peu–
pres
50
fols
monnoie de France.
Il y
a plufieurs autres forres de
daalder,
tant en
Allemagne qu'en Hollande ,
~
quelques-uns font
dífl:ingués par des noms particuliers. Le
daalder
d'
Autriche, celui de Boheme, de l'empereur
Maxi–
milien, de Sigifmond , de Ferdinand, roí d'Efpagne,
valent e viron
3
lív.
3 f. 5
den. de France.
Le
daaLder
qui fe fabrique en Hollande,
&
qui
VaUt
JO
fols du pays; s'évalue
a
.un peu moins que
les
précédens.
DA CAPO, (
Mujiq.)
Ces deux mots Italiens fe
trouvent fréquemment écrits
a
la fin des airs en ron–
deau, quelquefois tout a
u
long,
&
fonvent en abré–
.gé par ces deux lettres,
D. C.
lis marquent qu'ayant
íini la feconde partie de l'air, il en faut reprendre le
commencement jufqu'au point final. Quelquefois il
ne
faut pas reprendre tour-a-fait au commencement,
mais
a
un lieu marqué d'un renvoi. Alors, au lieu
<le
c~s
mots
da capo,
on trouve écrits ceux-ci ,
al
fegno.
(S)
DACHA
U, (
Géogr.
) petite ville
&
jurifdiB:ion
'd'
Allemagne, dans la partie fttpérieure de l'éleB:orat
~e
Baviere ,
&
dans le bailliage de Munich , fur la
riviere d'Ammer,
&
a
u
pied d'un cha.teau fort éle–
vé,
qui
appartient
a
1'éleél:eur. Cet endroit a eu jadis
des comtes de fon nom, qui defcendoient de la puif–
fante maifon de Scheurn.
(D.G.)
..... DACHZICE, (
Géogr.
)
ville du marquifat de
M01·avie, dans le cercle d'Iglau , fur la riviere de
Feya : elle efr fans murailles,
&
n'a de remarquable
~u'un
couvent de capucins. (
D. G.
)
§
DACQS
5
DAX
ou
AcQS, (
Gl.ogr.
)
_Aquce
Tarbellica?,, Aqua?, Augujlce,
ville ancienne dans
la
Gafcogne fur
1'
Adour, autrefois capitale des Tar–
belliens, peuples les plus illuílres des Aquitains.
Elle fut ruinée par les Sarrazins en
920,
&
prife
fur les Anglois par Charles
VIl,
en
1451.
Elle eíl du reífort du parlement de Bordeaux,
&
fon éveque eíl fuffragant
d}
A
u
ch. Les Barnabites y
ont le college. On yvend des viñs, .des eaux-de-vie,
du goudron
&
de lar 'fine, pour charger
a
Bayonne.
A
u
milieu de
Dacqs
eft. un bailin large
&
profond,
toujours p.lein cl'une eau fumante
&
prefque bouil–
lanre, formant un ruiífeau qui va fe jetter dans
l'Adour. O'efl: cette fontaine qui a fait donner
a
la
ville
le
.nom d'
Aquce T arbellicce,
changé en celui
d'Aqut2
Augufia?,,
C'efi
a
Paule, diocefe de
Dacqs,
qu'efl: nl: Saint
Vincent de Pau-le, inílituteur dei Lazarifres
&
des
fceurs de
la
charit:.
(C.)
DAG
.DACT~_~E,
(
Mujiq.
de.s anc.)
Le.
daélile
compo..
folt avec liambe' la quatneme parue du nome py–
thien, fuivanr Strabon.
J/oye'{_
PYTHIEN. (
Mufique
des anc.
)
SuppL.
(
F. D. C.
)
DACTlLYQUE, (
Mujiq.
des
anc.) Voyez
DAc–
TILYQ
u
E.. (
Littér.
)
Diél.
raif. des Scimces,
&c.
On
appelloit
auffi
dallilyque
une forte de nome ; ce
rhythme étoit fréquemment employé) tel que le
nome harmathias'
&
le nome orthien.
Julius Pollux révoque en doute íi le
daéliLyque
étoit une forte d'infrrument, ou une forme de chant;
~o.~tte
qui fe confirme par ce qu'en dit Arifl:ide Quin.
t1hen dans fon fecond livre,
&
qu'on ne peut réfou–
dre qu'en fuppofant que le mot
da.élilyque
fiunifioit
a
la fois un iníhument
&
un air, comme parmi nous
mufette
&
tambourin.
(S
)
Pollux rapporte que la flt1te
daaiLyque
étoit pro–
pre
a
la daníe.
(F.
D. C.)
D. C. (
Mujiqu~.)
Yoyez
DA
CAPO , (
Mujique.)
Sttppl. (S)
*
§
DADES ,
«
fete qn'on célébroit a Athenes..•
»
en faveur des no ces de
Podarlinis,,
lifez
Podali–
rius. LettresJur
L'
En
:yclopédie.
*
§
DAFTADAR, .... lifez dans cet article au
lieu de
Ricant, Ricaut,
DAGOBERT I, onziemeroi de France
,(Hifi.
de
France.
)
naquit vers l'an 6o
3 ,
de Clotaire
II ;
on ne
fait précifément quelle fut fa mere, on ne peut aífu–
rer que ce fut Berrrude. Fredegaire n'a pas daigné
lever nos doutes
a
cet égard; cet écrivain fe con–
tente de nous di re qu'Aribert, fon puiné, n'étoit pas
du meme lit que
Dagobert,
&
il eíl prefque confiant
qu'Aribert étoit fils de Be.rtrude : quoi qu'il en foit,
Dagobert
n'eut pas le tems de defirer une couronne;
il avoit
a
peine fix ans que
{on
pere lúi donna celle
d'
Auftrafie, que l'on craignoit de voir paífer fur le
front d'un maire ; la puiífance de cet officier étoit
coníidérablement augmentée. Clotaire en pla<;ant
fon fils fur le tróne, fe défia de fon enfance; ne vou–
lant pas l'abandonner
a
lui-meme , illui donna pour
maire
&
pour confeil Pepin
&
Arnout, dont l'hif
...
toire trop complaifante ou trop craintive a exagéré
les vertus.
Dagobert
enchainé par ces deux hommes
fameux, moins par eux·memes que par l'ufurpateur
Pepin , dont on les regarde comme la tige, ne peut
etre refponfable des années de fon regne en Aufl:ra–
fie : on voit peu d'aél:ions louables de fa part. Le
meurtre de Crodoalde , qq'il
fit
aífaíiiner apres lui
avoir pardonné'
(e
rapporte
a
cette ptemiere épo–
que : ce fut l'an 628 qu'il réunit toute la monarchie
~
par la mort de Clotaire
II.
Si l'oh avoit écouté les
loix qui avoient été fuivies jufqu'alors, Aribert fon
frere puiné l'auroit partagée avec lui; mais
Dagobert
s'étoit concilié l'efprit des fe1gneurs, dont il avoit
cependant conjuré la ruine en fecret ;
&
ce prince
fut forcé de fe contenter d'une partic ele
1'
Aquitai–
ne, qu'il gouverna avec une rare fagetTe. Les pre–
mieres années de ce nouveau regne furent marquées
par des aB:ions de jufiice
&
de bienfaifance; mais
on les dut moins
a
la bonté du crenr du monarque,
qu'aux conjonB:ures d 'licates oü il fe trouv_oit.
La
politique exigeoit de fa part une grande circonfpec–
tion
&
de grands ménagemens, dans un tems
Otl
il
venoit de dépouiller fon frere contre les loix : ce
frere étoit aimé; d'ailleurs il paroit qu'u afpiroit
a
reprendre fon alltorité ufurpée par les grands fous
le
dern~er
regne ;
il
falloit don' flatter
le
peuple
&.
















