
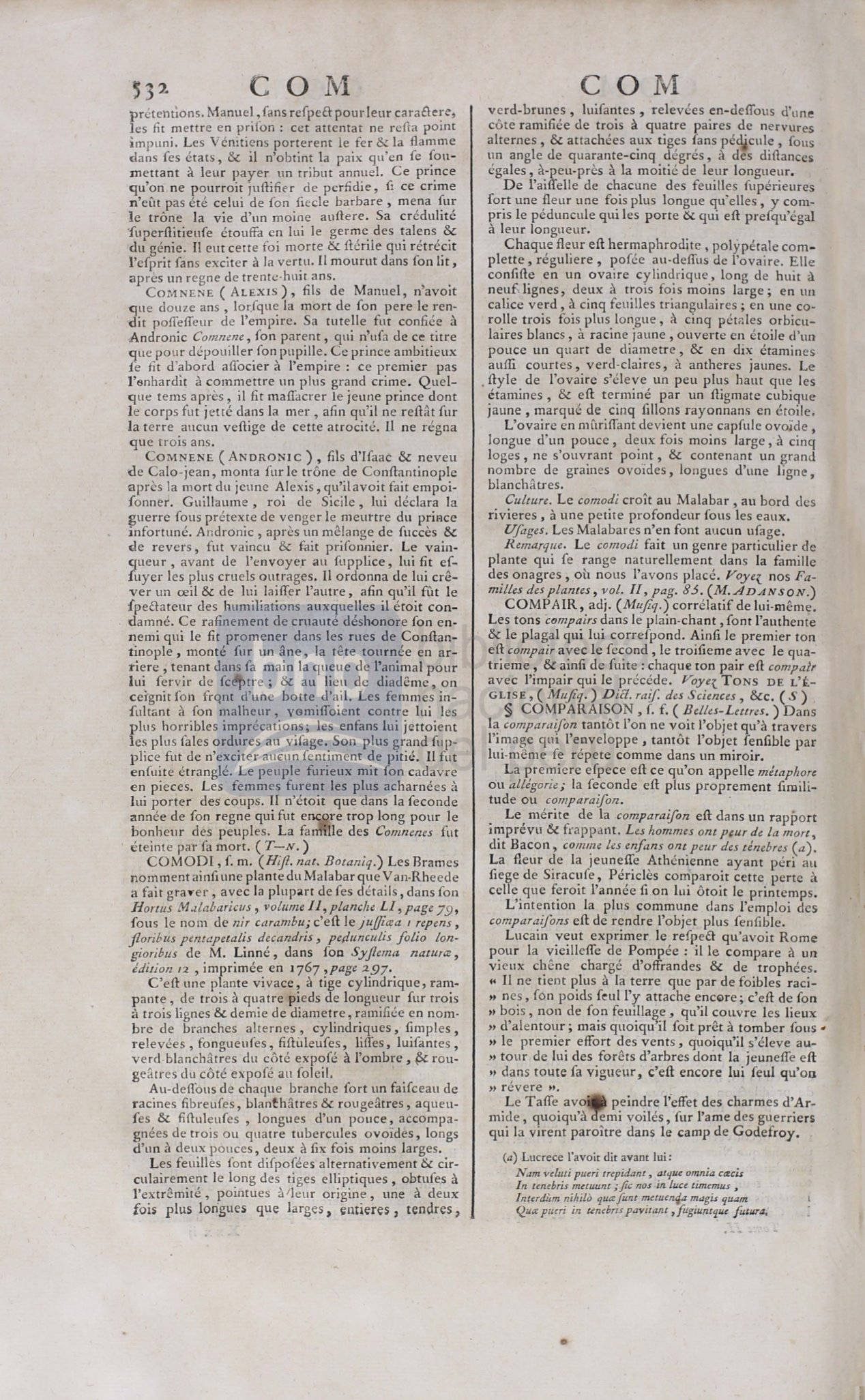
53
2
e
o
~1
prétentions. Manuel, fans refpea pour Ieur caraétere,
les fit mettre en prifon : cet attentat ne refia point
impuni. Les
V
énitiens porterent le fer
&
la flamm e
daos fes états ,
&
il n'obtint la paix qu en fe
~oa
mettant
a
leur payer
un
tribut annuel. Ce prmce
qu'on ne pourroit jufiifier de perfidie,
fi
ce crime
n'eut pas été celui de fon fi ede barbare , mena fur
le trone la vie d'un moine aufiere. Sa crédulité
'fuperfiitieufe étouffa en luí le germe des talens
&
du génie.
n
eut certe foi morte
&
frérile qui rétrécit
l'efprit fans exciter
a
la
vertu.
ll
mourut dans fon lit,
apres un regne de trente·huir ans.
CoMNE E
e
ALEXIS )' fils de Manuel, n'avoit
que douze ans , lor.fque la mort de fon pere le ren–
dir po!feífeur de l'empire. Sa tutelle fur confi ' e
a
Andronic
Comnene,
fon parent , qui n'ufa de ce titre
q ue pour dépouiller fon pupille. Ce prince ambitieux
fe fit d'abord a!focier a Pempire : ce premier pas
l'anha rdit
a
commettre un plus grand crime. Quel–
q ue
tems apres, il fit ma!facrer le jeune prince dont
le corps fu t jetré daos la mer, afin qu'il ne
refi~t
fur
la t erre aucun vefrige de cette atrocité.
I1
ne régna
que trois ans.
COMNENE
e
ANDRONIC), fils d'Ifaac
&
neveu
d.
e Calo -jean, monta fur le trone de Coníl:antinople
apr' s la mort du jeune Alexis, qu'il avoit fait empoi–
fonnér. Guillaume, roi de Sicile, lui déclara la
guerre fous prétexre de venger le meurtre du priAce
infortuné. Andronic, apres un melange de fucces
&
de revers, fut vaincu
&
fuit prifonnier. Le vain–
q ueur, avant <.le
l'envoye.r au fupplice, lui fit ef–
fuy er les plus cruels outrages.
11
ordonna de
luí
ere–
ver
un
reil
&
de lui lai:!Ter l'autre, afin qu'il fut le
Ípeétateur des humilíations auxquelles il éroit con–
damné. Ce rafinernent de cruauté déshonore fon en–
~emi
qui le fit prornener dans les rues de Confian–
tinople ' monté fur un ane'
la
tete tournée en ar–
tiere , tenant dans fa main la queue de !'animal pour
lui fet vir de
fc~ptre
;
&
a
u
lien de diademe, on
cergnit
fon frqnt
d'une botte d'ail. Les femmes in–
fultant
a
fon malheur' vami!foient contre lui les
plus horribles imprécations; les enfans lui jettoient
les. plus faJes ordures au vifage. Son plus grand fup–
plice fut de n'exciter am:un fentiment de pitié.
11
fut
enfuite étranglé. Le pe uple furieux mit fon cadavre
en pi eces. Les femmes fureot les plus acharnées
a
Iui porter des coups.
Il
n'
étoit que dans la feconde
année de fon regne qui fut enco.re trop long pour le
bonheur des peuples. La famille des
Comnenes
fut
éteinte par fa mort. (
T
-N.)
COMODI,
f. m.
(Hijl. nat. Botaniq .)
Les Brames
nomment ainú une plante du Malabar que Van-Rhe ede
a
fait
gra•·er, avec la pluparr de fes détai ls, dans fon
Iiortus
M
a.labaricus, volume
11,
planclze LI, page 79,
fous le nom de
nir caramhu;
c'eíl: le
juffi.cea r repens,
jlorihus pentapetalis decandris, pedunculis folio lon–
giorihus
de
M.
Linné, dans fon
Syflema naturce,
édi.tion
12
,
imprimée en
1767
,page
297.
C'efr un e plante vivace,
a
tige cylindrique, ram–
pante' de trois a quatre pieds de longueur fur trois
a
trois lignes
&
demie de diametre, ramifiée en nom–
bre de branches alternes, cylindriques, fimples,
relevées, fonguenfes, fiíl:uleufes, liífes, luifantes ,
verd -blanchatres du coté expofé
a
l'ombre,
~
rou–
geatres du coté expofé au foleil.
Au-defious de chaque branche fort un faifceau de
racines fi.breufes,
blant:h ~tres
&
rougeatres, aqueu–
fes
&
fi.fiuleufes , longues d'un pouce, accornpa–
gnées de trois ou quatre tubercules ovoides, longs
d'un
a
deux pouces ' deux a fix fois moins larges.
Les feuilles font difpofées alternativement
&
cir–
culairement le long des ti ges elliptiques' obtufes
a
l'extremiré' pointues a!Jeur origine' une
a
deux
fois
plus lorigues
que
larges,
entieres , tendres ,
e o
I\1
verd-brunes, luifantes, relev 'es en-de!fous d une
cote ramifiée de trois
a
quatre paires de nervures
alternes,
&
attachées aux riges fans péd' cule, fous
un angle de quarante-cinq d ' grés,
a
des difranc s
égales' a-peu-pres a la moitié de leur longueur.
De l'ailfelle de chacune des feuilles fup ' rieures
fort une fleur une fois plus longue qu'elles,
y
com–
pris le péduncule qui les porte
&
qui efi prefqu ' gal
a
leur longueur.
.
Chaqu,e
fle.urefi
her~aphrodite,
polypétale com–
plette, reguhere, pofee au-de!fus de l'ovaire. Elle
coníifie en un ovaire cylindrique, long de huit
a
neuf\ lignes' deux
a
ttois fois moins large; en un
calice verd'
a
cinq feuilles triangulaires ; en une
co~
rolle trois fois plus longue '
a
cinq pétdes orbicu–
laires blancs'
a
racine jaune' ouverte en étoile d'un
pouce un quart de diametre,
&
en dix étamin es
auffi courtes, verd-claires,
a
antheres jaunes. Le
. fryle de l'ovaire s'éleve
un
peu plus haut que les
~tamin es
,
&
efr te:miné par un iligmate cu,bique
Jaune, marqué de cmq úllons rayonnans en etoile.
L'ovaire en mt1riífant de vient une capfule ovoide
Iongue d un pouce, deux fois moins large,
a
cinq
loges, ne s'ouv.rant
poi~t,
&
contenant un grand
nombre de grames ovo1des, Iongues d'une lígne
blanchatres.
'
Culture.
Le
comodi
croit au Malabar , au bord des
rivieres'
a
une petite profondenr fous les eaux.
Ufages.
Les Malabares n'en font aucun ufage.
Remarque.
Le
comodi
fait un genre particulier de
plante qui fe range naturellement dans la farnille
des onagres,
Oti
nous l'avons placé.
Voye{
nos
Fa–
milles des plantes, vol.
11,
pag.
8-S.
(M.ADANSON.)
COMPAIR, adj.
(Mujiq.)
corrélatíf de lui-meme.
Les tons
compairs
dans le plain-chant, font l'authente
&
le plagal qui lui correfpond. Ainú le prernier ton
efr
compair
avec le fecond, le troífieme avec
le
qua-·
tri eme,
&
ainú de fuite: chaque ton pair eíl:
compair
avec l'impair qui
le
précéde.
Voye{
ToNs
DE L'É–
GLISE, (
Mujiq.) D iél. raif. des Sciences,
&c.
(S)
§
COMPARAISON,
f.
f. (
Belles-Lettres.)
Daos
la
comparaifon
tantot l'on ne voit l'objet qu'a travers
l'image qui l'enveloppe, tantot l'objet fenfible par
lui-meme fe répete comme dans un miroir.
La
~re~i e re
efpece efr ce qu'on appelle
mttaphore
o
u
allegone ;
la feconde efr plus proprement úmili-
tude ou
comparaifon.
·
Le mérite de la
comparaifon
efr daos un rapport
imprévu
&
frappant.
Les hommes ont peur de la mort
dit Bacon,
comr'!e Les enfans ont.peur des ténebres
e
a):
La fleur de la ¡euneife Athémenne ayant péri au
fiege de Siracufe, Péricles comparoit cette perte
a
cell~.que f~roit
l'année fi on lui otoit le printemps.
L 1ntent10n la plus commune dans l'emploi des
comparaifons
efr de rendre l'objet plus fen fib le.
Lucain veut exprimer le refpeét qu'avoit Rome
pour la vieilleífe de Pompée
:
it
le compare
a
un
vi eux: chene chargé d'offrandes
&
de trophées.
«
Il
ne tient plus
a
la terre que par de foibles raci–
~·
nes, fon poids feull'y attache
enc~re;
c'efr de fon
,. bois, non de fon feuillage ,
qu'il
cottvre
les
lieux
" d'alentour; mais quoiqu'il foit pret
a
tomber fous –
'' le premier effort des vents , quoiqu'il s'éleve a
u–
" tour de lui des for ets d'arbres dont la jeune:!Te eft
H
dans toute fa vigueur, c'efi encore lui feul qu'on
" révere ''·
Le Ta:!Te avo·
peindre l'effet des charmes d'
Ar-
mide, quoiqu'a emi voilés, fur !'ame des guerriers
quila virent paroitre dans
le
camp de Godefroy.
(a)
Lucrece l'avoit
d.itavaot lui:
Nam vtluti pueri trepidan.t,
at'}ue
omn.i.a ca!cis
In. ten.ehris muuunt ;jic n
os in lucetimemus ,
lnterdltm nihilo
qua font
metuen.damagis quam
Qua!
pu'fi.
in. unebris
pavitant
,
fogiumque
futura.
















