
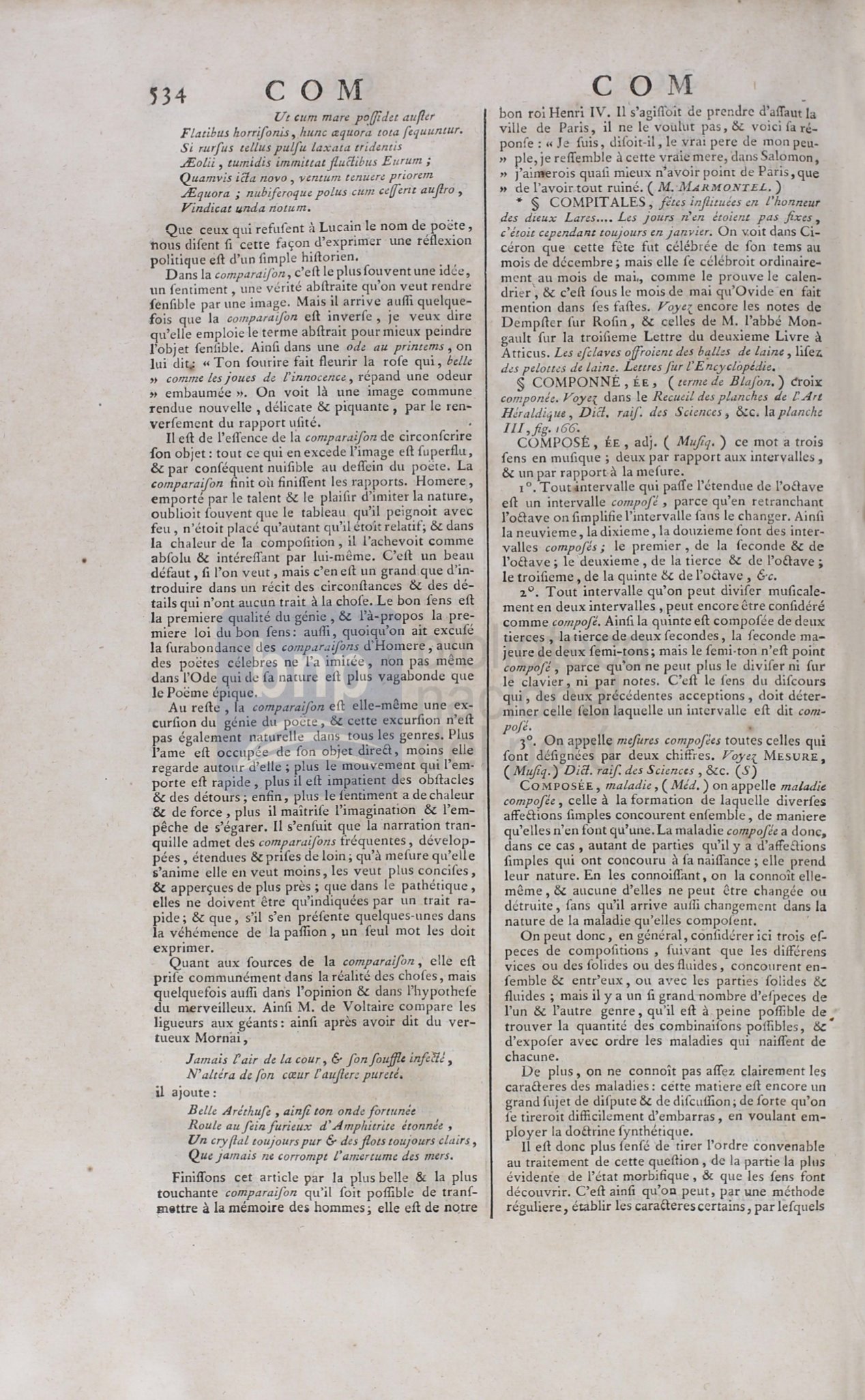
534
COM
Ut cum mare po.fjidet aufler
Flatihus horrifonis, hunc
~quora
tota fequuntur.
Si rurfus tellus pulfu Laxata tridentis
.IEolii, tumidis immittat jluélibus
Eu.r~m;
Quamvis iéla novo, ventum
tenuer~
prwrem
.IEquora
;
nubiferoque polus cum ce{[ent auflro,
Vindicat unda notum.
Que ceux qui refufent
a
Lucai?
le
no
m
de, poe_te,
nous difent fi cene fas:on d'expnmer une reflexwn
politique
eíl
d'un fimple hifrorien.
.
,
Dans la
comparaifon,
c'efr le p_lus fouvent une tdee,
un fentiment, une vérité
a~fr:a1te ~u'on
veut rendre
fenfible par une ima&e. Ma1s
_11
arnve
~uffi quelq~e.fois que la
comparaifon
efi m_verfe,
J~
veux_ d1re
qu'elle emploie le _rerme abfirait pour
m1e~x
pemdre
l'objet fenftble.
Am~ dan~
une
?dt au pnnten:zs,
on
Iui dit.: "Ton founre falt fleunr la rofe qUI,
belle
>)
comme Les joues de L'innocence,
répand une odeur
, embaumée
».
On voit la une image commune
rendue nouvelle ' délicate
&
piquante' par le ren–
verfement du rapport ufité.
·
Il efi de l'e:íTence de la
comparaifon
de circonfcrire
{on objet: tout ce quien excede l'im_age efi fu_perflu,
&
par conféquent nuifible au de:íTem du poete. La
comparaifon
finit
Otl
finiífent
l~s ra~po~ts.
Homere,
emporté par le talent
&
le plaríir
d,~mit~r
la ?ature,
oublioit fouvent que le
tablea;~
9u
~1 pe1g~olt
avec
feu n'étoit placé qu'autant qu tl eto1t relauf;
&
dans
la
~haleur
de Ia compofition, il l'achevoit comme
abfolu
&
intéreífant par lui-meme. C'efi un be_au
cléfaut
fi l'on veut, mais e'en eíl: un grand que d'm–
trodui;e dans un récit des circonfiances
&
des dé–
tails qui.n'ont
au~u,n
trait,
~la
chof;: Le bon fens efi
· la prem1ere qualae du geme,
&
l_a-~ropo~
la pre;
miere loi du bon fens: auffi, qu01qn on a1t excufe
la furabondance des
comparaifons
d'Homere; aucun
des poeces célebres ne l'a imitée ' non pas meme
dans l'Ode qui de fa nacure eíl: plus vagabonde que
le
Poeme épique.
Au refie , la
comparaifon
efi elle-meme une ex–
curfion du génie du poete,
&
cette excurfion n'eíl:
pas également naturelle
dan~ tot~s
les genr_es. Plus
!'ame eíl: occupée de fon obJet dtrea, mom_s ,elle
regarde autour d'elle; plus
~e
mo?vement qLU l ero–
porte eíl: rapide ,_plus
Il
efi
tmpat~ent
des obíl:acles
&
des détours; enfin, plus le fent1ment a de chaleur
&
de force, plus il maitrife
l'imagi~atíon
.&
l'em–
peche de s'égarer. 11 s'en_fuit qu,e la
narrat1~n
tran–
quille admet des
comfaraifons_
freqt~entes,
deve!op–
pées' étendues
&
pnfes _de lom; qu_
a
mefure qu. elle
s'anime elle en veut motns, les veut plus conc1fes,
&
apper<;ues de plus pres ; que dans le
pathét~que,
elles ne doivent etre qu'indiquées par un tratt ra–
pide;
&
que, s'il s'en préfente quelques-unes
da~s
la véhémence de la paffion , un feul mot les doit
exprimer.
Quant aux fources de la
comparaifon,
elle efi
prife communément dans la réalité des chofes, mais
quelquefois auffi
d~n·s
l'opinion
&
~ans
l'hyporhefe
du merveílleux. Amfi M. de Volta1re compare les
Iigueurs aux géants: a_infi apres avoir dit du ver–
tueux Mornai,
J
amais
f
air de la cour,
&
fon fouffle infe'éU,
N'altéra de (on caur
t:
auflere pureté.
il ajoute:
B elle Aréthufe
,
ainji ton onde fortunée
Roule aufliafurieux d'Amphitrite étonnée,
Un cryflal toujours pur
&
des jlots toujours clairs,
Que jamais ne corrompt l'amertume des mers.
Finiífons cet article par la plus be1le
&
la plus
touchante
comparaifon
qu'il foit poffible de tranf–
uutttre
a
la
mémoire de¡ hommes; elle eft de no,tre
COM
bon roi Henri
IV. ll
s'aaiífoit de prendre d aíl'aut la
ville de París, il ne lebvoulut pas,
&
voici fa ré–
ponfe : "
J
e fuis, difoit-il, le _vrai pere de mon peu.
»
ple, je reífemble
a
cette
~ra1e_mer~,
dans Sal?mon,
>>
j'aimerois quafi mieux n av01r pomt de Pans, que
., de l'avoir tout ruiné.
(M.
MARMONTEL.)
*
§
COMPITALES,
fl'tes inflituées en L'honmur
des dieux Lares.... Les jours n'.m étoient pas fixes,
c'étoit cependant toujours en janvier.
On v.oit dans Ci–
céron que cette fe te
~ut
célébr ',e ,de
~on t~m~
au
mois de décembre; ma1s elle fe celebr01t ordmaire–
ment au mois de mai., comme le prouve le calen–
drier
~
&
c'eíl: fous le mois de mai qu'Ovide en
fait
mention dans fes fafies.
Voye{
encore les notes de
Dempíler fur Roún,
&
celles de M. _l'abbé _Mon–
gault fur la troifieme
L~ttre
du deuxteme.
L1v~e
a
A
tticus.
Les efclaves offrozent des bq.LLs de Lame,
hfe~
du pelottes de Laine. Lettres fur L'Encyclópédie.
§
COMPONNÉ,
ÉE,
e
te:me de BLafon.)
<:roix:
componée. Yoyez
dans le
Recuez~
des pltmches de t.Art
Héraldique, Diél. raif. des Sczences,
&c.
la
planche
III,fig.
166.
COMPOSÉ,
ÉE,
adj. (
Mujiq.)
ce mota trois
fens en muíique ; deux par rapport aux intervalles,
&
un par rapport
a
la mefure.
1
°.
Tout intervalle qui paífe l'étendue de l'oaave
efi un intervalle
compofé,
paree qu'en retranchant
l'oaave on fimplifie l'jmervalle fans le changer. Ainfi
la neuvieme la dixieme, la douzieme font des
ínter~
valles
comp/ifés;
le premier, de la feconde
&
de
l'oB:ave; le 'deuxieme, de la tierce
&
de l'oB:ave;
le troifieme, de la quinte
&
de l'oaave,
&c.
2
°.
Tout intervalle qu'on peut divifer muíicale–
ment en deux intervalles , peut encore etre coníidéré
comme
cornpofé.
Ainfi la quinte efi compofée de deux
tierces
la rierce de deux fe condes, la feconde ma–
jeure d; deux femi-tons; mais le femi-toñ n'eft point
compofé,
paree qu'on ne
pe~lt
plus le
divife~
ni fur
le clavier' ni par notes.
e
eft le fens du dlfcours
qui , des deux: précédentes
a~ceptions
, doit.déter·
miner celle felon laquelle un mtervalle efi d1t
com-
pofé.
·
3°. On appelle
mefores compofées
toutes celles qui
{ont défignées par deux chiffres.
Yoye{
MESURE,
e
Mujiq.) Diél. raif. des Sciences,
&c.
(S)
CoMPOSÉE'
maladie'
e
Méd.)
on appelle
matadie
compofée'
celle
a
la formation de laquelle diverfes
affeB:ions úmples concourent enfemble, de maniere
qu'elles n'en font qu'une. La maladie
compofée
a done,
dans ce cas , autant de parties qu'il
y
a d'affeB:ions
fimples qui ont conconru
a
fa naiífance; elle prend
leur nature. En les connoiífant, on la connoit elle–
meme'
&
aucune d'elles ne peut etre changée ou
détruite, fans qu'il arrive auffi changemenc dans la
nature de la maladie qu'elles compofent.
'
On peut done, en général, confid 'rer ici trois ef–
peces de comp?íitions ,
fuiv~nt
que les différens
vices ou des fohdes ou des flmdes, concourent en–
{emble
&
entr'eux, ou ave e les parties ·folides
&
fluí des ; mais il
y
a un fi grand nombre d'efpeces de
l'un
&
l'autre genre' qu'il eíl:
a
peine poffible de –
trouver la quantité des combinaifons poffibles,
&
d'expofer avec ordre les maladies qui naiifent de
chacune.
De plus, on ne connoit pas aífez clairement les
caraB:eres des maladies: certe matiere eíl: encore un
grand fujet de difpute
&
de difcuíiion; de forte qu'on
fe tireroit difficilement d'embarras, en voulant em–
pioyer la doB:rine fynthétique.
n
eíl done plus fenfé de
t~rer
l'ordre
co~venable
au traitement de cette queíhon, de la parne la plus
évidente de l'état morbifique,
&
que les fens font
découvrir. C'efi ainíi qu'oc peut, par Wle méthode
réguliere, établir les caraéteres certains, par lefquels
















