
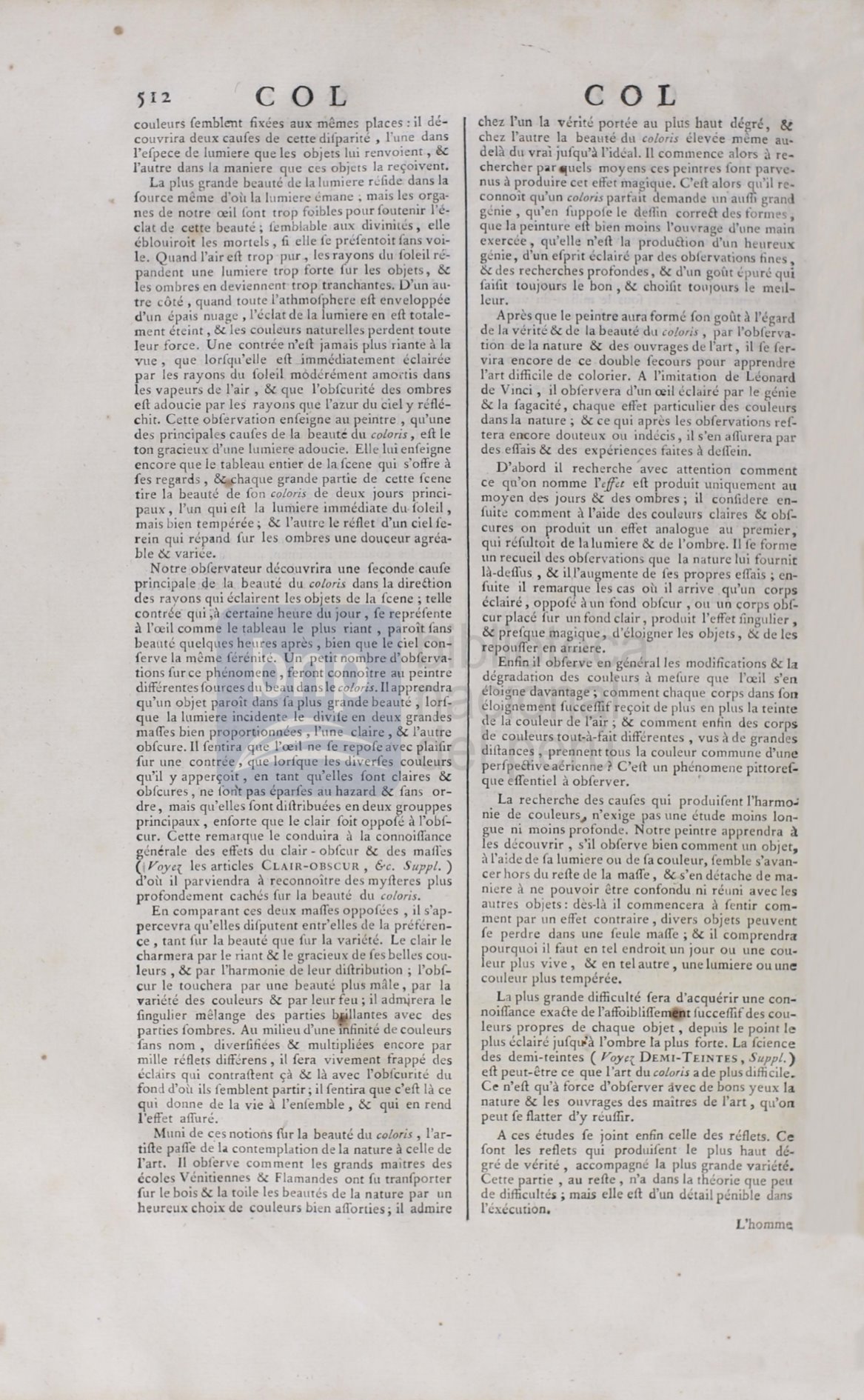
C O L
couleurs (emblent fix ' es aux m"mes places:
i1
dé–
couvrira deux caufes de
e
tte difpari · , l'une dans
l'efpece de lumi re qu
1
s obje
lm renvoi
~t
1
autre dans la maniere que ce obj
t
Ja
rec;01v nr.
La plus grande b auré d
la lumiere
rt...~de
dans la
{o
urce m "me don la lumiere
~roan
• mats les orga–
nes de norre ceil font rrop foibles
pou~ ~o~t~nir
1' ' –
clat de cetre beaut ' ·
L
mblable au.x dtvmtt s, elle
éblouiroit le mort is
ú
elle
[!
pr fentoir fans oi–
le.
uand
1
air eíl: rrop pur, les rayons
uu
~oleil
ré–
pand nt une lum_iere trop force fur les
obJ~ts,
&
les ombres en devtennent trop tranchante .
D
unan–
tre oté' quand toute l'arhmofphe:e eíl: enveloppée
d'un épais nuage ,
l'é
lat de la lumtere en eíl: totale–
ment ét int,
&
les couleurs naturelle perdent toute
leur force. une contr 'e n'efi jamais plus riante
a
la
vue, que lorfqu elle eíl: .immédiatement éclairé
par les rayons du folei1 mod
1
rément
amo~·ti
dans
le vapeur d
l'air ,
&
que l'obfcurité d s ombres
efi adoucie par les rayons que !'azur du ciel y r
1
flé–
chit.
e
tte obfervarion enfeign au peinrre ' gu'une
de principales caufes de la beauté du.
coloris,
eíl: le
ton gracieux d'une lumiere adoucie. Elle lui enfeigne
encore que le tablean entier de la fcene qui s'offre a
fes regards ,
&
baque grande partie
d~
cetre
f~en_e
t ire la beaut' de fon
coloris
de deux JOurs pnnct–
pau
, l'un qui efi la lumiere immédiate du f?leil ,
mais bien te mpérée;
&
l'amre
le
réflet d'un ctel fe –
rein qui répand fur les ombres une douceur agréa–
ble
&
vari ' e.
N
otre obfervateur découvrira une fe conde caufe
principale ge la beauté du
coloris
daos la direB::i on
des rayons qui éclairent les objets de la fce ne ; telle
contrée qni
,a
cerraine heure du jour, fe repréfente
a
l'ceil comme le tablean le plus riant ' paro1t
fans
beauté quelques heures apres , bien que le ciel con–
ferve la m me
[! '
rénité. Un petit nombre d'obferva–
tions fur ce ph ' nomene , feront connoitre au peintre
diffi' rentes fources du beau dans le
coloris.llapprendra
qu un objet paroit dans fa plu grande beaut ' , lorf–
que la lumiere incidente le divife en deux grandes
maífes bienproportionn 'es, l'une claire,
&
l'autre
obfcure.llfentira que l'ceil ne fe repo{¡ avec plaifir
fur une contr ' e, que Iorfque les diverfes couleurs
qu'il y apperc;oir, en tant qu elles font claires
&
obfcure , ne font pas éparfes au hazard
&
fan
or–
dre, mais qu elle fonr diíl:ribu
1
es en deux grouppes
principaux ' enforte que le clair foit oppofé
a
l'obf–
cur. Cette remarque le conduira
a
la connoiffance
générale .d s effets du clair - obfcur
&
des mafres
(
Voye{
le articles
CLAIR-OB
R,
&c.
uppl.
)
d'ou
il
parviendra
a
r econnoitre de myfieres plus
profondement cach '
fur la beauté du
oloris.
En comparant ces deux maífes oppofées , il s ap–
percevra qu elles difputenr entr elles de la pré.6' r n–
ce, tant fur la beauté que fur la vari ' t ' . Le clair le
cbarmera par le riant
&
le gracieux de es belles cou–
leurs
&
par
1
harmonie de leur diíl:riburion ;
l
obf–
cur
l;
touchera par une beaut ' plu male ' par la
vari
't'
des couleurs
&
par leur fe u ; il admirera le
fingulier melange de
partie b 'llames avec des
parties ombre .
Au
milieu d'une infinité de couleurs
fans nom , di verGfiee
&
multipli 'es encore par
mille r
1
tler diff¿rens,
il
{;
ra
ivement frappé
d
s
' el
ir q i conrraíl:ent
s:a
&
la avec l obfcunr ' du
fon d o\t
il
femblent parrir; il fentira que c'efi la ce
qui donne de la vie
l
enfemble ,
&
qui en. rend
l'effet aífur ' .
funi de ces notions fur la beauté du
cQloris
l'ar–
tiíl:e palfe de.
la
comemplarion de la nature
a
celle de
1
are.
I1
obú~n·
commenr les grands maJtres des
école \ éniúenne
&
Flamandes ont
fu
rranfporter
fur le bois
r
la toile les beauré de la nature par un
heur
· cho· · d
ouleurs bi
n
aífonies;
il
admire
C O L
chez lun la v
1
ri
porté
e au
pins baut
&
eh z
l antre la beam du
colons
lev
de
la
du vra1 jufqu
l'id al.
ll
comlll n
chercher p:u
u
ls mo en
p intr
ionr
p
r · -
nus a produire cer etfer magique.
'
1l:
alor qu
il
r"–
connoit qu un
coloris
parfair demande un au
ti
gran
l
g 'nie , gu en fuppote le
etlin corre
d
form
,
que la peinture eíl: bien moin
1
ou ·r
g
'une m
in
exerc ' e
qu'ell n efi: la produéhon d'un h
un: u
g ' nie, d'u n efprit ' lair' par de obl
r
attons tin
~
&
des rech rches profondes
&
d'un goiir
L
mr, qui
faifit toujour
le bon,
&
choiíit
tollJOur
le me1l–
leur.
Apr
S
que le pein e aura form
1
{on goCtt
a
l'ég
rd
de
la
v
' rir '
&
de la beam' du
co!oris,
par l'ob{¡
n· -
cion d
la nature
&
des ou rages d l'art, il fe fer–
vira
encore de ce double fecours ponr apprenJr
l'art dlfficile de colorier.
A 1
imitatiOn d
L
on
rd
de Vmci , il obfer era d'un
~il
' laué par le génie
&
la fagaciré, chaque effet particuli
r
des ouleur
dans la nature ·
&
e gui aprcs le obfervation ref–
tera encore douteux ou ind 'ci , il
'en aífurer pa ·
de eífais
&
des e p riences
f
ires a dcír in.
D'
abord
il
recherche avec attention comment
ce qu'on nomme
1'
ffie
efi produit uniquem nt au
moyen des jours
&
des ombres;
il
coníidere en–
fuite comment a l'aide des
coul~urs
claires
&
obf–
cures on prodnit u n effet analogue au premier
7
qui réfultoit de lalumiere
&
de l'ombre.
Il
fe forme
un recueil des obf r ation que
la
nature luí fournir
la-deífus ,
&
ill augmente de fes p-ropres eífai ; en–
fuite il remarque les cas ou il arrive qu'un. corps
éclairé , oppofé
a
un fond obfcur , ou u n corps ob(:..
cur placé fur un fond clair, produit
1
effet íingulier,
&
prefque magique, d' ' loigner les objets,
&
de
1 s
r eponffer en arri re.
Enfin il obferve en gén ' ralles modifications
&
1
dégradarion des couleurs
a
mefure qu
1'
il
s'en
éloione davantage; comment chaque corp dans fon
éloignement
fu
ceffi rec;oit de plu en pln la reinte
d
la couleur de l'air;
&
omment entin des corps
de cou leur tout-a-fait différente
' vus
a
de granJes
difiances, prennent tous la couleur commune d une
perfpeéli e aérienne
?
C'efi un phénomene pitroref–
qne effentiel
a
obferver.
La re herch des caufes qui produifent
1
harmo.;
nie de couleurs n exige pa une ' mde moins lon–
gue ni moins profonde. Norre peimre apprendra
e\
les d
1
couvrir , s'il obferve bien comment un objer,
a
l'a!de de fa lumiere ou de fa couleur, femble
'avan–
cer hors du reíl:e de la maffe.,
&
s'en d
1
tach de ma–
niere a ne pouvoir etre confondu ni réuni
avec
les
autres objet : des-la il commencera
a
fentir com–
ment par un effet contraire, diver objers peuvent
fe perdre dan une feule maífe ;
&
il comprendra
pourguoi il faut en rel endroit un jour ou une
cou~
leur plus vive,
&
en tel autre , une lumiere ou une
couleur plus tempér
1
e.
La
plus grande difficulté fera d'acquérir une con–
noiffance exaé:te de
1
affoibliífement fucceffif des cou–
leurs propres de chaque objet , depuis le poinr l
plus 'clairé jufqll'a
1
ombre la plus forre. La fcíence
des demi-reintes (
Voye{
DEMI-TEI
· T
,
uppl.)
efi peut- "trece que l'art du
coloris
a de plu dJfficile ..
e
n'eíl: qu'a orce d'obferver avec de bons yeux
la
nature
&
les ouvrag
s
des maitr s de l'arr, qu'on
peut fe flatter d'y
r
' uílir.
A
ces études fe joint enfin celle des réflets.
e
font les reflets qui produifent le plus hau
dé–
gré de vérité , accompagnc la plus grande vari
'té.
etre panie
au refte , n'a dans
la th
'orie que pcn
de difficulré ; mélls
lle
fi: d un d 'tail p
~nible
dans
1
.x.
' en
ion.
'homm
















