
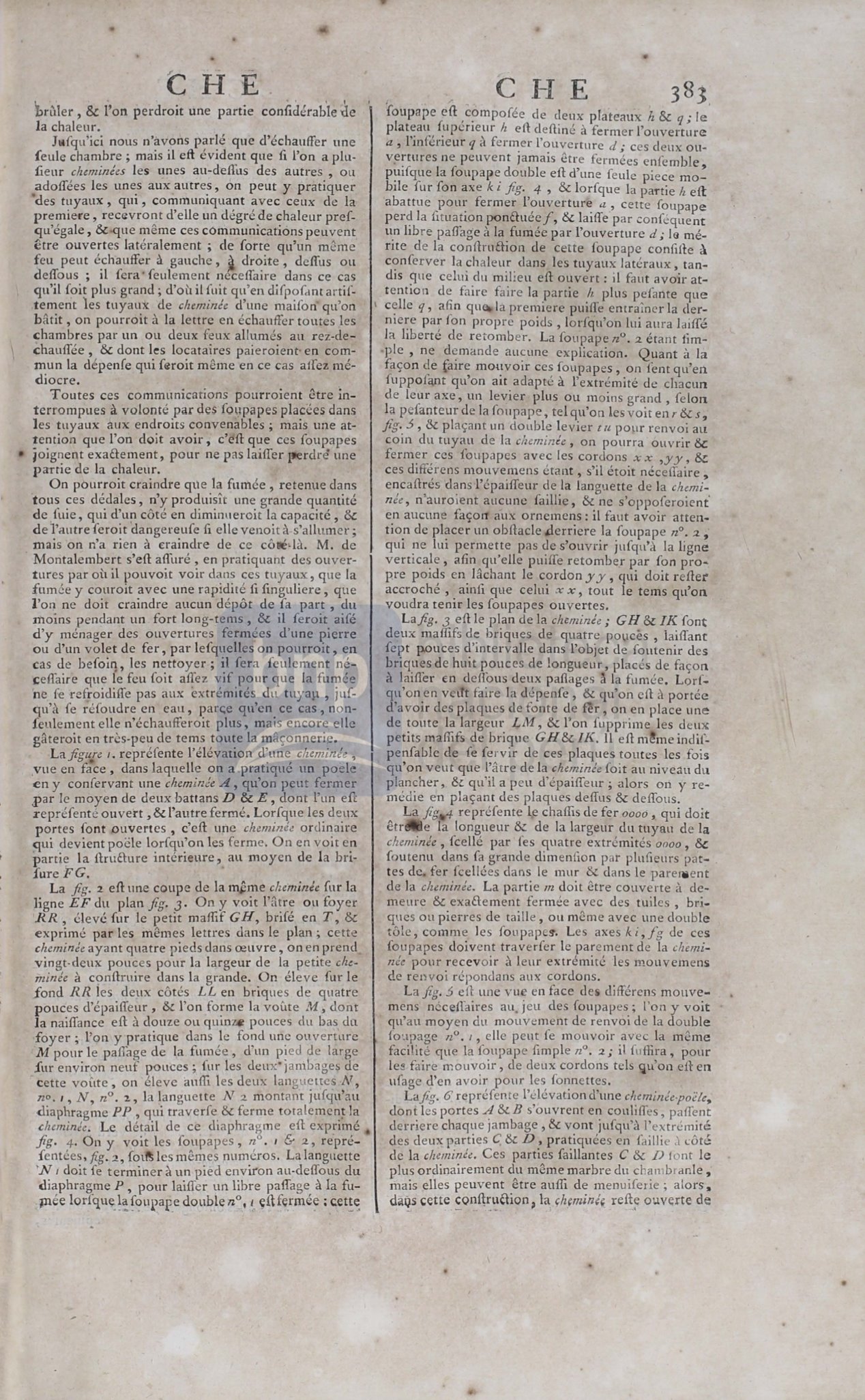
tHE
brUler,
&
l'on perdroit une partie confidérabie xle
'
la chaleur.
J~jfqu'ici
nous n'avons parlé que d'écbanffer une
{eule chambre ; mais
il
eft évident que fi l'on a plu–
íieur
cheminées
les
~nes
au-deffus des autres , ou
adoífées les une.s aux
autre~,
6n peut y pratiquer
des tuyaux, qm, comrnumquant avec ceux de la
premiere,
rec~vront
d'elle un dégré de chaleur pref–
qu'égale'
&
que memeces cómmunicarións peuvent
erre ouvertes latéralement ; de forre qu'un merne
feu peut échauffer
a
gauche,
a
d'roite, deífus
Oll
deífous ; il fera · feulement neceffaire dans ce cas
qu'il
í~it
plus grand; d'ort
il
fuít qteen difpofdnt artif–
tement les tuyaux de
cheminée
d'une maifon qu'on
batit ' on pourroit
a
la lettre en échauffer toutes les
chambres par un ou deux feux all-u,més au rez-de–
chauffée ,
&
dont les locataires paieroient- en com–
mun la dépenfe qui f€roit meme en cecas. affez mé–
diocre.
Toutes ces communicarions pourroient etre in–
terrompues
a
volonté par des foupapes placées dans
les tuyaux aux endroits convenables ; mais une at–
tention que l'on
doit
avoir, c'efr que ces foupapes
• joignent exaél:ement, pour ne pas laiífer ¡:Jerdre une
parrie de la chaleur.
On pourroit craindre qüe la fumée , retenue dans
tous ces dédales, n'y produisit une grande quantité
de ,íuie' qui d'un coté en diminueroit la capacité'
&
de 1'antre feroit dangereufe fi ellevenoit a-s'allumer;
mais on n'a rien
a
eraindre de ce cotaé,la.
M.
de
Montalembert s'efi aífuré, en pratiquant des ouver–
tures par oü il pouvoit voir daos ces tuyaux, que la
fumée y couroit avec une rapidité fi finguliere, que
l'on ne doit craindre aucun dépot de fa part , du
moins pendant un fort long-tems,
&
il
feroit aifé
d'y ménager des ouyertures
ferm~es
d'une pierre
ou d'un volet de fer, par lefquelles on pourroit, en
cas de befoiq, les nettoyer ;
il
fera feulement né–
~eífaire
quy
le feu foit aífez vif p<:>ur que la fumée
'ne
f-e
t"efroidiífe pas aux extrémités dn tuya!! ' juf–
qu'a fe réfoudre en eau,
par~e
qu'en ce cas , non–
feulement elle n'échaufferoit plus,
mais
encore elle
gateroit en tres-peu de tems toute la
ma~onnerie.
La
figure
t.
repréfente
1'
élévation d'une
clz.eminée
,
,vue en
f¡ce,
dans laquelle on a .pratiqué
un
poele
en y confervant une
c.lzeminée
A,
qu'on peut fermer
par le moyen de deux battans
D
&
E,
dont l'un eft
repréfenté ouvert, &l'autre fermé. Lorfque les deux
portes font ouvertes , c'efr une
cheminé~ ordi~aire
qui devient poele lorfqu'on les ferme. On en VOit en
parrie la firuél:ure intérieure, a
u m
oyen de la bri–
.:fure
FG.
La
fig.
2
eíl: une coupe de la
m~me
clzeminée
fur la
ligne
EF
du plan
fig.
3.
On y voit l'atre o u foyer
'RR,
élevé fur le petit maffif
GH,
brifé en
T,
&
exprimé par les memes lettres dans le plan ; cette
cheminie
ayant quatre pieds clans reuvre, on en prend
vingt-deux pouces pour la largeur de la petite
che–
minée
a
c~nfiruire
dans la grande. On éleve fur le
fond
RR
les deux cotés
LL
en briques de quatre
pouces d'épaiífeur,
&
l'on forme la voute
Ivf.,
dont
la na1ífance efi a douze ou quinze pouces du has det
foyer· l'on y pratique dans le fond une ou verture
M
pot;r le paífage de la fumée , d'un
p~ed
de large
iur enviran neuf ¡ronces ; fur les deux · Jarnbages de
cette voftte, on éleve
~mffi
les deux langue n es
N,
no.
1,
N,
n°.
2,
la languette
N
2
montant juíqu'au
.cliaphragme
PP
,
qui traverfe
&
ferme
total emen~
la
cheminée.
Le détail de ce diaphragme efi exprimé
fig. 4·
On y voit les foup apes , n° . '
&
2,
re.pré–
{entées,
fig.
2,
fm
les memes numéros. La languette
~N
t
doit fe terminer
a
un pied enviran au-deífous du
diaphragme
p
' pour laiífer un libre paffage a la fu–
lllée
lorfqu~_ ~!
fou
paf..e
double
n°'
~ ~fi
fe.rmée ;
'et~~
•
/<
C HE
383.
foupa'pe efl:
1
c?mpofée de deux plateaux
h
&
q;
le
plateau fupeneur
h
eft: defiiné
a
fermer l'ouverture
a'
l'inférieur
q
a
fermer: l'ouverture
d
.
ces deux ou..
.
.
""
,
vermres ne peuvent Jamais etre fermées enfemble
p~ifque
la foupape_ double efi d'une feule piece
mo~
b1le fur fon axe
k
z
fig. 4
,
&
lorfque la partie
h
elt
abattue
~polll:
fermer
l'?uvertur~
a
,
cette foupape
per~
la tltuatwn
ponél:ue~
f,
&
la1ífe par conféquent
un hbr e paífage a la fumee par l'ouverture
d; la
mé–
rite de la confiruétion de cette foupape confifte
a
c~nferver
la cbaleur dans les tuyaux latéraux
~
tan...
dts que celui dn miEen efi ouvert : il faut avoir at--
. tention de faire faire la partie
!J.
plus pefante que
'
c~lle
q,
afin qn
la premiere puiffe entralner la
der–
me~e pa~
fon propre poids, lorfqu'on lui aura laiffé
la liberte de retomb er. La foupape n°.
2.
érant fim–
ple , ne d:mande
au~une
explication. Quant
a
Ia
fa<;on de fa1re
mo-t~vo1r
ces foupapes, on fent qu'en
fuppofant qu'on al[ adapté a l'extrémité de cbacun
de leur axe, un levier plus o
u
moins grand , felon
la peíanteur de la foupape, tel q_u'on les voit en
r
&
s?
fig..
.5,
&
pla<;ant un double lev1er
tu
pour renvoi au
com du tuyau de la
ckeminée,
on pourra ouvrir
&
fermer ces foupapes avec les cordons
x x
y y
&
ces différens mouvemens étant, s'il étoit
né~eí
faireencafirés dans l'épaiffeur de la languette de la
che.mi:
nie,
n~auroient
au
cune faillie,
&
ne s'oppoferoient·
en aucune fac;oa aux ornemens: il faut avoir atten..
tion de placer un obfiacle Derriere
la
foupape
n°.
2.
.;
qui ne lui permette pas de s'ouvrir jufqu'a la ljgne
vertica~e,
afin qu'elle puiífe retomber par fon pro ...
pre po1ds en lachant le cordon
y y
,
qui doit reítet
accroché , ainfi que celui
x x,
tout le tems qu'on
voudra tenir les foupapes ouvertes.
Lajig. 3
efil
e plan dela
cheminée ; GH
&
IK
font
deux maffifs de
briqu.esde quatre poucés , iaiífant
fept p.ouces d'i
ntervalledans l'objet de foutenir des
briques de huit pouces de longueur, plac és de fas:on
a laiífer en deffous deux pafiages
a
la fumée. Lorf–
qn'on en veut faire
la
dépenfe'
&
qu'on efi
a
portée
d'avoir des plaques de fonte de rer' on en place une
de toute la largeur
LM,
&
l'on fupprime les deux
petits maffifs de brique
GH
&
IK.
Il
efi m me indif:.
penfable de fe fe rvir de ces plaques toutes les fois
qn'on veut que l'atre de la
cheminée
foit au niveau du
plancher,
&
qu'il a peu d'épaiifeur; alors on
y
re–
médie en plac;ant des plaques
~eífus
&
deffous.
La
fi'g
4
repréfente
~e
chaflis de fer
ooo6,
qui doit
etr
e la longueur
&
de la largeur du tuyall de
la
clzeminie
,
fcellé
par
fes quatre extrémités
oooo,
&
foutenu dans fa grande dimenfion par pluíieurs par–
tes de. fer fcel!ées dans le mur
&
dans le pareJlient
de la
chemini e.
La partie
m
doit etre couverte
a
de~
meure
&
exaél:ement fermée avec des tuiles , bri–
ques ou pierres de taille ' ou meme avec une double
tole, comme les foup apes-. Les axes
k
i,
f g
de ces
íoupapes doivent traverfer le parement de la
chemi–
n ée
pour recevoir a leur extrémiré les mouvetnens
de renvo i répondans aux cordons.
La
fig. .5
eíl une v ue en fa ce de différens mouve–
mens néceíraires au jeu des foupap es; l'on
y
voit
qu'au moyen du mouvement de renvoi de la double
fo upage n°.
1 '
elle peut fe mouvoir ave c la meme
facilité que la foupape fimple
n°.
2;
il fu ffira' pour
le~
faire mouvóir, de deux cordons tels qu'on eft en
ufage d,en avoir pour les fonnettes.
Lafig. 6
repréfent<:;> l'élévation d'une
che.miné.e-poiile,
dont les portes
A
&
B
s'ouvrent en couliífes , paffent
derriere chaque jambage,
&
vont jufqu'é\ 1'extrémité
des deux parties
e
&
D,
pratiquées en faillie ,1 <.:oté
de la
chÚJZinée.
Ces parties faillantes
e
&
D
font le
plus
or~inairement
du meme marbre du chambranle,
mais elles peuvent etre auffi de menuiferie ; alors
~
da?s cette
~on.ít:uaion
P
la,
r;h.~minl~ reft~ ouv~rte
de
\
,
















