
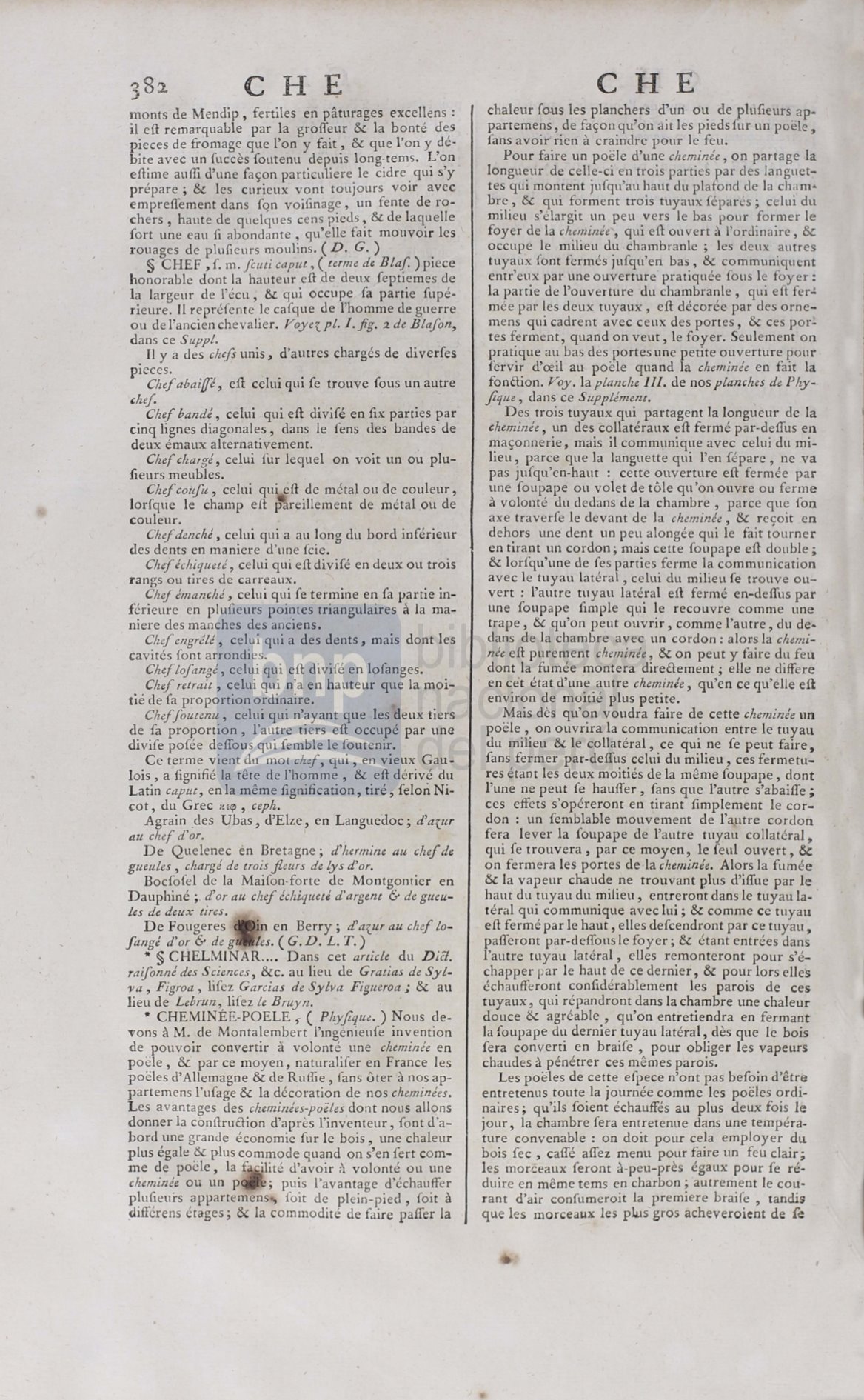
CHE
monts
de
Mendip, fertiles en pftturages excellens :
il
efi: remarquable par la groffeur
&
la bonté des
pieces de fromage que l'on y fait,
&
que l'on
y
dé–
bite
avec
un Cueces foutenu depuis long-tems. L'on
efiime auffi d'une
fa~on
particnliere le cidre. qui s'y
prépare ;
&
les curieux
ont toujours vo1r avec
empreífement dans fon voiíinage, un fente de ro–
chers, haute de quelques cens pieds,
&
de laquelle
fort une eau íi abondante
~ qu~elle
fait mouvoir les
rouages de plufieurs moulins.
(D. G.)
.
§
CHEF, f. m.
fcuti capttt,
(
terme de Blaf)
p1ece
honorable dont la hauteur efi de deux feptiemes de
la Iargeur de
1
'cu,
&
qui occupe fa partie fupé–
rieure.
I1
repréfente le cafque de rhomme de guerre
ou de
1
ancien chevalier.
V()ye{pL.
l.fig.
:2.
de BLafon,
dans ce
SuppL.
11
y a des
chifs
unis, d'autres chargés de di verfes
pieces.
Chefahaif!é,
eft celui qui fe trouve fous un autre
'hif.
Chef bandé,
celui qui efi divifé en
úx
parries par
cinq lignes diagonales, dans le fens des bandes de
deux émaux alternativement.
Chef chargé,
celui fur lequel on voit un ou plu–
:úeurs meubles.
Chefcoufu,
celu.i qui efi de métal ou de couleur,
lorfque le champ efi pareillement de métal ou de
couleur.
Chefde!Zché,
celui qui a a
u
long du bord inférieur
des dents en maniere d'une fcie.
Cheféchiqueté ,
celui qui efr divifé en deux ou trois
rangs ou tires de carreaux.
Chef émanclzé,
celui qui fe termine en fa parrie in–
férieure en plufieurs pointes triangulaires
a
la ma–
niere des manches des anciens.
Chefengrélé,
celui qui a des dents, mais dont les
cavités font arrondies.
Cheflofangé,
celui
qui
efr divifé en lofanges.
Chif retrait,
celui qui n'a en hauteur que la moi–
tié
de fa proportion ordinaire.
Cheffoutenu,
celui qui n'ayant que les deux tiers
<le fa proportion, l'autre tiers efi occupé par une
divife pofée deífous qui femble le foutenir.
Ce terme vient du mor
chef,
qui, en vieux Gau–
lois, a fignifié la tete de l'homme ,
&
efi dérivé du
Latin
caput,
en la meme fignification, tiré, felori Ni–
cot,
du Grec
Y.ftp ,
ceph.
Agrain .des Ubas, d'Elze, en Languedoc;
d'atur
au
chef d'er.
De Quelenec én Bretagne;
d'hermine au chefde
gueules, chargé de trois jleurs de lys d'or.
Bocfofel de la Maifon-forte de Montgontier en
Dauphiné;
d'or au chef échü¡ueté d'argent
&
de gueu–
les de deux tires.
De Fougeres
in
en Berry;
d'atur au chef Lo-
fangé d'or
&
de g
les.
(
G.D.
L. T.)
*
§
CHELMINAR...• Dans cet
article
du
Di
él.
raifonné des Sciences,
&c.
au lieu de
Gratias de Syl–
'Jia, Figroa,
liíi
z
Garcias de Syl-va Figueroa;
&
an
lieu de
Lebrun,_lifez Le Bruyn.
" CHEMlNEE-POELE, (
Phyjique.
)
Nous de–
vons
a
M. de Montalembert l'mgenieufe invention
rle pouvoir convertir
a
volonré une
cheminée
en
po ..le ,
&
par ce moyen, naturalifer en France les
poeles d'Allemagne
&
de Ruffie, fans
o
ter
a
nos ap–
partemens l'ufage
&
la décoration de nos
cheminées.
Les avantages des
clzeminées-poeLes
dont nous allons
donner la confirutlion d'apr s l'inventeur, font d'a–
bord une grande économie fur le bois , une chaleur
plus égale
-~
plus commode quand on s'en fert com–
me de po le' la
f¡
ilit ' d'a oír
a
volonté ou une
cheminée
ou un p
e; puis 1•avantage d'échauffer
pluíieurs appartemens-, foit de plein-pied ' foit
a
.différens érages;
&
la commodité de faire paífer la
CHE
chaleur
fo.usles planchers d'un ou de plnfieurs ap–
parremens, de
fa~on
qu'on
ir les pieds fur un poele,
fans avoir ríen
a
craindre pour le feu.
Pour faire un poele d'une
eh minée,
on partage
la
longueur de celle-ci en trois parties par des languet–
tes qui monrent jufqu'au haut du plafond de la cham•
bre,
&
qui forment trois tuyaux fépar és;
e
lui du
milieu s'élargit un peu vers le bas pour former le
foyer de
la
cheminée'
qui efi ouvert
a
l'orclinaire'
&
occupe le milieu du chambranle ; les deux autres
tuyaux font fermés jufqu'en bas,
&
communiquent
entr'eux par une ouverture pratiquée fous le foyer:
la parrie de l'ouverture du chambranle, qui efi: fer–
mée par les deux tuyaux, efi décorée par des orne–
mens qui cadrent avec ceux des portes,
&
ces por–
tes ferment, quand on veut, le foyer. Seulemenr on
pratique au bas des portes une petite ouverture pour
fervir d'oeil au poele quand
la
cheminée
en fait la
foné1ion.
Voy.
la
planche
111.
de nos
planches de
P
hy-
jique,
dans ce
SuppLément.
Des trois tuyaux qui partagent la longueur de la
cheminée,
un des collaréraux efi fermé par-deífus en
ma~onnerie,
mais il communique avee celuí du mi–
lieu, paree que la languette qui l'en
íi'
pare, ne va
pas jufqu'en-haut : cette ouverture efi ferm 'e par
une foupape ou volet de tole
qu
'on ouvre ou ferme
a
volonté du dedans de la chambre ' paree que fon
axe traverfe le devant de la
cheminée,
&
re~oit
en
dehors une dent un peu alongée qui le fair tourner
en tiram un cordon; mais cette foupape
efr
double;
&
lorfqu'une de fes parties ferme la communication
ave
e
le tuyau latéral , celui du milieu fe trouve ou–
vert : l'autre tuyau latéral efi fermé en-deífus par
une foupape fimple qui le recouvre comme une
trape,
&
qu'on peut ouvrir, comme l'autre, du de–
dans de la chambre avec un cordon: alors la
chemi–
née
efi purement
cheminée,
&
on peut y faire du feu
dont la fumée montera diretlement; elle ne differe
en cet érat d'une autre
cheminée,
qu'en ce qu'elle eíl:
environ de moiti'
plus petite.
Mais des qu'on
voud.rafaire de cette
cheminée
un
poele, on ouvrira la communication entre le ruyau
du milieu
&
le collaréral, ce qui ne fe peut faire
fans fermer par-delfus celui du milieu, ces
fermetu~
res étant les deux moitiés de la meme foupape' dont
l'une ne peut fe hauffer, fans que l'autre s'abaiífe •
~
'
1
,
ces enets s opereront en tirant fimplement le cor-
don : un femblable mouvement de l'autre cordon
fera lever
la
foupape de l'autre tuyau collatéral
qui
fe trouvera, par ce moyen, le fenl ouvert,
&
on fermera les portes de la
cheminée.
Alors la fumée
&
la vapeur chancle ne trouvant plus d'iífue par le
haut du ruyau du milieu, entreront dans le tuyau la–
téral qui communique avee lui;
&
comme ce tuya
u
efi fermé par le haut, elles defcendront par ce tuyau,
paíferont par-deífous
le
foyer;
&
étant entrées dans
l'autre tuyau latéral, elles remonteront pour s'é–
chapper par le haut de ce dernier,
&
pour lors elles
échaufferont coníidérablement les parois de ces
tuyaux, qui répandront dans la chambre une chaleur
douce
&
agréable , qu'on entretiendra en fermant
la foupape du dernier tuya u latéral, des que le
bois
fera converti en braife , pour obliger les vapeurs
chaudes a pénétrer ces memes parois.
Les poeles de cette efpece n'ont pas befoin d'etre
entretenus toute la journée comme les poeles ordi–
naires; qu'ils foient échauffés au plus deux fois le
jour, la chambre fera emrerenue dans une tempéra–
ture convenable : on doit pour cela employer du
bois fe e , caífé aífez menu pour faire un feu
clair;
les
mor~eaux
feront a-peu-pres égaux pour fe ré–
duire en meme tems en charbon; autrement le
COU·
rant d'air confumeroit la premiere brai(e , tandis
que les morceaux les
plus~
gros acheveroient de fe
















