
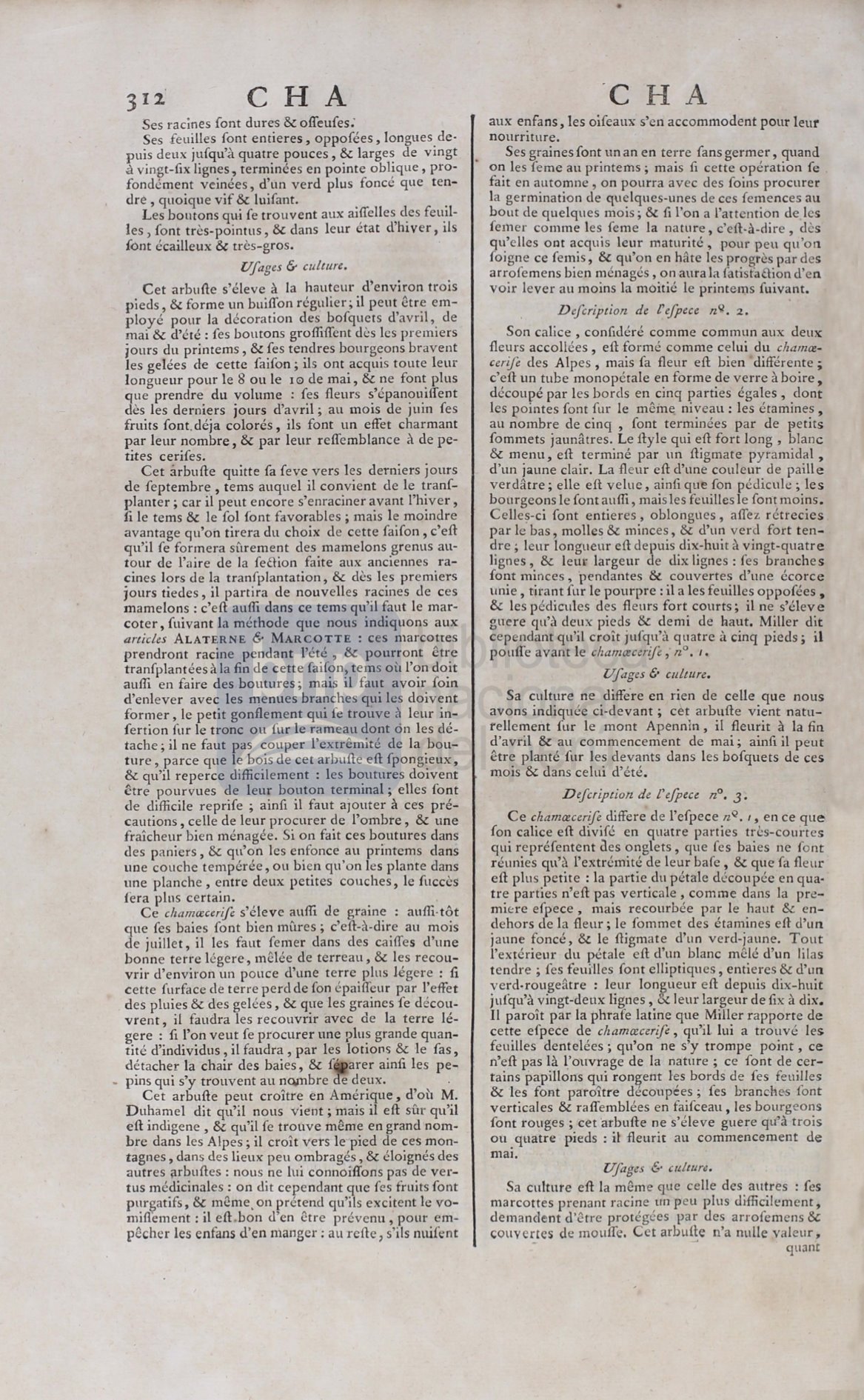
CHA
Ses
racines font dures
&
offeufes:
Ses fe uilles font en tieres_, oppofées _, Iongues de–
puis deux jufqu'a quatre pouces,
&
larges de vingt
a
vingt-fix lignes' terrninées en pointe oblique' pro–
fondément veinées, d'un verd plus foncé que ten-
dre, quoique vif
&
luifant.
.
.Les boutons qui fe trouvent aux ai!felles,
~es
feu.Il–les) font tres-pointus, & dans leur etat
d
h1ver, 1ls
f<>nt écailleux
&
tres-gros.
Ufages
&
culture.
Cet arbufie s'éleve a la hauteur d'environ trois
pieds'
&
forme un buiífon régulier; il peut etre em–
ployé pour la décoration des bofquets d'avril, de
mai
&
d'été : fes boutons groffilfent des les premiers
jours du printems,
&
fes tendres bourgeons bravent
les gelées
de
cette faifon; ils ont acquis toute leur
longueur pour le
8
oule
10
de mai,
&
oe font plus
que prendre du volume : fes fleurs s'épanouiífent
des les derniers jours d'avril ; au mois de juin fes
fruits font. déja colorés, ils font un effet charmant
par leur nombre'
&
par leur reffemblance
a
de pe–
tites cerifes.
Cet árbuíl:e quitte fa feve vers les derniers jours
de feptembre , tems auquel il convient de le tranf–
planter; car il peut encore s'enraciner avant l'hiver,
file tems
&
le fol font favorables; mais le moindre
avantage qu'on tirera du choix de cette faifon,
c~efr
qu'il fe formera sftrement des mamelons grenus au–
tour de l'aire de la feétion faite aux anciennes ra–
cines lors de la tranfplantation,
&
des les premiers
jours tiedes, il partira de nouvelles racines de ces
mamelons : c'efi auffi daos ce teros qu'il faut le mar–
coter, fuivant la méthode que nous indiquons aux
articles
ALATERNE
&
MARCOTTE :
ces marcottes
prendront racine pendant l'été ' & pourront etre
tranfplantées a la fin de cette faifon, teros Ottl'on doit
auffi en faire des boutures; mais il faut avoir {oin
d'enlever avec les menues branches qui les doivent
former' le petit gonflement qui fe trouve
a
leur in–
fertion fur le tronc o u fur le rameau dont ón les dé–
tache; il ne faut pas couper l'exrremité de la bou–
ture, paree que le bois de cet arbufi:e eft fpongieux,
& qu'il reperce difficilement : les boutures doivent
etre pourvues de leur bouton terminal ; elles font
de difficile reprife ; ainfi il faut ajouter a ces pré–
cautions, celle de leur procurer de l'ombre,
&
une
fraicheur bien ménagée. Si on fait ces boutures dans
des paniers,
&
qu'on les enfonce au printems dans
une couche tempérée, ou bien qu'on les plante dans
une planche , entre deux petites couches, le fucces
[era
plus certain.
Ce
chamacerife
s'éleve auffi de graine : auffi-tot
que fes baies font bien mfu-es ; c'eft-a-dire au mois
de juillet, il les faut femer daos des caiífes d'une
bonne terre légere' melée de terreau'
&
les recou–
vrir d'environ un pouce d'une terre plus légere :
fi
cette furface de terre perdde fon épaiífeur par l'effet
des pluies
&
des gelées,
&
que les graines
{e
décou–
vrent, il faudra les recouvrir avec de la terre lé–
gere :
fi.
l'on veut fe procurer une plus grande quan–
tité d'individus, il faudra , par les lotions
&
le fas,
détacher la chair des baies,
&
{¡'
arer ainfi les pe..,
.. pins qui s'y trouvent au nombre e deux.
.
Cet arbufte peut croitre en Amérique _, d'otl
M.
Duhamel dit qu'il nous v ient ; mais il efl:
sur
qu'il
efi indigene'
&
qu'il fe trouve meme en grand nom–
bre dans les Alpes; il croit vers le pied de ces mon–
tagnes, dans des lieux peu ombragés,
&
éloignés des
autres flrbufi:es : nous ne lui connoiffons pas de ver–
tus médicinales: on dit cependant que fes fruits font
purgatifs'
&
meme. on prétend qu'ils excitent levo–
mifie ment: il eft bon cl'en etre prévenu' pour em–
pecher
les
enfans d'en manger: a
u
reft e, s,ils nuiient
aux enfans, les oifeaux s'en accommodent pour leur
nourriture.
.
Ses graines font unan en terre fans germer, quand
o~
les fe me au printems; mais fi cette opération fe
falt en automne , on pourra avec des foins procurer
la germination de quelques-unes de ces {emences au
bout de quelques mois;
&
fi l'on a l'attention de les
femer comme les feme la nature, c'efi-a-di re , des
qt~'elles
oot
a~qu is le~r matu~ité,
pour peu qu'o n
fo1gne ce fem1s,
&
qu on en hate les progres par des
arrofemens bien ménagés, on aura la fatisfaétion d'en
voir lever au moins la moitié le printems fuivant.
D efcription de l'efpece n9 .
.z.
Son calice , coníidéré comme commun aux deux:
fleurs accollées, efr formé comme celui du
chama–
cerife
des Alpes , mais fa fleur efi: bien différente ;
c'eft un tube monopétale en forme de verre a boire,
découpé par les bords en cinq parties égales, dont
les pointes font fur le meme niveau : les étamines,
au nombre de cinq , font terminées par de petits
fommets jaunatres. Le fryle qui efi fort long , blanc
&
menu_, efr terminé par un fiigmate py ramidal ,
d'un jaune clair. La fleur efr d'une couleur de paille
verdatre; elle efi velue, ainfi que fon pédicnle ; les
bourgeons le font auffi, maisles feuillesle fontmoins.
Ce1le~-ci
font entieres, oblongues, aífez r étrecies
par le has,
molle~
&
minces,
&
d'un verd fort teo–
dre; leur longueur eft depuis dix-huit a vingt-quatre
lignes , & leur largeur de dix lignes : fes branche
s
font minces, pendantes
&
couvertes d\1ne écorce
u
nie, njrant fur le pourpre : il a les feuilles oppofées
~
&
les pédicules des fleurs fort courts; il ne s'éleve
guere qu'a deux pieds
&
demi de haut. Miller dit
cependant qu'il croit jufqu'a quatre
a
cinq pieds;
il
pouífe avant le
chama cerife ; n ° .
1.
.
llfages
&
wlture.
Sa culture ne differe en rien de celle que nous
avons indiquée ci-devant; cet arbufie vient natu–
rellement fur le mont Apenn!n, il fleurit a la fin
d'avril
&
au commencement de mai; ainfi il peut
etre planté fur les devants dans les bofquets de ces
mois
&
dans celui d'été.
Defcrip tion de l'efpece n°. 3·
Ce
chamacerife
differe de l'efpece
nQ.
1
_,
en ce que
fon calice efi divifé en qucm·e parties tres-courres
qui repréfentent aes onglets' que fes baies ne font
réunies qu'a l'extrémité de leur bafe,
&
que fa fleur
efi plus petite : la partie du pétale découpée en qua4
tre parties n'efi pas verticale, comme dans la pre–
mi.ere efpece, mais recourbée par le haut
&
en–
dehors de la fleur; le fommet des étamines efi d'un
jaune foncé,
&
le fiigmate d'un verd-jaune. Tout
l'extérieur du pétale efi: d'un blanc melé d'un li las
tendre ; fes feui'lles font elliptiques, entieres
&
d'un
verd·rougeatre : leur longueur efi: depuis dix-huit
jufqu'a vingt-deux lignes'
&
leur largeur de fix a dix.
Il
paroit par la phrafe latine que Miller rapporte de
cette efpece de
chamacerife,
qu'illui a trouvé les
feuilles dentelées; qu'on ne s'y trompe point, ce
n'efi: pas la l_'ouvrage de la nature ; ce font de cer–
tains pap'illons qui rongent les bords de fes feuilles
&
les font paro1tre découpées; fes brancaes font
verticales
&
raífemblées en faifceau, les bourgeons
font rouges ; cet 'arbufie ne s'éleve guere qu'a trois
ou quatre pieds : il fleurit au commencement
de
rnai.
llfages
&
eulture .
Sa culture eft la meme EJ::J e celle des autres : fes
marcottes prenant racine
un
pe
u
plus difficilement,
demandent d'e tre prorégées par des arrofemens
&
couvertes
de
rnoulfe.
Cet arb1..tfte n'a nulle valeur ,
qnant
















