
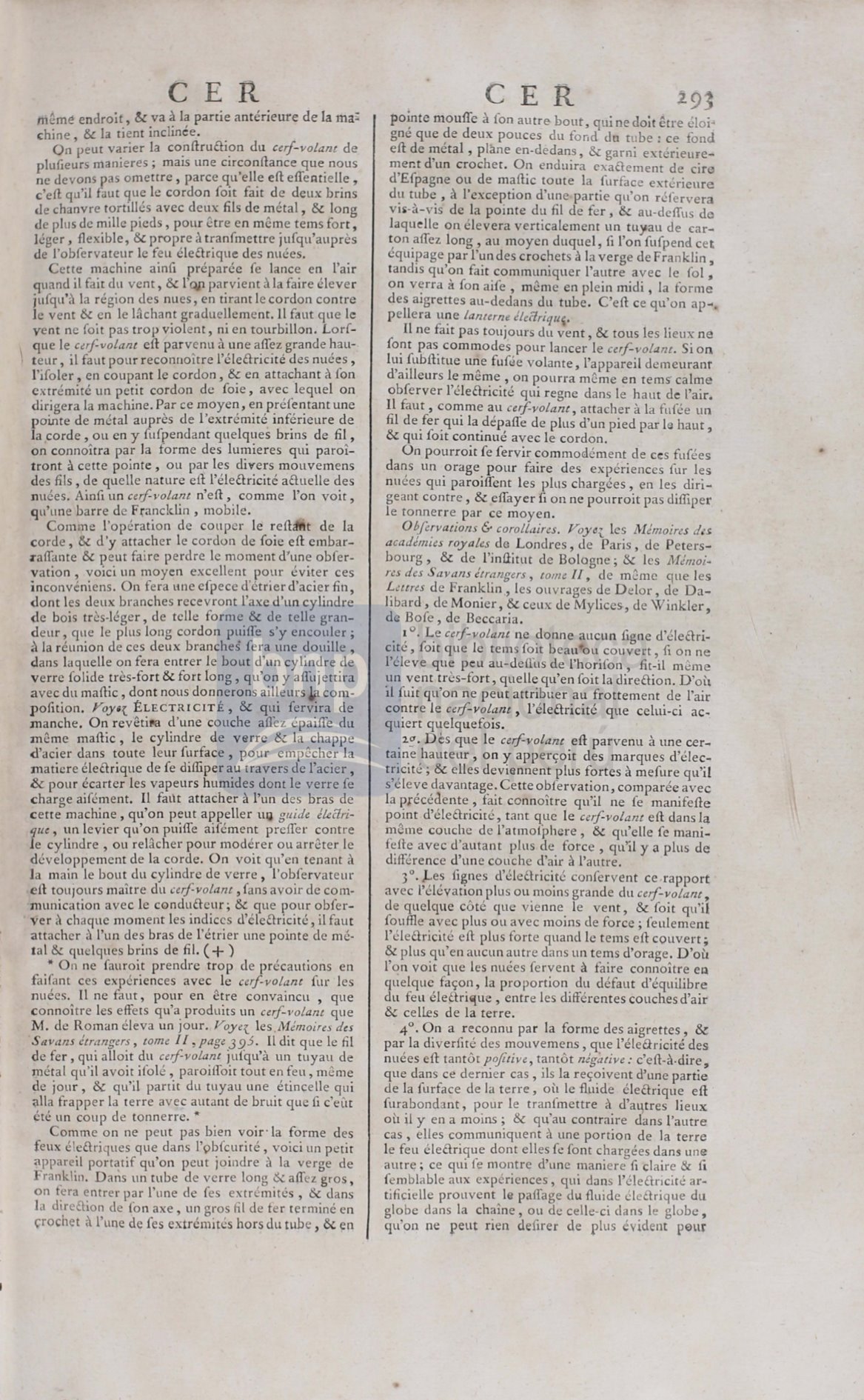
e
E
mtme
endroit)
&
va
a
la panie ant
1
rieure
de
la
ma:
chine
&
la
rient inclinée.
On peur aríer la co.níl:ruéti?n du
cerf-volant
de
plufieurs manieres; ma1s une ctrconíl:ance que nous
ne devons pas ometrre , paree q.u'ell.e eíl:
eífeRtiel~e,
e
eft qu'il faut que le cordon Íolt fatt de deux bnns
de chanvre rortiU
's
avec deux fils de métal,
&
long
de plus de mille pieds, pour "tre en m"' me tems fort,
l~ger,
flexible,
&
propre
a
tranfmettre jufqu'aupres
de l'obfervateur le feu éleétrique des nu 'es.
ette machine ainíi préparée fe lance en l'air
quand il fait, d.u vent ,
&
1'
o
pa:vient
a
la faire élever
jufqu
a
la reg10n des nues, en urantle cordon centre
1
vent
&
en le lachant graduellement.
Il
faut que le
vent ne foit pas trop violent, ni en tourbillon. Lorf–
que le
eufvolant
eít parv;nu
<:~,une
a.íf:z.grande
~au
teur,
il
faut pour reconnoltre
1
leét
nc1te des nuees,
l'ifoler, en coupant le cordon,
&:
en attachant
a
fon
extrémité un petit cordon de f01e, a
ve
e
lequel on
dirigera la
m
a hine.
P~r
ce
~oye~, ~n,P;éf;~tant
une
pointe de
m '
tal aupres de
1
extr mlt
mfi
neure de
la corde, ou en
y
fufpendant quelques brins de fil,
on connoitra par Ja forme des lumieres qui paroi–
tront
a
cette poÍnte ,
Oll
par les divers mouvemens
des fils, de quelle nature eíl: l'éleétricité aétuelle des
nuées. Ainíi un
ce,f-volant
n'efi, comme l'on voit,
qn'une barre de Francldin, mobile.
Com e l'opération de conp r le reíl:
t de la
corde ,
d 'y attacher le c01·don de foie efi embar–
raífante
&
peut faire perdre le moment d
1
une obfer–
vation , voici un moyen excellent pour évirer ces
inconvéniens. On fera une efpece d'étrierd'acier fin,
dont les deux branches recevront l'axe d'un cylindre
de bois tres·léger, de tclle forme
&
de telle gran–
deur, que le plus long cordon puiífe s'y encouler ;
a
la réunion de ces deux branche§ {era une douille '
dans laquelle on fera enrrer le bout d'un cylindre de
verre folide tres-fort
&
forr long, qu'on y aíl'ujetrira
avee du maftic, dont nous donnerons ailleurs
com–
pofition.
Yoyi{
ÉLECTRICITÉ,
&
qui fervira de
manche. On revetiPa d'une couche aí:lez
1
paiífe du
meme mafiic, le cylindre de V€rre
&
la chappe
<l'acier dans toute leur furface, pour emp"cher la
mariere éleéhique de fe diffiper au travers de 1acier,
&
pour écarter les vapeurs humides dont le verre fe
charge ai(i' ment. Il faüt attacher a l'un des bras de
cette machine, qu'on peut appeller
UQ
guide éteari–
que,
un levíer qu'on puiífe aifément preífer centre
le
cylindre ,
Oll
relacher pour modérer
OU
arreter le
développement de la corde. On voit qu'en tenant
a
la main le bout du cylindre de verre, l'obfervateur
eít tOLIJOUrs maiu·e du
arfvolant,
fans avoir de com–
municarion avec le conduéteur;
&
que pour obfer–
ver
a
chaqne rnoment les índices d'éleéhicité' il faut
attacher a
1
un des bras de l'étrier une pointe de mé·
tal
&
qu lques brins de
fil.
e+)
*
On ne fauroit prendre trop de pr ' cautions en
faifant ces expériences avec le
cerf-volant
fur les
nuées. ll ne faut' pour en etre convaincn ' que
connoitre les effets qu'a produits un
cerf-volant
que
M. d Roman éleva un jour.
Voye{
les
MJmoires des
Sllvans étrangers, tome
JI
,page39j.
Ildit que le fil
d fer, qui alloit du
e rfvolant
juiqu'a un tuyau de
m ' tal qu'il avoit i{ol ' ' paroiífoir tout en feu' meme
d
jour,
&
qu'il partir du tuyau une étincelle qui
alta frapper la terre avec autanr de bruit qu íi c'eut
'té
un coup de tonnerr .
*
omme on ne peut pas bien oir·la forme des
feux '\ étriques que dans l'obfcurité, OlCI un p tit
appareil portatif qu on peut joindre
a
la
erge de
rank\in.
Dans un tube de v rre long
' aífez gros,
on fera entrer par !'une de fe
e.·tr ' mi té
dans
la direétion de fon axe , un gros fil de
f
r terminé en
(fO,het
a
l'une de fes extrémit
' S
hors du tube,
&
en
E
pointe mouffi
a
fon autre bout qui ne oit "u e
loi–
gné que de deux pouces du fo;.d du tt be : ce fond
eíl: de
m'
tal , plane en-dedans
~
garni e:\.t rieure–
mer.t d un crochet. On nduira
e
aétemen de
ir
d'Efpagne ou de maíl:ic toute la furface
e.~
rienre
du tube' a l'exception d'une partie qu'on réfervera
vis-a-,·is de la pointe du fil de
fi
r,
&
au-deífu d
laquelle on elevera venicalement un tuyau de
car-.
~on
.aífez long, au rnoyen duque!,
fi
l'on fufpend cet
eqmpage par l'un des crochets
a
la verge de Franklin,
tandts qu'on fait communiquer
1
autre avec le
fol,
on
v~rra
a
fon aife' m"me en plein midi' la forme
des a1grettes au-dedans du tube. C'eft ce qu'on ap ....
pellera
m;
e
lamerne éLeRriqu .•
Il
ne fa1t pas toujours du vent,
&
tous les lieux ne
fo?t pas. commodes pour Iancer le
cerf-volant.
Si on
h!1 _fuhíl:ttue
u~
e fuíi ' e volante,
1
appareil d meuranr
d a1lleurs le meme , on pourra rneme en tems· calme
obferver
1
'leétricité qui regne dan le haut de l'air.
Il
faut, comme a
u
cerf-volant,
attacher a la fnfée un
fil de .fer.qui la .dép,aífe de plus d'un pied par le haut,
&
qm fo1t contmue avec le cordon.
On pourroit fe fervir commoa ' ment de
c~:s
fu(.' es
dans un orage pour faire des exp ' rienc s fur
les
nuées qui paroiífent les plus chargées, en les diri–
geant contre,
&
eífayer
fi
on ne pourroit pas diffiper
le tonnerre par ce moyeo.
Obflrvations
&
coroll tir s.
Voy~z
les
friémoires d;s
académi.esroyales
d~
Londres, de París, de Peters–
bourg, &de l'infritut de Bologne;
&
les
.Jlfémoi–
res des Savans étrangers, tome
JI,
de m"me que les
f:ettres
de Franklin, les ouvrages de Delor, de Da–
hbard, de Monier,
&
ceux de Mylices, de Winkler,
d€ Bofe, de Beccaria.
1°.
Le
cerf-volant
ne donne aucun íigne d éleétri–
cité, foir que le tems foit bean ou couvert,
fi.
on ne
l'éleve que peu au-de{fus de l'horifon ' fit-il meme
un vent tr ' s-fort, quelle qu'en foit la direétion. D'ot\
il fuit qu on ne peut attribuer au frottement de l'air
centre le
ceif-volant
,
l'éleétricité que celui-ci ac–
quiert quelquefois.
2~.
Des que le
cerfvolant
eft parvenu a une cer....
taine hauteur, on
y
appen;oit des marques d
élec~
triciré;
&
elles deviannent plus fortes a mefure qu'il
s'éleve davantage. Cette obfervation, comparée avec
la précéclente , frut connoitre qu'il ne fe manife.fie
point d'éleétricité, tant que le
e rfvolant
eft dans la
meme couche de l'atmofphere'
&
qu'elle fe mani–
fefie avec d'autant plus de force , qu'il
y
a plus de
différence d'une couche d'air
a
l'aurre.
J
0
•
,Les íignes d'éleéhicit' confervent ce rapport
avec l'élévation plus ou moins grande du.
ee,f-vo!ant
~
de quelque e "té que
ienne le vent,
&
foit qu'il
fouffie ave e plus ou ave e moins de force; feulement
l'éleélricit ' eíl: plus forte quand le tems eíl: couvert;
&
plus qu'en aucun autre dans un tems d'orage. D'ou
l'on voit que les nuées fervent
a
faire connoitre e!l
quelque
fa~on,
la pro portien du défaut d' 'quüibre
du
fe u éleéhi~ue,
entre les différentes couches d'air
&
cell.esde la terre.
4°. Ona reconnu par la forme des aigrettes,
&
par la di eríir ' des mouvemens, que l'éleél:ricité des
nuées ft tantor
pofttive,
tamot
négative:
c
'efi:-a.dire,
que dans ce dernier cas , ils la re<;oivent d
'une partiede la furface de la terre, o1t le fluide éleétrique eft
furabond nt, pour le tranfmettre
a
d'aq.tres lieux
ou
il
y en a moins;
&
qu'au contraire dans l'autre
cas, elles communiquent a une portien de la terre
le fe u éleétrique dont elles fe font chargées dans une
aurre; ce qui fe montre d'une maniere íi claire
&
íi
fernblable aux expériences, qui dans l'éleétncité ar–
tificielle prouvent le paífage du fluide 'learique du
globe dans la chaine, ou de celle-ci dans le globe,
qu on ne peut rien defirer de plus ' ident peur
















