
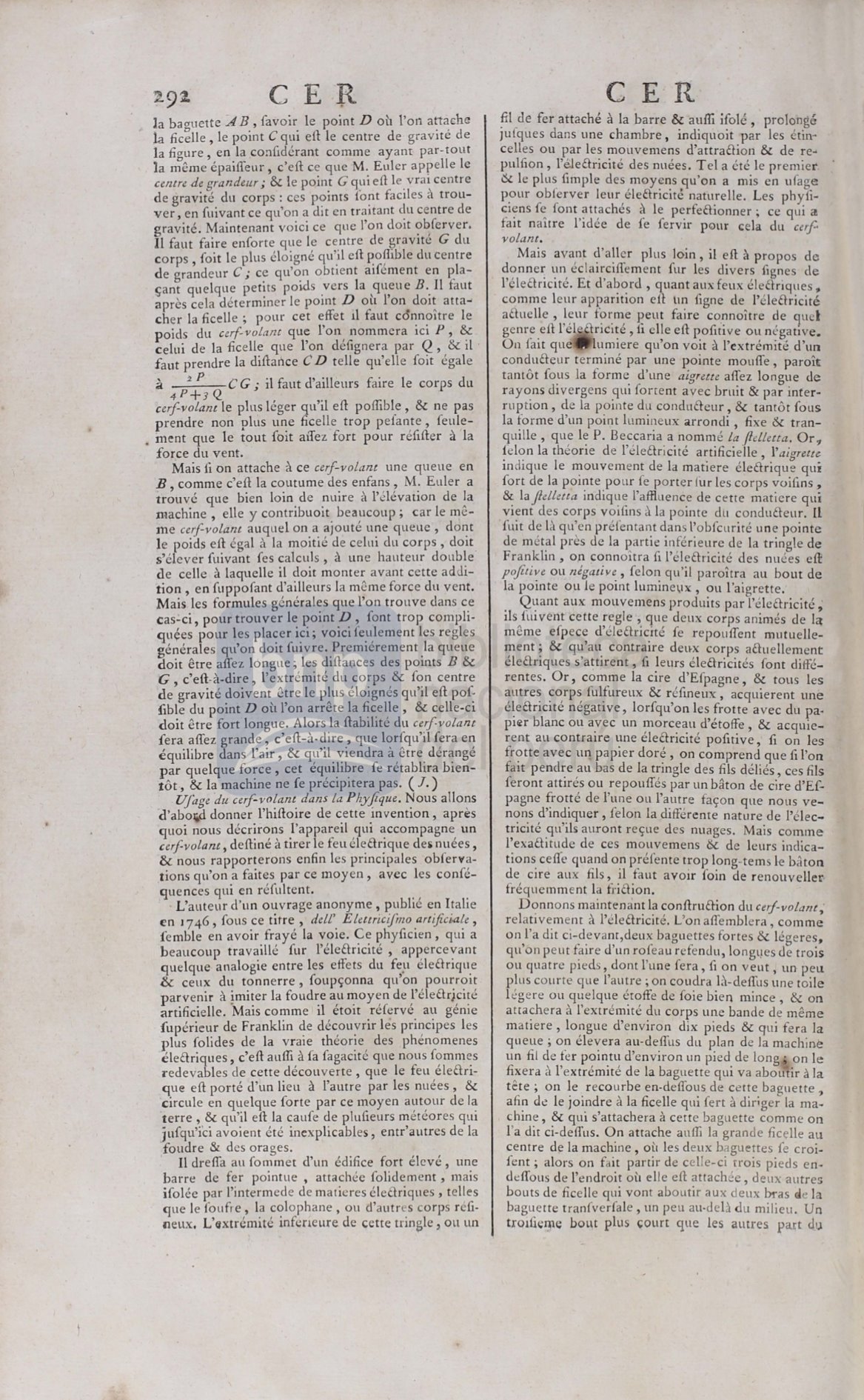
CER
la ba O"uette
A
B,
favoir le point
D
0~1
l'on attache
la
fic~lle'
le point
e
qui eft le centre de gravité de
la fiO'ure, en la conúdérant comme ayam par-tout
la
~eme
épaiífeur, c'eft ce que
M.
Euler appelle le
centre .de grandeur;
&
le point
G
qui efi
le.
vra~
centre
de gravité du corps : ces P?ints
fo~t
faciles a trou–
ver, en fuivant ce qu'on a d1t en trmtant
~u
centre de
gravité. Maintenant voioi ce que l'on do1t
?~ferver.
I1
faut faire enforte que le centre de gravite
G
du
corps foit le plus éloiO'né qu il eft poffible du centre
de
gra~deur
e;
ce
qu'~n
obtient aifément en pla–
~ant
quelque petits poids .vers la ,qu,eueB ..
Il
faut
apres cela déterminer le pomt
D
ou
1
on d01t atta–
cher la ficelle ; pour cet effet
il
faut cdnnoitre le
poids du
cerf-volant
qu~
l'on, nommera ici
P,
~
celui de la ficelle que
1
on deíignera par
Q
,
&
Il
faut prendre la diftance
C
D
telle qu'elle foit égale
a
2
P
CG;
il faut d'ailleurs faire le corps du
4
p
+
3
Q
1
,
''l
ll
/
T.bl&
cerfvolant
le p ns leger qu 1 ea pom e,
ne pas
prendre non olus une ficelle trop pefante , feule–
. rnent que le tout foit aifez forr pour réíifier
a
la
force du vent.
Mais
íi
on attache
a
ce
cerf-volant
une queue en
B
comme c'eft la coutume des enfans,
M.
Euler a
tr~uvé
que bien loin de nuire a
1'
' lévation de la
machine , elle
y
contribuoit beaucoup; car le me–
me
cerfvolant
auquel on a ajouté une queue,
do~t
le
poid,s eil: égal a la moitié de celui du corps ' dOit .
s'élever fuivant fes calculs '
a
une hauteur double
de celle a laquelle il doit monter avant cette addi–
tion' en fuppofant d'ailleurs
la
meme force du vent.
Mais les formules générales que l'on trouve dans ce
cas-ci, pour trou ver le point
D
,
font trop compli–
qu~es
pour les
pla~er i~i;
voici
fe.l~lement
les regles
générales qu'on doit futvre ..Premterement _la queue
doit etre aífez longue; les dtfia.oces des pomts
B
&
G
c'eft-a-dire, l'extrémité du corps
&
fon centre
de'gravité doivem etre le plus éloignés qu'il eft pof..
fible du point
D
ohl'on arrete la ficelle,
&
celle-ci
doit etre fort longue. Alors la il:abilité du
cerfvolant
{era aífez grande, c'efi-a-dire, que lorfqu'il fera en
équilibre dans l'air'
&
qu'il viendra
a
erre dérangé
par quelque force , cet
éq~i~i~re
fe rétablira bien-
,
tót,
&
la machine ne fe prec1p1tera pas.
(J.)
Ufage du cerf-volant dans La Phyjique.
Nous allons
·d'abo1;d donner l'hifioire de cette ín vention, apres
quoi nous décrirons l'appareil qui accompagne un
cerfvolant,
defiiné a tirer le feu éleélrique de¡ nuées'
&
nous rapporterons enfin les principales obferva–
tions qu'on a faites par ce moyen, avec les confé–
quences qui en réfultent.
· L'auteur d'un ouvrage anonyme, publié en Italie
en
1
746 ,
fous ce titre ,
dell' E Lettricifmo artificiale
,
femble en avoir frayé la voie. Ce phyíicien, qui a
beaucoup travaillé fur l'éleélricité , appercevant
quelque analogie entre les effets du
f~.u
éleéhiqu.e
&
ceux du tonnerre, foup<;onna qu on pourrOit
parvenir a !mi!er la
foud~e
a,u
n:oy~n
de
,l'éleélrj,ci~é
artificielle. Ma1s comme 1l etott referve au geme
fupérieur de Franklin
~e
déc,ou:vrir les
pri~cipes
les
plus folides de la vra1e
theor~e,
des phenomenes
éleélriques' c'efi auffi
a
fa fagactte que nous fommes
redevables de cette décou verte, que le feu éleélri–
que eft porté d'un lieu
a
l'autre par les nuées'
&
circule en quelque forte par ce moyen autour de la
terre ,
&
qu'il efi la caufe de pluíieurs méréores qui
jufqu'i'ci avoient été inexplicables, entr'autres de la
foudre
&
des orages.
Il
dreífa au fommet d'un édifice fort élcvé, une
barre de fer pointue , attachée folidement, mais
ifolée par l'intermede de matieres éleélriques, telles
que le foufre, la colophane, ou d'autres corps réfi–
neux .
L'~xtrémité
infeneure de c.:ette tringle, onun
CER
~l _de
fer attaché
a
la barre
&
auffi ifol
t
'
prolongé
JU!ques dans une chambre, indiquoit par les étin–
celles ou par les mouvemens d'attraélion
&
de re...
pulfion, l'éleél:ricité des nuées. Tela été le premier
&
le plus fimple des moy€ns qu'on a mis en ufa O'e
P.our obferver Ieur éleéhicité naturelle. Les phyÍi–
ciens fe font attachés
a
le perfeétionner . ce qui
a
fait nailre l'idée de fe fervir pour
cel~
du
cerf'
volant.
Mais ava,nt
~·a~ler
plus Ioin,
il
eft
a
propos
de
donner un eclatrciífement fur les divers fignes de
l'éleélricité. Et
d'a~~rd
, quant aux feux életlriques
~
comme leur appant10n efl: un figne de l'éleélricité
aéluelle ,
,l~ur f?~~e
peut faire co,nnoitre de qu
1
genre eft
1
eleélnc1te,
íi
elle eft poíitive ou négarive.
On
Ü1it
que
lumiere qu'on voit
a
l'extrémite d'un
condu
éleurterminé par une pointe mouífe, paroit:
tantot
fo.usla forme. d'une
aigrette
aífez longue de
rayc:ns diVergens .qtu fortent a vec brnit
&
par inter–
ru ptwn, de la pomte du conduéleur,
&
tantor fous
la forme d'un point lumineux arrondi , fixe
&
tran–
quille, que le
P.
Beccaria a nommé
Lajfe!letta.
Or~
rel~n
la théorie de l'éleélricité artificielle'
1'
aigrette.
m d1que le
~ouvement
de la
m~tiere
éleélrique qui
fort de la pomte po ur fe porter íur les corps voiúns,
&
la
flelletta
indique l'affluence de cette matiere qui
vient des corps voiíins
a
la pointe du conduéleur.
Il
fuit de la qu'en préfentant dans l'obfcurité une pointe
de métal pres de la partie inférieure de la tringle de
Franklin , o,n
~onnoitra
íi l'éleélricité des nuées
eít
pojitive
ou
négatiye,
felon qu'il paroitra au bout de
la pointe ouie point lumine1,1x, ou l'aigrette.
.
Q~ant
aux mouvemens produits par l'éleélricité;
1ls fmvent cette regle , que deux corps anirnés de la
meme efpece d'éleélrícíté fe repouífent mutuelle–
ment;
&
qu'au contraire deu·x corps aéluellement
éleélriques s'attirent,
íi
leurs éleélricités font diffé–
rentes. Or, comme la cire d'Efpagne,
&
rous les
autres corps fulfureux
&
r éíineux, acquierent une
é~eélricité
négative, lorfqu'on les frotte avec du pa–
pi~r
blanc ou avec un morceau d'étoffe,
&
acquie–
rent au contraire une éleélricité poíitive
fi on les
fr?tte avec un papier doré, on comprend que íi l'on
fa1t pendre a
u
has de la trinO'le des fils déliés ces fils
feront attirés o
u
repouífés par un baton de
ci~e
d'Ef–
pagne frotté de l'une ou l'aurre fa<;on que nous ve–
nons d'indiquer , felon la différente nature de l'élec–
tricité qu'ils auront re<;ue des nuages. Mais comme
l'exaélitude de ces mouvemens
&
de leurs indica–
tions ceífe quand on préfente trop long-tem
le
baton
de cire aux fils,
il
faut avoir foin de renouvelleti·
fréquemment la friétion.
Donnons maintenant la conftruélion du
cerf-volant
·
relativemenr a l'éleélricité. L'on aífemblera, comm;
onya dit
ci-d.eva ~r,deux
baguettes fortes
&
légeres,
qu on peut fatre d un rofeau refendu, longtJes de trois
ou quatre pieds , dont l'une fera,
íi
on veut, un peu
plus courte que l'atltre; on coudra la-deífus une roile
légere ou quelque étoffe de foie bien mince,
&
on
atrachera a l'extrémité
du
corps une bande de meme
matiere, longue d'environ dix pieds
&
qui fera
la
queue ; on élevera au-deífus dLt plan de la mach ine
un
fil
de fer pointu d'environ un pied de long; on le
fixera
a
l'extrémité de la baguette qui va aboutir
a
la
tete ; on le recourbe en-deífous de
c~tte
bagnette,
afin
de
le joindre a la ficelle qui fert
a
diriger la ma
chine'
&
qui s'attacbera
a
cette baguette comme on
l'a dit ci-deífus. On attache auíii la grande fic elle au
centre de la machine , ott les deux haguettes fe croi–
fent; alors on fait partir de celie-ci rrois pieds
e n~
deífous de l'endroit oit elle efi attachée , deux autres
bouts de ficelle qui vont abouti r aux deux b!'as
de la
bague rte tranfverfale, un pe u au-dela
clu
milieu . Un
tro1íieme bout plus
court
que
les
autres
pa~;t
du
















