
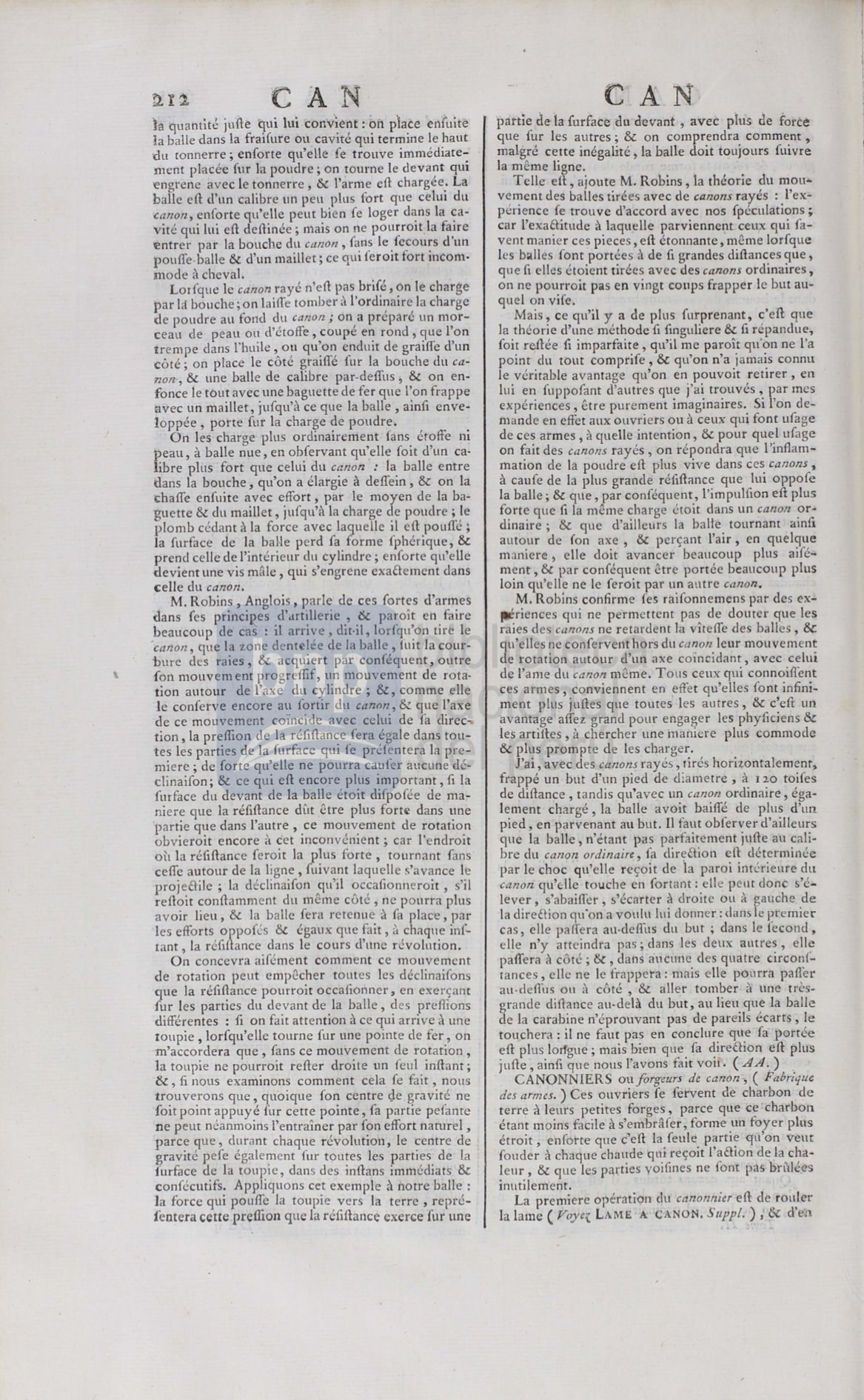
CAN
la
quantité jufie qui
lui
convient : on place enfuite
la
halle -dans la fraifure on cavité qui termine le haut
·du
tonnerre; enforte qu'elle fe trouve immédiate–
ment placée fur la poudre; on tourne le devant qui
'engrene avec le tonnerre,
&
l'arme efr chargée.
La
balle efr d'un calibre
un
peu plus fort que celui du
canon,
enforte qu'elle peut bien fe loger
d~ns
la
~a
viré qui
lui
efr deílinée; mais on ne pourrmt la fa1re
~ntrer
par la bouche du
canon,
fans
le
fecours d 'un
pouífe-balle
&
d'un maillet; ce qui feroit fort incom·
mode
a
chevaL
Lorfque le
canon_rayé
n'efi
pas,bri~é,
?n le charge
par lá bouche; on laiífe tomber a
1
ordmaue la charge
de poudre au fond du
canon;
on a préparé un mor–
ceau de peau on d'étoffe, coupé en rond; que l'on
trempe dans l'huile
',.o~ qu:o~
enduit de graiífe d'un
coté; on place le cote gratífe fur la bouche du
ca–
non-,
&
une halle de calibre par-deífus ,
&
on en–
fonce le tout avec une baguette de fer que l'on frappe
avet: un maillet, jufqu'a ce que la halle, ainíi enve–
loppée, porte fur la charge de poudre.
On les charge plus ordinairernent fans étoffe
ni
peau'
a
halle nue' en obfervant qu'elle foit d'un ca–
libre plus fort que celui du
canon :
la halle entre
dans la bouche, qu'on a élargie
a
deífein'
&
on la
chaífe enfuite avec effort, par le moyen de la ha–
guette
&
du maillet, jufqu'a la charge de poudre ; le
plomb cédant
a
la force avec laquelle
il
efr pouífé ;
la furface de la baHe perd fa forme fphérique,
&
prend celle de l'intérieur du cylindre; enforte qu'elle
devient une vis
m~Ue,
qui s'engrene exaétement dans
celle du
canon.
M.
Robins, Anglois, parle de ces fortes d'armes
dans fes
princi~es
d'artillerie ,
&
paroit en faire
beaucoup de cas : il arrive, dit-il, lorfqu'on tire le
canon,
t¡ue la zone dentelée de la halle , fuit la cour–
'bure des raies ,
&
acquiert par conféquent, outre
fon mouvem ent progreffif, un mouvement de rota·
tion
au
tour de l'axe du cylindre ;
& ,
comme elle
le conferve encore a
u
fortir du
cannn,
&
que l'axe
de ce mouvement coincide avec celui de fa direc–
tion, la preffion de la réfifrance fera égale dans tou–
tes les parties de la furface qui fe préíentera la pre–
miere; de forte qu'elle ne pourra caufer aucune dé–
clinaifon;
&
ce qui efr eneo re plus important, íi la
furface du devant de la halle étoit difpofée de ma–
niere que la réfifrance dftt etre plus
fort~
dans une
partie que dans l'autre , ce mouvement de rotation
obvieroit encore
a
cet inconvénient; car l'endroit
oit
la réfifrance feroit la plus forte , tournant fans
ceífe autour de la ligne, fuivant laquelle s'avance le
projeétile ; la déclinaifon qu'il occafionneroit, s'il
refroit conframment du meme coté ' ne pourra plus
avoir lieu'
&
la halle {era retehue
a
fa place' par
les efforts oppofés
&
égaux que fait'
a
chaque inf–
tant, la réíiíl:ance dans le cours d'une révolution.
On concevra aifément comment ce mouvement
de rotation peut empecher toutes les déclinaifons
que la réfiílance pourroit occafionner, en
exer~ant
fur les parties du devant de la halle, des preffions
différentes :
ft
on fait attention
a
ce qui arrive
a
une
toupie, lorfqu'elle tourne fur une pointe de fer, on
m'accordera que, fans ce mouvement de rotation ,
la toupie ne pourroit refrer droite un feul inftant;
& ,
fi
nous examinons comment cela fe fait , nous
trouverons que, quoique fon centre de gravité ne
foit point appuyé fur cette pointe, fa partie pefante
ne
peut
néanmoins l'entrainer par fon effort naturel
~
paree que, durant chaque révolution, le centre de
gravité pefe également fur toutes les parties de la
furface de la toupie, dans des infrans immédiats
&
confécutifs. Appliquons cet exempÍe a notre halle :
la
force qui pouífe
la
toupie vers la terre , repré–
fentera cette preffion que
1~
réíifrance exerce fur une
CAN
partie de ia furface du d-evant , avec plus de force
que fur les autres ;
&
on comprendra comment ,
malgré cette inégalité, la halle doit toujours fuivre
la meme ligne.
Telle eft, ajoute
M.
Robins, la théorie du mou•
vernent des halles tirées avec de
canons
rayés : l'ex–
périence fe trouve d'accord avec nos fpét:u!ations;
car l'exaétitude
a
laquelle parviennet;J.t ceu,x qui fa–
vent manier ces pieces, eft étonnante, meme lorfque
les halles font portées
a
de fi grandes difrances que;
que fi elles étoient tirées avec des
canons
ordinaires,
on ne pourroit pas
en
vingt coups frapper le but au–
quel on vife.
Mais, ce qu'il
y
a de plus furprenant, c'ell que
la théorie d'une méthode íi finguliere
&
íi répandue,
foit refrée íi imparfaite, qu'il me paroit qu'on ne l'a
point du tout comprife,
&
qu'on n'a jamais connu
le véritable avantage qu'on en pouvoit retírer, en
lui en fuppofant d'autres q·ue j'ai trouvés, par mes
expériences, étre purement imaginaires. Si l'on de–
mande en effet aux ouvriers ou
a
ceux qui font ufage
de ces armes'
a
quelle intention'
&
pour quel ufage
on fait des
canons
rayés, on répondra que l'inflam–
ma tion de la poudre efr plus vive daos ces
canons
,
a caufe de la plus grande réfifrance que lui oppofe
la halle;
&
que, par conféquent, l'impulíion efr plus
forte que íi la meme charge étoit dans un
canon
or..
dinaire ;
&
que d'ailleurs la baile tournant ainfi
autour de fon axe ,
&
per~ant
l'air, en quelque
maniere ; elle doit avancer beaucoup plus aifé–
ment'
&
par conféquent etre portée heaucoup plus
loin qu'elle ne le feroit par un autre
canon.
M.
Robins confirme fes raifonnemens par des ex-
' riences qui ne permettent pas de do
u
ter que les
raies des
canons
ne retardent la vireífe des halles ,
&
qu'elles ne conferventhor.s du
canon
leur mouvement
de rotation autour d'un axe co1ncidant, avec celui
de l'ame du
canon
meme. Tous ceux qui connoiíTent
ces armes, conviennent en effet qu'elles font infini–
ment plus juíl:es que toutes les autres,
&
c'efi un
avantage aífez grand pour engager les phyficiens
&
Jes artifres ,
a
chercher une maniere plus commode
&
plus prompte de les charger.
J'ai, avec des
canons
rayés, rirés horizontalernent,.
frappé un but d'un pied de diametre '
a
1 20
toifes
de dillance , tandis qu'avec un
canon
ordinaire, éga·
lement chargé, la halle avoit baiífé de plus d'un
pied, en parvenant au hut. Il faut obferver d'ailleurs
que la halle, n'étant pas
parf.~itement
jufie au cali–
bre du
cano11: ordinaire,
fa direaion efr déterminée
par le choc qu'elle
re~oit
de ia paroi intérienre dtt
canon
qu'elle touche en fortant: elle peut done s'é–
lever, s'ahaiífer, s'écarter
a
droite
Oll
a
gauche de
la direétion qu'on a voulu
lui
donner: dans le premier
cas, elle paífera au-deffus du but ; dans le fe(ond
:p
elle n'y atteindra pas; dans les deux autres, elle
paífera
a
coté;
&
'dans aucune des quatre circonf–
tances, elle ne le frappeta: mais elle ponrra paífer
au-deífus
Oll
a
coté ,
&
aller tomber
a
une tres–
grande difrance
au~dela
du but, au lieu que la halle
de la carahine n'éprouvant pas de pareils écarts, le
touchera:
il
ne faut pas en conclute que fa p<:>ttée
efr plus lorfgue ; mais bien que fa direéHon
eft
plus
jufre,ainfi que nousl'avons fairvoit.
(AA.)
CANONNIERS
ouforgeurs de canon, (Fabrique
des armes.
)
Ces ouvriers fe fervent de charhon de
terre
a
leurs petites forges' paree que ce charbon
étant moins facile
a
s'embrafer' forme un foyer plus
étroit, enfone que c'ell la.feule.
p~rti~
qu'on veut
fouder
a
chaque chancle
qm
re~Oit
1
aétton de lacha–
leur,
&
que les
p~rties
yoifines ne font pas hrulé_es
inutilement.
La premiere opération dtt
canonnier
efr de rouler
la
lame (
Voyez
LAME A
CANON,
Suppl.
) ,
&
d'en.
















