
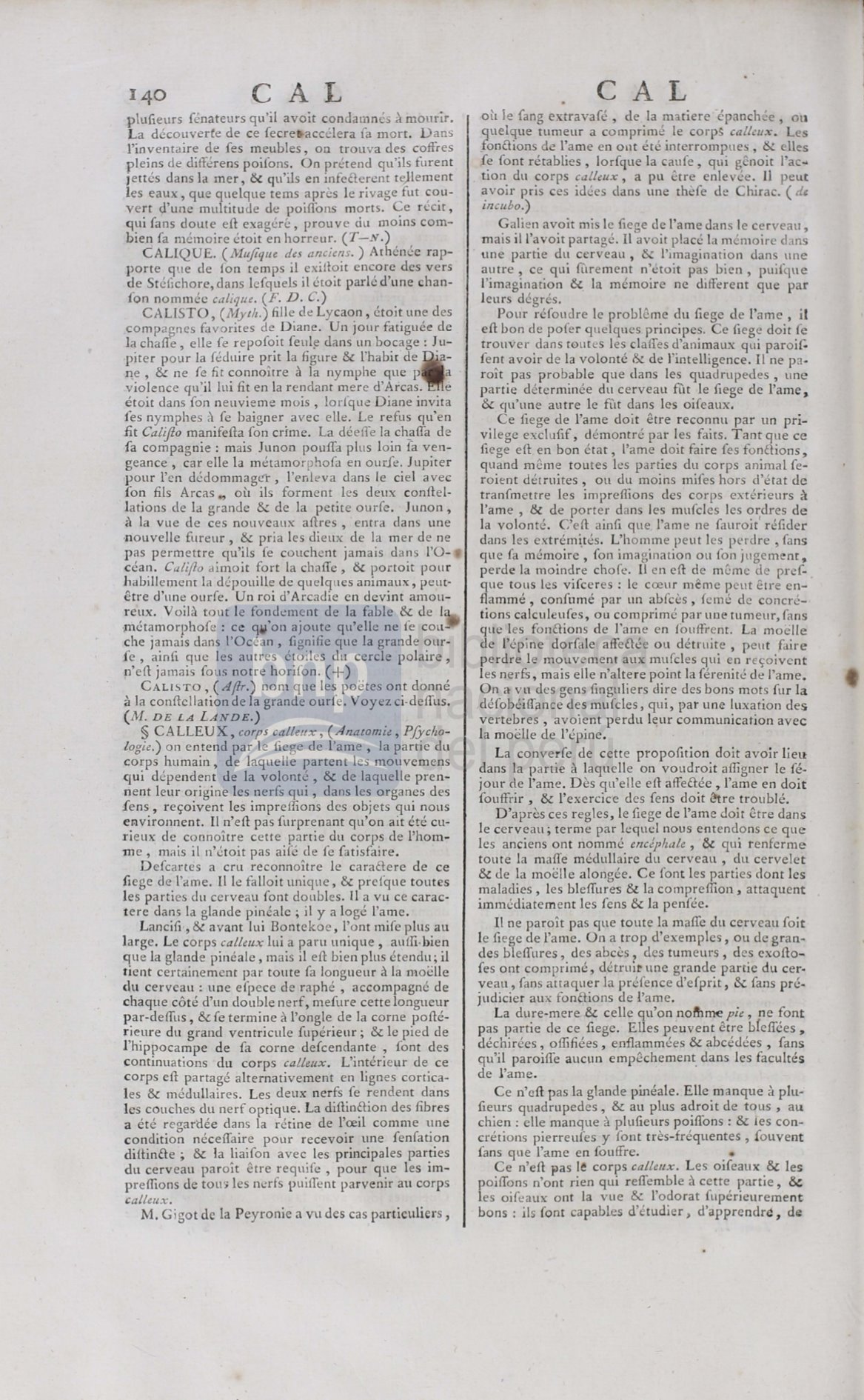
CAL
pluíieurs
{;'
nateurs qu'il avoit con amn
's
a
mourir.
La d
1
cou erte de ce fecret acc 'lera
a
mort. Dans
l'inventaire de fes meubles, on trouva des coffres
pleins de dift 'rens poifons. On prétend qu'ils furen t
jettés dans la mer,
&
qu'ils en infeaer nt
t~lement
les eaux, que quelque tems apr' s le rivage fut
;~u
ven d'une multitude de poiífons morts. . e recit ,
GUÍ
fa ns doute eíl: exagéré, prouve
du
moms coro–
bien fa mémoire étoit en horreur.
(T
-N.)
CALIQUE. (
Mujique des anciens.)
Athén
1
e rap–
porte que de fon temps il exiiloit encore des vers
de Stéfichore, dans lefquels il étoit parlé d'une chan–
fon nommée
calique. (F. D. C.)
CA
LISTO,
(Myt!t.)
fill<:
de Lycao_n,
étoi~
un; des
comparrnes favorites de Dtane. Un JOUr fauguee de
la
chaíf~,
elle fe repofoit
fe u l~
dans un bocage:
J
u–
píter pour la féduire prit la figure
&
l'habir de
Dia-
ne'
&
ne fe
nt
connoirre
a
la nymphe que p
a
violence qu'il lui fit en la rendant mere d'Arcas.
e
étoit dans fon neuv1eme mois , lorique Diane invita
fes nymphes
a
fe baigner avec elle. Le refus qu'en
fit
Calijío
manifefta fon crime. La déeífe la ch_aífa de
fa compagnie: mais Junon pouífa plus loin fa ve -
geance, car elle la métamo rphofa en ourfe. Jupiter
pour l'en dédommage't , l'enleva dans
le
ciel avec
fon fils Arcas , oti ils forment les deux confiel–
lations de la grande
&
de la perit e ourfe.
J
unon,
a
la vue de ces nou veaux afires , entra dans une
·nouvelle fureur,
&
pria les dieux de la mer de ne
pas permettre qu'ils fe couchent jamais dans
1'0-
céan.
Califlo
a.imoit fort la chaífe,
&
portoit pour
habillement la dépouille de qu elques animaux, peut–
etre d'une ourfe. Un roi d'Arcadie en devint amou–
reux. Voila tout le fondt!ment de la fable
&
de la
-;métamorphofe : ce q 'on ajoute qu'elle ne fe con–
che jamais dans l'Océan, fi gnifie que la grande our–
fe , ainíi que les autres étoiles
dn
cercle pelaire,
n'eíl jamai fo us notre horifon.
e+)
CALI
TO, (
Aflr.)
nom que les poetes ont donné
a
la conficllation de la grande ourfe. Voycz ci-deífus.
(M.
DE LA LANDE.)
§
CALLEUX,
corps calleux ,
(A
nato
mi~,
PJYcho–
logi~. )
on entend par le fiege de l'ame ,
la
partie du
corps humain, de laquelle partent les mouvemens
qui d 'pendent de la volonté ,
&
de laquelle pren–
nent leur origine les nerfs qui, daos les arganes des
fens,
re~oivent
les impreffions des objets qui nous
etivironnent.
11
n'eíl: pas furprenant qu'on ait été cu–
rieux de conno!tre cette partie du corps de l'hom–
me, mais
il
n'étoit pas aifé de fe fatisfaire.
Defcartes a cru reconnoitre le caraél:ere de ce
fiege de l'ame.
Ille
falloit unique,
&
prefque
tomes
les parties du cerveau font doubles.
Il
a vu ce carac–
tere dans la glande pinéale ; il
y
a logé l'ame.
Lanciíi,
&
avant
lui
Bontekoe , l'ont mife plus
a u
large. Le corps
calleux
luí a paru nnique, auffi.bien
que la glande pinéale, mais il efi bien plus étendu;
il
tient certainement par tonte fa longueur a la moelle
du cerveau : une efpece de raphé , accompagné de
chaque coté d'un double nerf, mefure cette longueur
par-deífus'
&
fe termine
a
l'ongle de la corne pofié–
rieure du grand ventricule fupérieur;
&
le pied de
I'hippocampe de fa corne defcendante , font des
continuations du corps
calleux.
L'intérieur de ce
corps efr partagé alternativement en lignes cortica–
les
&
médullaires. Les deux nerfs fe rendent dans
les couches du nerf optique. La difiin0:ion desfibres
a été reaartlée dans la rétine de l're1l comme une
conditio~
néceífaire pour recevoir une fenfation
diínnél:e
;
&
la lia1fon avec les principales parties
du cerveau paroit etre requife ' pour que les im–
preffions de tou les n rfs puiífent parvenir a'ti corps
cal!eztx.
M. G"go t de la Peyronie a vudes cas partieuliers,
CAL
oh le fang e ·tra ·afé de la maciere 'pan h-.e,
t
quelque tumeur a comprim
1
1
corp
call.:ux.
Les
fonélions de l'ame en 01lt
ét
interrompue · , • lles
fe font rérablies , lorfque la a
u
fe qui
g
~no
ir la ..
tion du corps
callmx ,
a pu "tre enle 'e.
11
peut
avoi1· pris ces id ' es dans une thefe de hirac. (
ie
incubo.)
Galien avoit mi le fiege de
1
ame dans le cerveau,
mais ill'a oit partag ' .
Il
a oit plac ' la
m
1
moire
d.msune partie du cer eau ,
&
1'1magination dan une
autre , ce qui furement n'etoit pas bien , puifque
l'imagination
&
la mémoire ne different que par
leur dégr
1
s.
Pour r
1
foudre le probleme du fiege de l'ame ,
il
efi bon de pofer quelques príncipe . Ce íiege doit fe
trouver daos tout
s
les claifes d'animaux qui paroif.
fent avoir de la volonté
&
de
1
intelligence.
Il
ne pa·
roit pas probable que dans les quadrupedes , une
par
ti
e
déterminée
du
cerveau ñtr le fiege de l'ame
~
&
c¡u'une atttre le fut dans les oifeaux .
Ce fiege de
1
ame do it erre reconnu par un pri–
vilege excl fif, démontr
1
par les faits. Tant que ce
íiege eft en bon état, l'ame doit faire fes fonél:ions,
quand meme toutes les parties du corps animal fe–
roient dél ruites, ou du moins mifes hors
d~état
de
tranfmettre les impreilions des corps extérieurs
a
!'ame ,
&
de porter dans les mufcl es les ordres de
la volonté. C'eft ainíi que
l~ame
ne fauroit réfider
dans les
extré.m~tés.
L'homme peut les
perdre ,
fans
que fa mémoire, fon imagination o
u
fon jugemenr,
perde la moindre chofe.
11
en eft de mcme de pref–
que tous les vifceres : le creu r
meme
peut e tre en–
flammé, confumé par un abfces,
{em '
de concré–
tions calculeufes, o
u
comprimé par une rumeur, fans
que les fonél:ions de !'ame en ío uffrent. La moelle
de l'épine dorfale affeélée ou détruite , peut faire
perdre le mouvemenr aux mnfcles qui en res:oivent
les nerfs, mais elle n'altere point la férenité de l'ame.
On a vn des gens únguliers dire des bons mots fur
la
défobéiífan ce des mufcles, qui, par une luxation des
vertebres , avoient perdu leur communication avec
la moelle de l'épine.
La conve rfe de cette propoútion doit avoir
lieU:
dans la partie
a
laquelle on voudroit ailigner le fé–
jour de !'ame. Des qn'elle eft affetl:ée, l'ame en doit
fouffrir _,
&
l'exercice des fens doit
~tre
troublé.
D'apres ces regles, le fiege de l'ame doit etre dans
le cerveau; terme par lequel nous entendons ce que
les anciens ont nornmé
enc¿phale
,
&
qui renferme
toute la maífe médullaire du cerveau ,
du.
cervelet
&
de la moelle alongée. Ce font les parties dont les
maladles, les bleífure:s
&
la compreffion _, attaquent
immédiatement les fens
&
la penfée.
n
ne paroit pas que toute la maífe du cerveau foit
le fi ege de l'ame. On a trop d'exemples, ou de gran–
des bleífures, des abces, des tumeurs, des cxoíl:o–
fes ont comprimé, détruit une grande partie du cer–
veau, fans attaquer
la
préfence d'efprit,
&
fans pré–
judicier aux fonélions de l'ame.
La dure-mere
&
celle qu'on nolhme
pie,
ne font
pas partie de ce fiege. Elles peuvent erre bfeffées,
déchirées , offifiées _, enflammées
&
abcéd
1
es , fans
qu'il paroiífe aucun empechement. daos les facultés
de l'ame.
Ce n'eft pas la glande pinéale. Elle manque
a
plu–
fieurs quadrupedes ,
&
au plus adroit de tous _,
au
chien: elle manque
a
p luúeurs poiifons:
&
les
con–
crétions pierreufes y font tres-fr
1
quentes , fouvent
fans que l'ame en fou ffre.
•
Ce n'efi pas le corps
callettx.
Les oifeaux
&
les
poiífons n'ont rien qui reífemble a cette partie'
&
les oifeaux ont la vue
&
l'odorat fupérieurement
bons : ils font capables d'érudi r, d'apprendré, de
















