
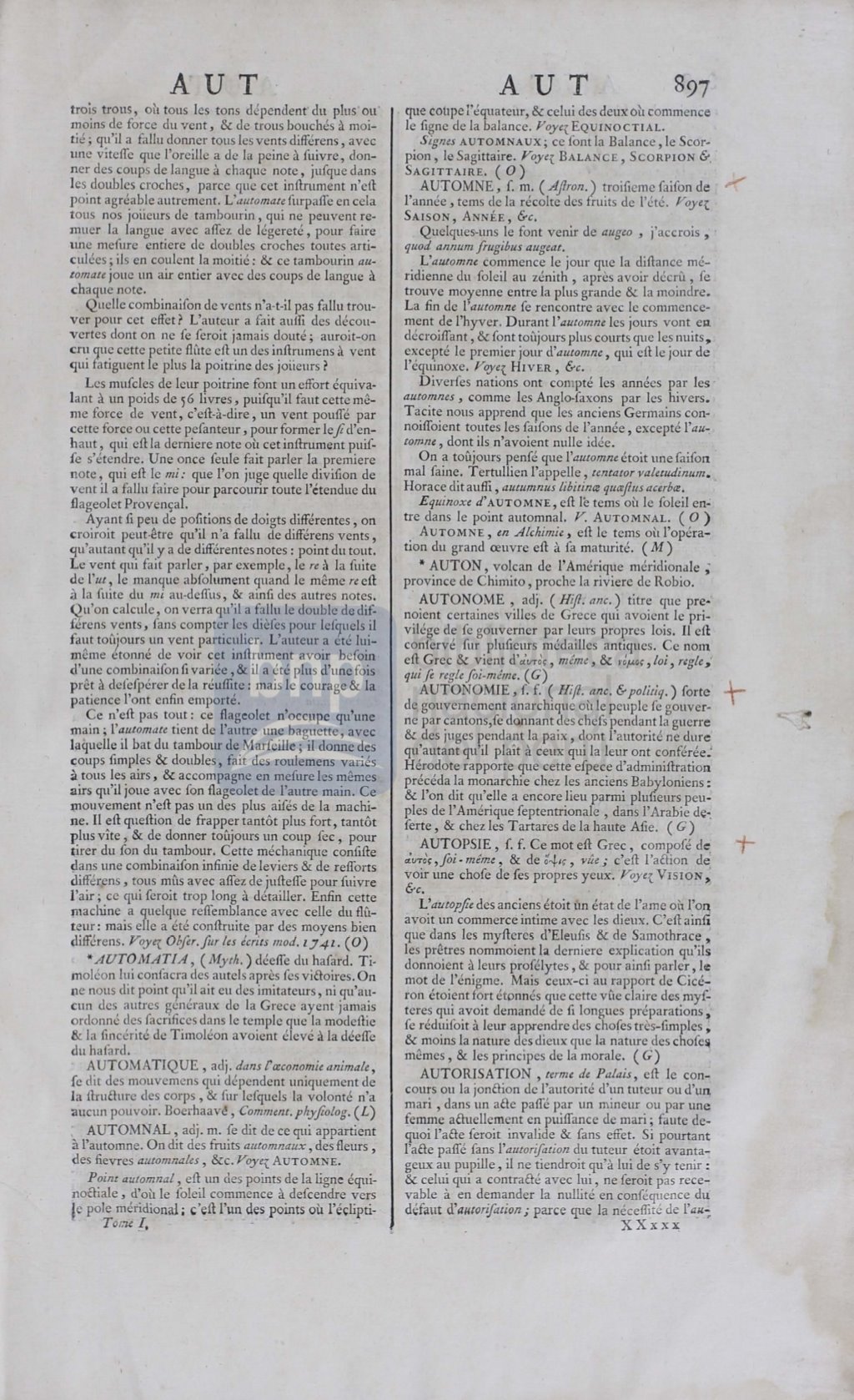
AUT
troís trous,
0~1
tous les tons dépendenr du plus on
moins de force du vent,
&
de trous bouchés
a
moi–
tié;
qu'il a faIlu donner tous les vents différens , avec
une víteífe que l'oreille a de la peine
a
fuivre, don–
ner des coups de langue a chaque note, jufque dans
les doubles croches, parce que cet infuument n'eft
point agréable autrement.
L'automate
furpaífe en cela
tous nos joiieurs de tambolll'in, qui ne peuvene re–
muer la langue avec aífe1. de légereté, pour faire
lUle mefure enciere de doubles croches tontes ani–
culées; ils en coulent la moitié:
&
ce tambourin
au–
tomate
joue un air entier avec des coups de langue
a
chaque note.
Quelle combinaifon de vents n'a-t-il pas faIlu trou–
ver pour cet effet? L'auteur a fait auffi des décou–
vertes dont on ne fe feroit jamais douré; auroit-on
cm que cette petite flllte eft un des inftmmens
a
vent
'lui fatiguent le plus la poitrine des joiieurs
?
Les mufcIes de Icur poitrine fone un effort équiva–
lant
a
un poids de 56 livres, puifqu'il faut cette
m~me force de vent, c'eft-a-dire, un vent pouífé par
cette force ou cette pefanteur, pour former lejid'en–
haut, qui eft la derniere note oh cet infuument puif–
fe s'étendre. Une once feule fait parler la premiere
note, qui eft le
mi,'
que I'on ju&e quelle divifion de
vent il a fallu faire pour parcounr toute l'étendue du
flageolet Provens:al.
Ayant fi peu de pofitions de doigts díiférentes , on
croiroit peut·etre qu'il n'a fallu de différens vents,
qu'autant qu'il y a de différentes notes: pointdu tout.
Le vent qui fait parler, par exemple, le
re
a
la fuite
de
l'ut,
le manque abfolument quand le meme
re
eft
ala fuite du
mi
au-deífus,
&
ainft des autres notes.
Qu'on calcule, on yerra qu'il a faIlu le double de dif–
férens vents, fans compter les diefes pour
lef~uels
il
faut touiours un vent particulier. L'auteur a eté lui–
meme cÚonné de voir cet infuument avoir befoin
o'une combinaifon fi variée
,&
il a été plus d'une fois
pret
a
defefpérer de la
réuffi.te: mais le courage
&
la
patience l'ont enfin emporté.
Ce n'eft pas tout: ce flageolet n'occppe qu'une
main;
l'automate
tient de l'autre une baguette, avec
laquelle il bat du tambour de Marfeille ; il donne des
coups fimples
&
doubles, fait des roulemens variés
a
touS les airs,
&
accompagne en me(ure les memes
airs qu'il joue avec fon flageolet de l'autre main. Ce
mouvement n'eft pas un des plus aifés de la machi–
neo
Il
eft queftion de frapper tantot plus fort, tantot
plus vIte,
&
de donner tOlljours un coup fec, pour
(irer du fon du tambour. Cette méchanique confifte
dans une combinaifon infinie de leviers
&
de refiorts
différens, tous
mtls
avec aífe1. de jufteífe pour fuivre
l'air; ce qui feroit trop long
a
détailler. Enfin cette
machine a quelque reH'emblance avec celle du
fltl–
teur: mais elle a été conftmite par des moyens bien
différens.
Voye¡: Obfir.jitr les tcrits modo
lJ4l.
(O)
*
AUTOMATIA, (Myth.)
déelfe du hafard. Ti–
moléon lui confacra des autels apres fes viétoires. On
ne nous dit point qu'il ait eu des imitateurs, ni qu'au–
eun des autres généraux de la Grece ayent jamais
ordonné des (acrifices dans le temple que la modefiie
&
[a
úncérité de Timoléon avoient élevé
a
la déeífe
du hafard.
AUTOMATIQUE, adj.
dans l'wconomíe anímate,
fe dit des mouvemens qui dépendent uniquement de
la
fuuétllTe des corps ,
&
fllT lefquels la volonré n'a
aucun pouvoir. Boerhaavé,
Comment. phyjiolog.
(L)
AUTOMNAL, adj. m. fe dit de ce qui appartient
a
I'automne. On dit des fmies
automnaux,
des fleurs ,
des fievres
automnal~s
,
&c.
Voye{
AUTOMNE.
Poim aUlomnal
,
eft un des points de la ligne éqlli–
noiliale , d'otl le foleil commence
a
defcendre vers
le
pole méridional; , 'eft l'un des points oh l'éclipti–
Tome
l.
AUT
que cotlpe I'équateür,
&
celui des deuxoh commence
le figne de la balance.
Voye{
EQUINOCTIAL.
Signes
AUTOMNAUX; ce fontla Balance, le Scor–
píon,
leSagittaire.
Voye{
BALANCE, SCORPION
&.
SAGITTAIRE.
(O)
AUTOMNE, f. m.
(Aftron.)
troifieme faiCon de
l'année, tems de la récolte des truits de I'été.
Yoye{
SAISON, ANNÉE,
&c.
Quelques-uns le font venir de
augeo
,
j'accrois,
quod annum frugíbus augeat.
L'automne
commence le
JOUT
que la diftance mé–
ridienne du foleil au l.énith , apres avoir décru , fe
trouve moyenne entre la plus grande
&
la moindre.
La fin de
l'automne
fe rencontl'e avec le commence–
ment de I'hyver. Durant l'
automne
les jours vone elJ.
décroiífant,
&
font toujours plus courts que les
nuits~
excepté le premier jom d'
altlomne
,
qui eft le jour de
l'équinoxe.
Vqye{
HIVER,
&c.
Diverfes nacions ont compté les années par les
automnes
,
comme les Anglo-faxons par les hivers.
Tacite nous apprend que les anciens Germains con–
noiífoient toutes les (aifons de I'année, excepté
l'au–
tomne,
dont ils n'avoient nulle idée.
On a toujours penfé que l'
alllomne
étoit une faifon
mal faine. Tertullien l'appelle ,
tentator valetudinum.
Horace ditauffi,
aUlUmnus libitina qUlJlftus acerbOl.
Equinoxe
d'AUTOMNE, eft le tems otIle foleil en–
tre dans le point automnal.
V.
AUTOMNAL.
(O)
AUTOMNE,
en
Aichimie,
eft le tems oill'opéra–
tion du grand reuvre efi
¡'¡
fa maturité.
(M)
*
AUTON, volean de l'Amérique méridionale ;
province de Chimito, proche la riviere de Robio.
AUTONOME , adj.
(HijI.
anc.)
titre (j1le pre–
noient certaines villes de Grece (Iui avoient le pri–
vilége de fe gouverner par lems propres lois.
11 dI:
con1ervé fur plufieurs médailles antiques. Ce nom
eft Grec
&
vient
d'dvrd~ ,
méme,
&
.~p..~,
loi, regle,.
qui
ji
regle foi-mbne.
(G)
AUTONOMIE, f. f.
(1Iifl. anc.
&
polittq.)
forte
de gouvemement anarchique oh le peuple fe gouver–
ne par cantons,fe donnant des chefs pendant la guerl'e
&
des juges pendant la paix , dont l'autorité ne dure
qu'autant qu'il plait
a
cellX qui la leur ont conférée:
Hérodote rapporte que cette efpece d'adminiftration
précéda la monarchie che1. les anciens Babyloniens :
&
1'0n dit (Iu'elle a encore lien parmi plufieurs peu–
pies de l'Amérique feptentrionale , dans l'Arabie
de~
ferte,
&
che1.1es Tartares de la haute Afie.
(G)
,
~UT?PS~E,
f. f. Ce. mot eft,
Gre~, c?m~o(é
de.
a.U70~
,Jot
-
meme,
&
de
O{I~,
vue;
c eft l aéhon de
voir une chofe de fes propres yeux.
Voye{
VISION,
&c.
L'autopjie
des anciens étoit un état de l'ame 0111'on
avoit un commerce intime avec les dieux. C'eft ainfi
que dans les myfieres d'Eleufis
&
de Samothrace
~
les pretres nommoient la derniere explication qu'ils
donnoient
a
leurs profélyres ,
&
pour ainfi parler , le
mot de l'énigme. Mais ceux-ci au rapport de Cicé–
ron étoiene fort étonnés que cette vtle c1aire des myf–
teres qui avoit demandé de fi longues préparations
~
fe réduifoit a leur apP"endre des chofes tres-íimples •
&
moins la nature des dieux que la nature des
choCe~
memes,
&
les príncipes de la morale.
(G)
AUTORISATION
,terme de Palais,
eft le con–
cours ou la jonélion de l'autorité d'tm tuteur ou d'un
mari , dans un aéte paífé par un mineur ou par une
femme aétllellement en plliífance de man ; faute de–
quoi I'aéte feroit invalide
&
fans effet. Si pourtant
I'aéte paífé (ans l'
aUlorifation
du tuteur étoit avanta–
geux au pupille, il ne tiendroit qu'a lui de s'y tenir :
&
celui qui a contraété avec luí, ne (eroit pas rece–
vable a en demander la nullité en conféqllence dtl
défaut d'
alltOrifatiolZ;
paree que la néceffité de l'
au-;.
XXxxx
















