
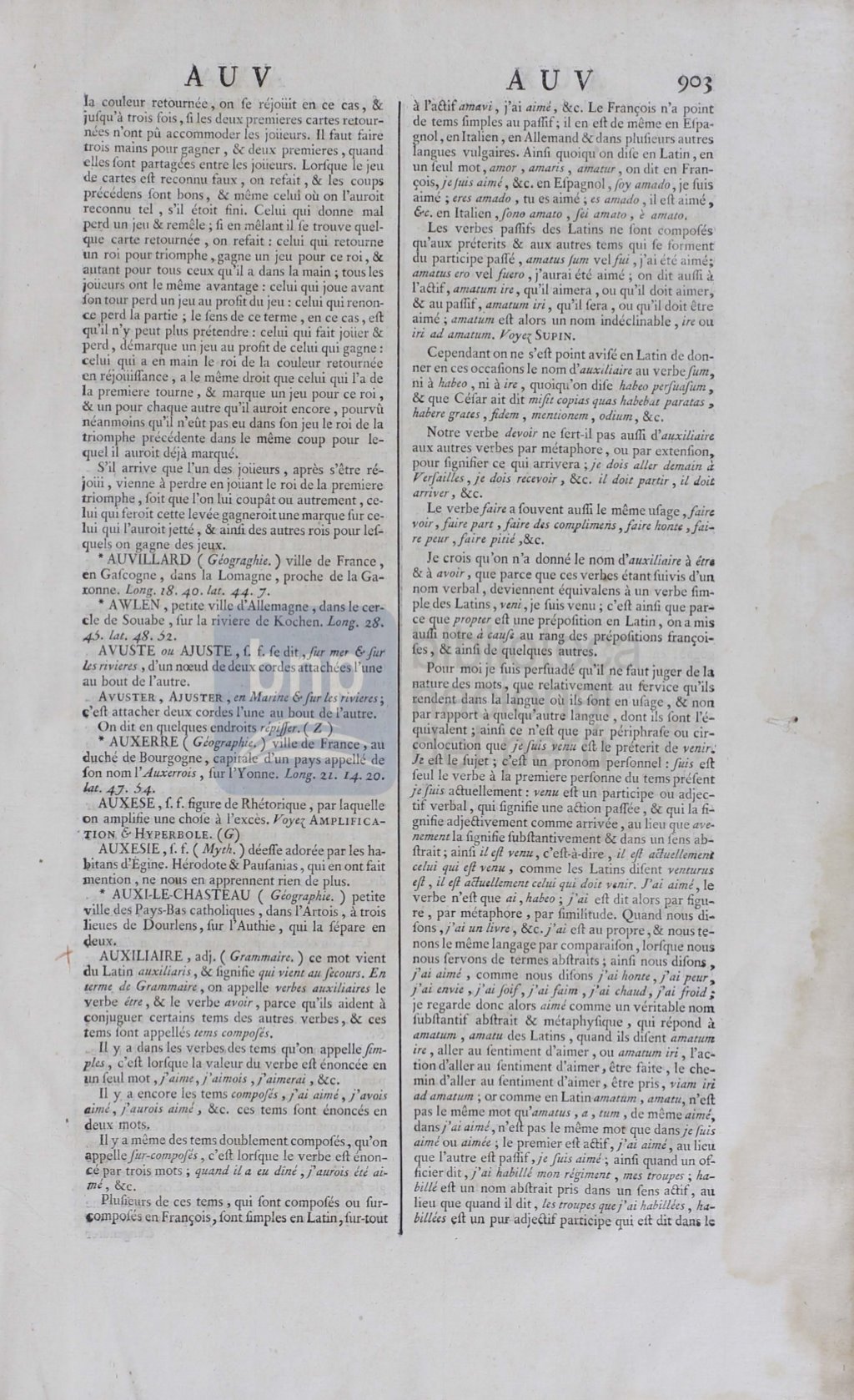
AUV
la
couleur retournée, on fe réjoiiit en ce cas,
&:
jufqll'a trois fois, íi les deux premieres cartes reJour–
nées n'ont pll accommoder les joiieurs.
Il
faut faire
trois mains pour gagner , & deux premieres , quand
e lles font partagées entre les joiieurs. Lorfqlle le jen
de
cartes ell: reconnu faux , on refait , & les COllpS
précédens {ont bons, & meme celui Ol! on l'amoit
reconnu tel , s'il étoit fini. Celui qui donne mal
perd un jeu & remele ; fi en melant ji (e trouve quel–
-que carte retournée , on refajt : celui qui retourne
un roi pour triomphe ,
ga~ne
un jcu pour ce roi, &
-autant pour tous ceux qu jI a dans la main ; tous les
joiieurs ont le meme avantage : celui qui joue avant
.{Qn tour perd un jeu au profit du jeu : celui qui renon–
ce
perd la parcie ; le (ens de ce terme , en ce cas, ell:
qu'il n'y peut plus prétendre : celui qui fajt joiier &
perd, démarque un jeu au protit de celui 'lui gagne :
celui qui a en main le roi de la coulcur retournée
en
réjoiiiífance , a le meme droit que celui 'lui I'a de
la premiere toume, & marque un jeu pour ce roi ,
&
un pour chaque autre qu'il auroit encore , pOurVll
néanmoins qu'il n'eut pas eu dans (on jeule roi de la
triomphe précédente dans le meme coup pour le–
quel il auroit déja marqué.
S'il arrive que l'un de.s joiieurs , apres s'etre ré–
joiii, vienne a perdre en joiiant le roi de la premiere
triomphe, {oit que l'on
lui
coupat ou autrement , ce–
lui qui feroít cette levée gagneroitune marque
(ur
ce–
lui qui l'auroit jetté, & ainfl des autres rois pour le(–
quels on gagne des jeux.
.. AUVILLARD (
Géograghie.
) ville de France,
en Ga(cogne , d<:ns la Lomagne, proche de la Ga–
:ronne.
Long.
/8.
40. lat. 44.:J.
*
AWLEN ,peme ville cl'Allemagne, dans le cer–
d e de Souabe ,{ue la riviere de Kochen.
Long.
28.
45·
úU.
48..52.
AVUSTE
oa
AJUSTE,
f.
f. {e dit
,fUr
mer
&
fur
"S
rivieres
,d'un nreud de deux cordes attachées l'une
au bout de l'autre.
AVUSTER, ArusTRR,
en Marine
&
fur les rivieres; .
c;'eíl attacher deux cordes l'une au bout de l'autre.
On dit en quelques endroits
répijJer.
(
Z )
.. AUXERRE (
Géographie. )
ville de France, au
duché de Bourgogne, capitale d'un pays appellé de
fon nom l'
Au.ierrois
, (ur I'Yonne.
Long.
2l.
[4-
20.
Jat.
4J. .54·
AUXESE, {.
f.
figure de RhétoriCflle , par laCfllelle
on amplifie une chofe
a
l'exces.
Voye{
AMPLlFICA–
','{ION
&
HVPERBOLE.
(G)
AUX~SLE,
f.
f. (
Myeh.
) déeífe adorée par les ha–
~itans
d'Egine. Hérodote & Paufanias, qui en ont fait
Jl1ention , ne nous en apprennent rien de plus.
*
AUXI·LE-CHASTEAU (
Géographie.
) petite
ville deS J,lays-Bas cathoüques , dans l'Artois ,
a
trois
lieues de Dourlens, (ur l'Authie, qui la fépare en
geux.
AUXILlAIRE, adj. (
Grammaire.
) ce mot vient
au Latín
auxiliaris ,
& íignifie
qlli viem ap fecollrs.
En
terme de Grammaire,
on appelle
verbes tlllxiliaires
le
verbe
ee" ,
& le verbe
avoir,
parce qu'ils aident
a
conjuguer certains tems des autres verbes, & ces
tems íont appellés
tems compofés.
U
ya dans les verbes des tems qu'on appellefim–
pies,
c'eíl lorrque la valeur du verbe eft énoncée en
un (eul mor
,j'aime,j'aimois ,j'aimerai,
&c.
Il
y
a encore les tems
compofés ,j'ai aimé, j 'avois
(limé,
j'
aurois aimé,
&c. ces tems font énoncés en
• dellx mots.
I!
y a meme des tems doublement compo(és ,
~u'on
appellejur-compofés,
c'ell: lor{que le verbe eft enon–
cé par trois mots ;
quand iLa eu d,né
,j'
aurois été ai.
mi,
&c.
, Plufieurs de ces tems , CfllÍ (ont compo(és ou [ur–
,ompofés en Frans:ois
~
fone fimples en Latín,{ur-tout
l'
AUV
~
l'aél:if
tlmavi,
j'ai
aimé,
&c. Le Frans;ois n'a point
de tems ftmples au pallif; il en eft de meme en Eípa–
gnol, enIralien ,en Allemand &dans pluíieurs autres
langues vulgaires. Ainft quoic¡u on dife en Latin, en
un {eul mot,
amor, amaris
,
amatur,
on dit en Fran–
s;ois,je¡/lis aimé,
&c. en Efpagnol,
(ay amado,
je {uis
aimé ;
eres amado,
tu es aimé ;
es amado,
il ell: aimé ,
&c.
en ltalien
,fono amato ,fei amaro,
e
a",aeo.
Les verbes pallifs des Latins ne font comporés
qu'aux prérerits & aux alltreS tems qui (e forment
du participe paífé ,
amatus fu", velfui
,j'ai été aimé;
amatus ero
vel
fuero,
j'aurai été aimé ; on dit aulli
a
l'aél:if,
amaeum ire,
Cfll'il aimera ,ou qu'il doit aimer,
& au pallif
,.amaeum iri,
qu'il (era, ou Cfll'il doit etre
aimé ;
alllaeum
eft alors un nom indéclinable,
ire
on
iri ad amat/l/ll. Voye{
SUPIN.
Cependant on ne s'eíl point avi(é en Latin de don–
ner en ces occaflOns le nom
d'auxdiaire
au
verbefllm,
ni a
habeo
, ni
aire,
Cflloiqu'on dife
habeo peifuafum ,
& que Cé{ar ait dit
mijie copias quas !tabebae paratas "
habere grates ,fidem , memionem , odium,
&c.
Notre verbe
devoir
ne {ert-iI pas auffi
d'attxiliai"
aux autres verbes par métaphore , ou par exteníion,
pour fignitier ce qui arrivera
;je dois all.r demain
ti
VeifailLes ,je dois recevoir,
&c.
il doit partir, il doit
arriver,
&c.
Le
verbefair.
a (ouvent aulli le meme u(age
,faire
voir ,faire part ,faire des complime¡is ,faire !tome, fai–
re peur ,¡aire pitié
,&c.
le
crois qu'on n'a donné le n6m
d'auxiliaire
a
eera
&
a
avoir,
que paree Cflle cesverbes étant {uivis d'un
I
nom verbal, deviennent équivalens
a
un verbe fim–
pIe
des
Latins,
veni,
je (uis venu ; c'eft ainíi que par–
ce que
propeer
eft une prépoíition en Latin, on
a
mis
auffi notre
ti
cauft
au rang des prépofitions frans:oi–
(es, & ainli de quelques alltres.
POlI! moi je fi¡js per(uadé CflI'il rte faut juger de
la
nature des mots , que relativement au (ervice Cfll'ils
tendent dans la laogue
Olt
ils (ont en ufage , & non
par rapport
a
quelqu'autre langue , dont ils (ont I'é–
qu.ivalent; ainfi ce n'ell: que par périphrafe ou cir–
conlocution que
jd fuis ventl
e{l; le préterit de
venir.'
le
eílle {ujet ; c'eft un pronom per{onnel :
jiús
eft
(eulle verbe
a
la premiere per(onne du
tems
pré(ent
jefuis
aél:uellement:
ventl
eft un participe ou adjec–
tíf verbal, CflIi íignitie une afrion paífée , & qui la ti–
gnitie adjeél:ivC!ment comme arrivée , au lieu que
ave–
nemem
la fignitie {ubll:antivement
&
dans un fens ab–
fuait; ainli
iL
ifl
venu,
c'eft-a-dire ,
il
ifl
aauellement
cebú qui
ifl
venll,
comme les Latins di(ent
venturtlS
ejl
,
iL efl aauellement cebti qui doie vmir. l'ai aimé,
le
verbe n'eft que
ai , habeo
;
j'ai
eft dit alors p'ar figu–
re , par métaphore , par {unilitude. Quand nous di·
{ons
,j'ai un tivre, &c.j'ai
ell: au propre ,& nous te–
nons le meme langage par compaFai(on, 10r{Cflle nous
nous fervons de termes abll:raits ; ainíi nOlls di(oI1j ,
j'ai aime
, comme nous difons
j'ai !tome ,j'ai peur,
j 'ai envie ,j'ai foif,j'ai faim ,j'ai challd,j'ai froid;
je regarde donc alors
aimJ
comme un véritable nom
(ubll:antif abftrait & métaphyfique, 'lui répond
a.
amatum
,
amalll
des Latins , quand ils difent
amatum
ire
, aller au (entiment d'aimer , ou
amatum iri ,
l'ac–
tion d'aller au {entiment d'aimer, etre f.,ite , le che–
min d'aller au (entiment d'aimer, etre pris,
viam iri
ad amaewn
;
O)"
comme en Latin
amatTlm
,
amam,
n'eft
pas
le.,m.&~e
:no; qu'
amaeas
'.
a, tum
, de meme
~im~,
dans
/
at
Qlme,
n eft pas le meme mot que dans;e
fuls
aimé
ou
aimée
; le premier ell: aél:if,
j'ai aimé,
auliell
que l'autre ell: pallif
,je jitis aimé
; ainíi quand un of–
flcier dit
,j'ai Itabillé mon régiment
,
mes eroupe,
;
Ita–
biLLé
ell: un nom abftrait pris dans un (ens aél:if, au
lieu que quand il dit,
les troupes quej'ai Itabillées
,
"a–
biLtées
eft un pU.F adjeél:if participe
qll~
efr
dit
dam le
















