
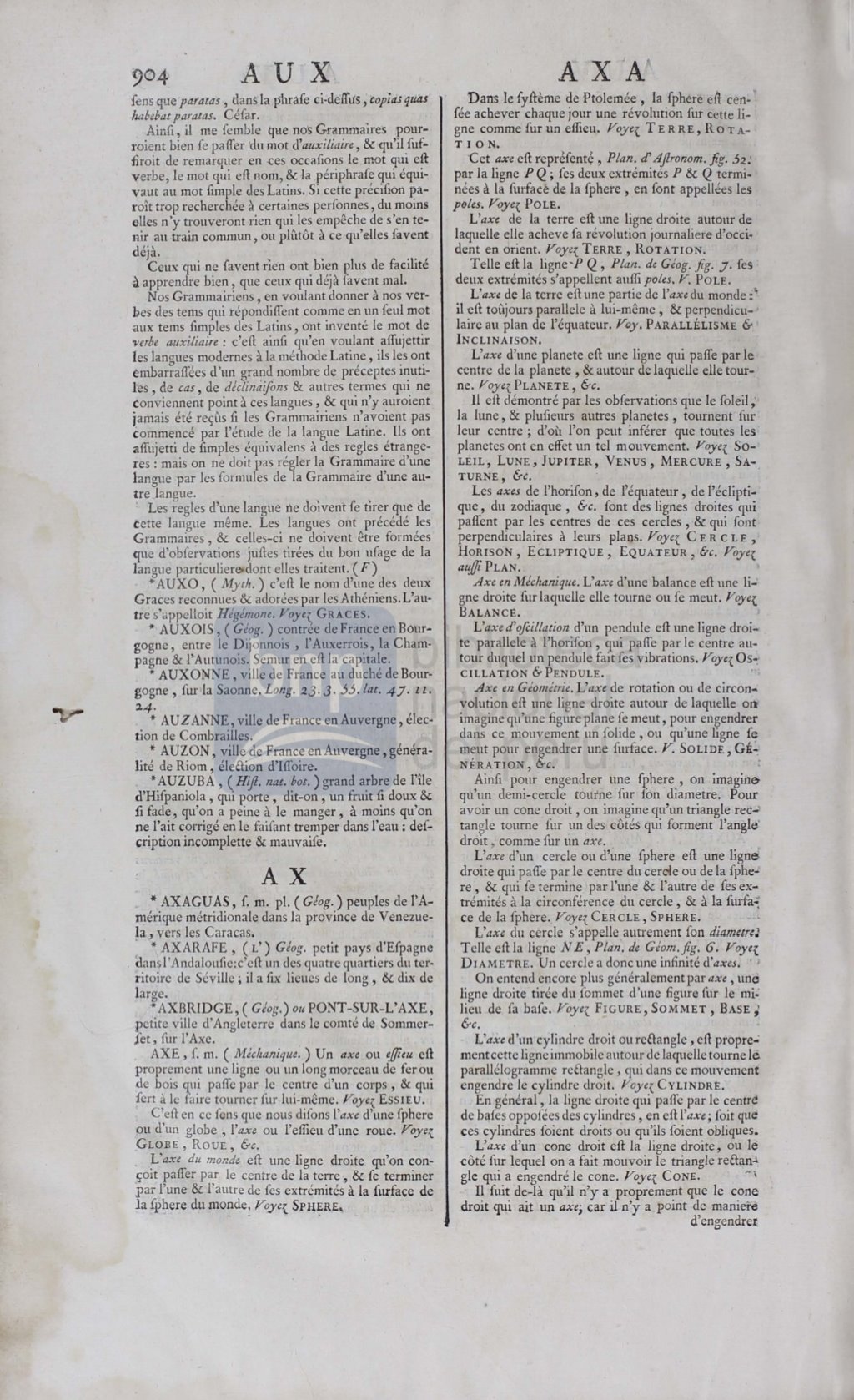
AUX
fens{{ue
paratas ,
danS la phrafe ci.cle'ltus,
copias
quas
lu,hebat para/as.
Cé{¡¡r.
Ainíi,
il
me (emble que no's Grammaires pour–
roient bien (e pa!fer du mot
cl'auxiliaire,
&
qu'il
(uf~
:/iroit de remarcruer en .ces occaíions le mot qui
ea
v erbe, le mot
q~li
eil nom,
&
la périphrafe qui écp.¡j–
vaut au mot limpie des Lacins. Si cette précilion pa–
rOlt trop recherchée
a
certaines perfonnes, du moins
elles n 'y trouveront rien 'lui les empeche de s'en te–
nir au train commun, ou lJlíhot
a
ce qu'elles favent
d '"
eJC~ux
qui ne (avent Tten ont bien plus de facilité
a
apprendre bien, que ceux qui déja (aven! mal.
Nos Grammairiens , en voulant donner a nos ver–
bes des tems cp.¡j répondi!fent comme en un (eul mot
aux tems fimples de Latins, ont inventé le mot de
'Verbe auxiliaire:
c'eil ainfi qu'en voulant aífujetcir
les lancrues modernes a la méthode Latine, ils les ont
embaT~aífées
d'un grand nombre de préceptes inuti–
les, de
cas,
de
déclinaifons
&
autres termes 'lui ne
t onviennent point a
Ces
langues,
&
qui n'y auroient
jamais été reC;lls fi les Grammairiens n'avoient pas
éommencé par l'énlde de la langue Latine. lis ont
a!fujetti de fimples équivalens
a
des regles étrange–
res: mais on ne doit pas régler la Grammaire d'une
langue par les formules de la Grammaire d'une au–
tre langue.
. Les regles d'une langue !'le doivent fe tirer que de
tette langue meme. Les langues ont précédé les
Grammaires ,
&
celles-ci ne doivent etre formées
que d'ob(ervations juiles tirées du bon ufage de la
langue particuliere.dont elles traitent.
(F)
" AUXO, (
Myth.
)
c'ea le nom d'une des deux
Graces reconnues
&
adorées par les Athéniens.L'au–
tre s'appelloit
H¿gémone. Voye'{,
GRACES.
" AUX01S, (
Géog.
)
contree de France en Bour–
gogne, entre le Dijonnois , l'Auxerrois, la Cham·
pagne
&
l'Autunois. Semur en eilla capitale.
• AUXONNE, ville de France au duché de Bour–
gogne , (m la Saonne.
Long.
23.3.
JJ.
lato
47.
ll.
24-
" AUZANNE, ville de France en Auvergne , élec–
tion de Combrailles.
.. AUZON, ville de Franee en Auvergne ,généra–
lité de Riom , éleétion d'I([oire.
"AUZUBA , (
Hifl. nato boto
)
grand arbre de l'lle
a'Hifpaniola, qui porte, dit-on, un fruit fi doux
&
fi
fade, qu'on a peine
a
le manger, a moins qu'on
ne I'ait corrigé en le faifant tremper dans l'eau ; def–
cription incomplette
&
mauvaj(e.
AX
.. AXAGUAS, f. m. pI.
(Géog. )
pellples de l'A–
méricp.lemétridionale dans la province de Venezue–
la)
vers les Caracas.
. *
AXARAFE , (L')
G¿og.
petit pays d'Efpagne
dansl'Andaloufie:c'ea un des quatre quartiers du ter·
ritoire de SéviUe; il a ftx lieues de long,
&
dix de
large.
..AXBl,UDGE, (
Géog.)
Olt
PONT-SUR-L'AXE,
petite ville d'Angleterre dans le comté de Sommer–
fet,
(ur l'Axe.
AXE, f. m. (
Mecllanique.
)
Un
axe
OU
ef!ieu
eil
proprement une ligne ou un long morceau de fer ou
de bois 'tui paífe par le centre d'un corps ,
&
cp.li[ere
a
le faire tourner ftu lui·meme.
Voye{
ESSIEU.
C'ea en ce (ens que nous difons
I'axe
d'une fphere
ou d'un globe ,
I'axe
ou l'effieu d'une roue.
Voye{
GLOBE, ROUE,
&c.
!--'axe du monde
eil une ligne oreite cp.l'on con–
rrolt pa!fer par le centre de la terre ,
&
(e terminer
p ar l'une
&
l'autre de fes extrémités
a
la furface de
la fphere du
mondc~
Voy e{
SPHERE,
AXA
Dans le
fyf'H:rtte de Ptolemée , la fphere
ea
ceno
fée achever
chacp.lejour une révolurion fur cette li–
gne comme {ur un elIieu.
Voye{
TER RE, Ro TA–
TI o
N.
'Cet
axe
eíl:
reprerent~
,
Plan.
d'
AJlronom. fig.
J2.'
par la ligne
P
Q;
fes deux extrémités
P
&
Q
termi–
nées
a
la (urface de la (phere , en font appellées les
poles. Vcye{
POLEo
L'axe
de la terre eil une ligne droite alltour de
laquelle elle acheve fa révolution journaliere d'oeci.
dent en oriento
Voye{
TERRE , ROTATION.
Telle eilla ligne-P
Q,
Plan. de Glog. fig.
J.
fes
oeux extrémités s'appellent aulIi
poles. V.
POLEo
L'
axe
de la terre eilune partie de l'
axe
du monde:'
il
eíl: tofljours parallele
a
lui-meme,
&
perpendicu–
laire au plan de I'écp.lateur.
Voy.
PARALLÉLISME
&
INCLINAISON.
L'axe
d'une planete eíl: une ligne qui paífe parle
centre de la planete ,
&
autour de laquelle elle tour–
neo
Voye{
PLANETE ,
&c.
Il en démontré par les obfervations que le foleil;
la lune,
&
plufieurs autres planetes , tournent {ur
leur centre; d'oll I'on peut inférer que tontes les
planetes ont en e/fet un te! mouvement.
Voye{
So–
LEIL, LUNE, JUPITER, VENUS, MERCURE, SA-
TURNE,
&c.
-
Les
axes
de l'horifon, de l'équateur, de l'éclipti–
cp.le, du zodiaque,
&c.
font des lignes droites qui
pa!fent par les centres de ces cercles,
&
qni (ont
perpendiculaires a leurs plaos.
Voye{
CE RCLE,
HORISON, ECLlPTlQUE, EQUATEUR,
&c. Voye{
a~(fi
PLAN.
Axe en Méc!,anique.
L'
axe
d'une balance eíl: une
li~
gne droite fur laquelle elle tourne ou fe meut.
Voy~{
BALANCE.
L'axe d'rfcillation
d'un pendule eillme ligne aroi–
te parallele
a
I'horifon, qni pa!fe par le centre au–
tour duquelun pendule fait fes vibrations.
Voye{
Os~
CILLATION
&
PENDULE.
Axe en G¿om¿trie. L'axe
ae rotanon ou de circon–
volution ea une ligne droite autour oe lacp.lelle
011
imagine qu'nne figure plane fe meut, pour
en~endrer
oans ce mouvement un folide ,ou cp.l'une ligne fe
m~ut
pour engendrer une (urface.
r.
SOLIDE,
GÉ:~
NERATlON,
&c.
.
Ainfi pour engendrer une fphere, on imagin&
qu'un demi-cercle túurne fllT 10n diametre. Pour
avoir un cone droit , on imagine qu'un triangle rec-'
tan~le
toUTne fur un des cotés qui forment I'angle'
dron • comme fuI' un
axe.
L'axe
d'un cercle ou d'une fphere efr une ligne
droite cp.¡j paífe par le centre du cerde ou de la (phe–
re,
&
qui (e termine par ¡'une
&
I'autre de (es ex–
trémités
a
la circonférence du cercle ,
&
a
la
(1U-fa~
ce de la (phere.
Voye{
CERCLE, SPHERE.
L'axe
du cercle s'appelle autrement fon
diametreJ
Telle eilla ligne
N E, Plan. de Geom.fig.
6 .
Voye{
DJAMETRE. Un cercle a done une inlinité
d'axes.
.
¡
On entend encore plus généralementparaxe, une
ligne droite tirée du/ommet d'une figure fur le mi:
lien de (a bafeo
Voye{
FIGURE, SOMMET, BASE;
&c.
l.'axe
d'l1n cylindre aroit oureétangle, efr propre..'
mentcette ligneimmobile autonr de lacp.lelle tourne le
parallélogramme reétangle, qui dans ce mouvement
engendre le cylindre droit.
Voye{
CYLINDRE.
En général , la ligne droite qui pa!fc par le centre
de bares oppofées des cylindres , en eil l'
axe;
foit que
ces cylindres foient droits ou cp.l'ils foient obliques.
L'axe
d'un cone droit eilla ligne droite, ou le
coté fur
lecp.le! on a fait mouvoir le triangle reaan-\
gle qui a engendré le cone.
Voye{
CONE.
h'
11 fuit de-la 'lu'il n'y a proprement que le cone
droit
ql.liait
Ull
axe;
car
il
n'y a point de maniere
d'engendre~
















