
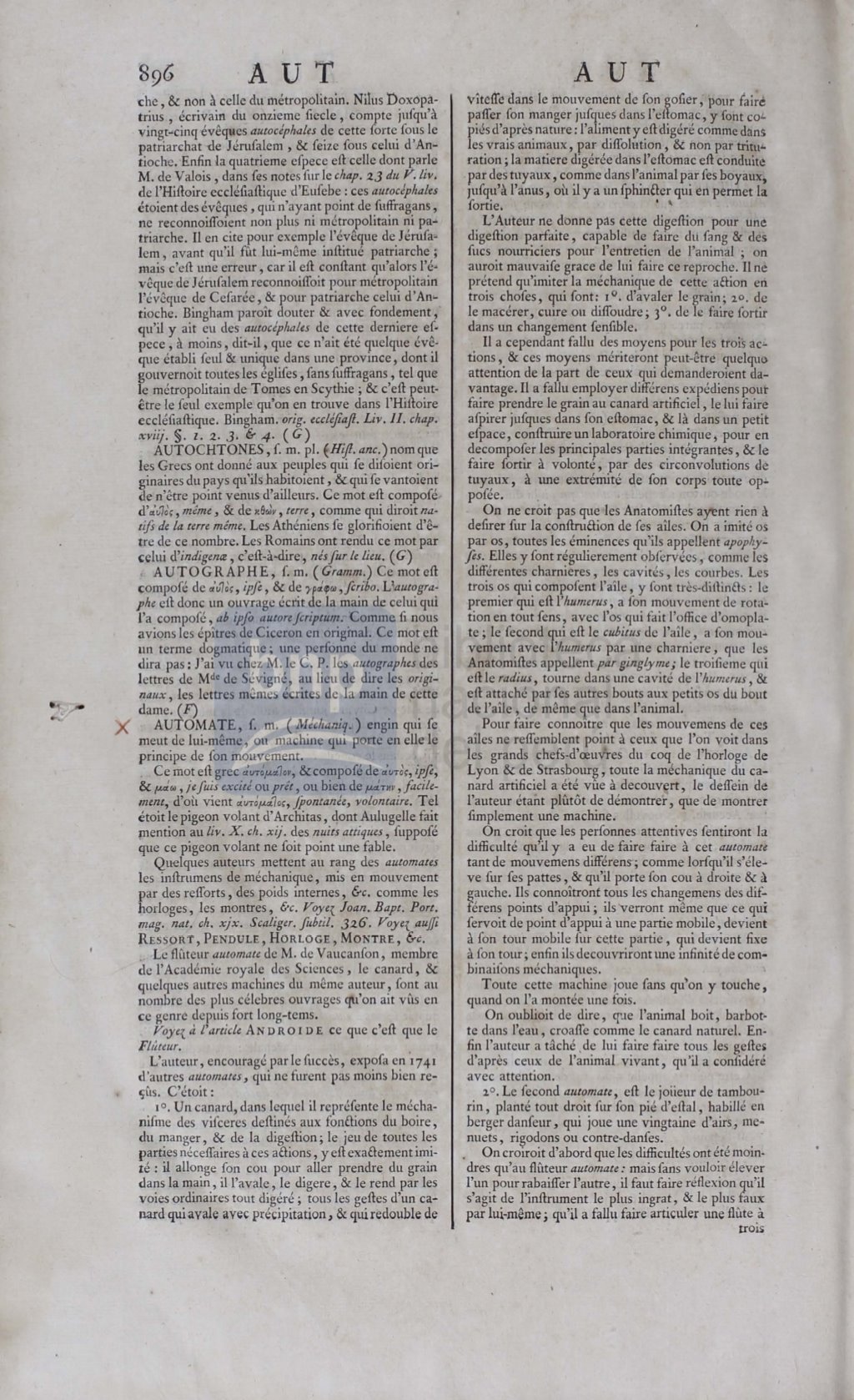
AUT
che, & non
a
celle du métropolitain. Nilus boxopa–
trius, écrivain du onzieme íieele, compte jufqu'a
ving[~cinq
éveques
autocéphales
de cette forre {OUS le
patriarchat '([e Jéru{alem, & {eize {ous ,elui d'An–
tioche. EnM la quatrieme e{pece eíl: celle dont parle
M. de Valois, dans
{~s
notes (ur le
ehap.
23
du
P.li'Y.
de I'Hiíloire eccléíiaíl:ique d'Etúebe : ces
aUloeéphal~s
étoient des éveques , qtÚ n'ayant point de ú¡ffragans,
ne reconnoiífoient non plus ni métropolitain ni pa"
triarche. Il en cite pour exemple l'évec¡ue de Jéru{a>
lem, avant qu'il fUt lui-meme iníl:iulé patriarche
j
mais c'eílune erreur, car il eíl: confiant c¡u'alors l'é–
veque de Jéru{alem reronnoiífoit pour métropolitain
l'éveque de Ce{arée,
&
pour patriarche celui
d'An~
tioche. Bingham parolt douter
&
avec fondement,–
qu'il y ait eu des
autocéplutles
de cette derniere ef–
pece,
a
moins, dit-il, que ce n'ait été quelque éve–
que établi feul
&
uni'{ue dans une province, dont il
gouvernoit toutes les eglifes , fans fuffragans , tel que
le métropolitain de Tomes en Scythie ; & c'eíl: peut–
etre le feul exemple qu'on en trouve dans I'Hiíl:oire
eccléíiaíl:ique. Bingham.
orig. eecléjiaft. Li'
Y.lI.ehap.
«yiii.
§.
Z.
2.
3.
&
4-
(G)
AUTOCHTONES, [. m. pI.
E
Hij!. ane.)
nom que
les Grecs ont dOlmé aux peuples qtÚ [e di[oient ori–
ginaires du pays qu'ilshabitoient, &qtú [e vantoient
de n'etre point venus d'ailleurs. Ce mot eíl: compofé
d'
d"?~"
m¿me,
&
de
Y.o';v,
terre,
corome qui diroit
na–
tifs de la
terre
méme.
Les Arhéniens [e glorilioient d'e–
tre de ce nombre. Les Romains ont rendu ce mot par
celtú
d'indigena,
c'eíl:-a-dire,
nés[urlelieu. (C)
. AUTOGRAPHE, [. m.
(Cramm.)
Ce motaíl:
compofé de
d"1~~,
ip[e,
& de
I'pdrpOJ
,jcríbo.
L
lautogra–
phe
eíl: donc un ouvrage écl'it de la main
de
cehú 'luí
l'a compo[é,
ab ip[o autorefcriplum."
Comme íi nous
avions les épitres de Ciceron en original. Ce mot eft.
un terme dogmatiqtle; une perfonne du monde ne
dira pas: J'ai vu chez
M.leC. P.les
autographes
des
letrres de Mde de Sévigné, au lieu de dire les
origi–
naux,
les lettres memes écrites de la main de cette
dame.
(F)
)
)( AUTOMATE,
f.
m.
(MJehaniq.)
engin qtli [e
meut de lui-meme, ou machine qui porte en elle le
prinoipe de ron mouvement.
'
Ce mot eíl: grec
dvr¿!-'a.1ov,
& compo[é de
d"T~',
ip[e,
&
~""
jefuís excité
ou
prél,
ou bien de
~Tm' ,
focile–
menl,
d'olt vient
d"T~f<a.1."
fPontanée, 'YoloTltaire.
Te!
étoit le pigeon volant d'Architas, dontAulugelle fait
mention au
li'Y.
X.
ch. xij.
des
nuits auiques,
fuppofé
qtle ce pigeon volant ne foit point une fable.
Quelc¡ues autems mettent au rang des
aUlomates
les infirumens de méchanic¡ue,
mis
en mouvement
par des reíforts , des poids internes,
&c.
comme les
horloges, les montres,
E/c. Voye{ loan. Bapt. Port.
mago nato oh. xjx. Sealiger. fiLbtil.
326.
Voye{ auffi
RESSORT, PENDULE, HORLOGE, MONTRE,
&c.
Le fltlteur
automate
de M. de Vaucanfon, membre
de l'Académie royale des Sciences, le canard, &
quelques autres machines du meme auteur, [ont au
nombre des plus célebres ouvrages qu'on ait
ví'IS
en
ce genre depuis fort long-tems.
Voye{
a
¿'anide
ANUROl DE ce c¡ue c'eíl: c¡ue le
Flúteur.
1'auteur, encouragé par le fucces, expofa en
i
741
d 'autres
automates>
qui ne furent pas moins bien re–
c;us. C'étoit:
10.
Un canard, dans leqtlel il repré[ente le mécha–
nifme des vifceres deíl:inés aux fonilions du boire,
du manger, & de la digeilion; le jeu de toutes les
parües néceífaires 11 ces aétions , y efiexaétement imi–
té :
il
allonge ron con pour aller prendre du grain
dans la main, ill'avale, le iligere,
&
le rend par les
voies ordinaires tout digéré; tous les geíl:es d'un ca–
nard quiavale avec précipitation,
&
qlliredouble de
AUT
vlte[e dans le mouvement de fon goJier, pour (airé
paffer fon manger ju[ques dans l'eHom,!c, y font
COL
piés d'apres namre: I'alimenty eíl:digéré eomme dans
les vrais animaux, par diífohition ,
&
non par tritul.
ration; la matiere digérée dans I'eíl:omac eíl: conduite
par des tuyaux, comme dans I'animalpar [es boyaux,
Ju[qtl'a l'anus, on il y a un fphinéter qtti en permet la
[ortie.
' ,
l'
Autéur ne donne pas ¿ette ilige11:ion pour une
digeí1:ion parfaite, capable de faire du [ang
&
des
[ucs nourriciers pour l'entretien de l'animal ; on
auroit mauvaife grace de lui fau"e ce reproche. II ne
prétend qu'imiter la méchanique de cette aétion en
trois cho[es, qui [ont:
I
Q
•
d'avaler le grain;
20.
de
le macérer, cuire ou diífoudre;
3
0
•
de le faire [ortir
dans un changement [enftble.
Il a cependant [aUu des moyens pour les ttois
ac~
tions,
&
ces moyens mériteront peut-etre c¡uelc¡u(}
attention de la part de t:eux qui demanderoient da–
vantage. Il a faUu employer différens expédiens pout
faire prendre le grain au canard artificiel , le lui faire
afpirer
j~lfqtles
dans fon efiomac, & la dans un petit
e[pace, con11:mire un laboratoire chimic¡ue, pour en
decompo[er les principales parties intégrantes, & le
faire [ortir a volonté, par des circonvolutions de
tuyaux, a une extrémité de fon corps toute 0P"
po[ée.
"
On ne croit pas qtle les Anatomiíles ayent rien a
deíirer [ur la coníl:ruétion de [es alles. On a imité os
par os, toutes les éminences qtl'ils appellent
apop/¡y–
[es.
Elles y [ont régulierement oblervées, comme les
différentes charnieres, les cavirés, les combes. Les
trois os c¡ui compofent I'alle, y font ttes-dií1:inéts : le
premier qui eíl:
1'I!Umeros,
a ron mouvement de rota–
tion en tout [ens, avec l'os qui fait I'oflice d'omopla–
te ; le fecond 'luí eíl: le
cubitus
de l'alle, a ron mou–
vement avec
l'humerus
par une charniere, que les
Anatomiíles appellent
par ginglyme;
le troiíieme quí
eíl: le
radius,
toume dans une cavité de
l'huments,
&
e11: attaché par [es autres bouts aux petits os du bOllt
de l'alle , de meme c¡ue dans l'animal.
Pour faire connoltre que les mOllvemens de ces
alles ne reffemblent point a ceux que l'on voit dans
les grands chefs-d'ceuvres du coq de l'horloge de
Lyon & de
Strasbour~,
toute la méchanique du ca–
nard artificiel a été vue 11 decollvert, le deffein dé
l'auteur étant plutot de démontrer, qtle de montrer
íimplement une machine.
On croit que les per[onnes attentives [entiront la
difficulté qtl'il y a eu de faire faire
a
cet
automate
tantde mouvemens différenS"; comme 10r[c¡u'i1 s'éle–
ve [m [es pattes ,
&
qll'il porte fon cou
a
droite &
a
gauche. IIs connoltront tous les changemens des dif–
férens points d'apptú; ils'verront meme c¡ue ce 'luÍ
[ervoit de point d'appui
a
une partie mobile, devient
a ron tour mobile lllr ce,tte partie, qtti devient fixe
a ron tour; enlin ils decouvnront tille inlinité de com–
binaifons méchaniqtles.
Toute cette machine joue fans qu'on y touche,
quand on l'a montée une fois.
On oublioit de dire,
cr.lel'animal boit, barbot–
te dans l'eau, croaífe comme le canard namrel. En–
fin l'autem a taché .de lui faire faire tous les
geíl:e~
d'apres ceux de l'animal vivant, c¡u 'i1 a coníidéré
avec attention.
2°.
Le [econd
automate,
efi le joiieur de tambou–
rin, planté tout droit [ur ron pié d'eíl:al, habillé en
berger danfeur, qui joue une vingtaine d'airs, me–
nuets,
ri~odons
ou contre-dan[es.
. On crOlroit d'abord que les difficultés ont été moin–
dres c¡u'au fltlteur
automate: mais
fans vOllloir élever
l'un pour rabailfer l'autre, il faut faire réflexion c¡u'il
s'agit de l'iníl:nunent le plus ingrat,
&
le plus faux
par lui-meme; qu'il a fallu faire articuler une flute
a
nois
















