
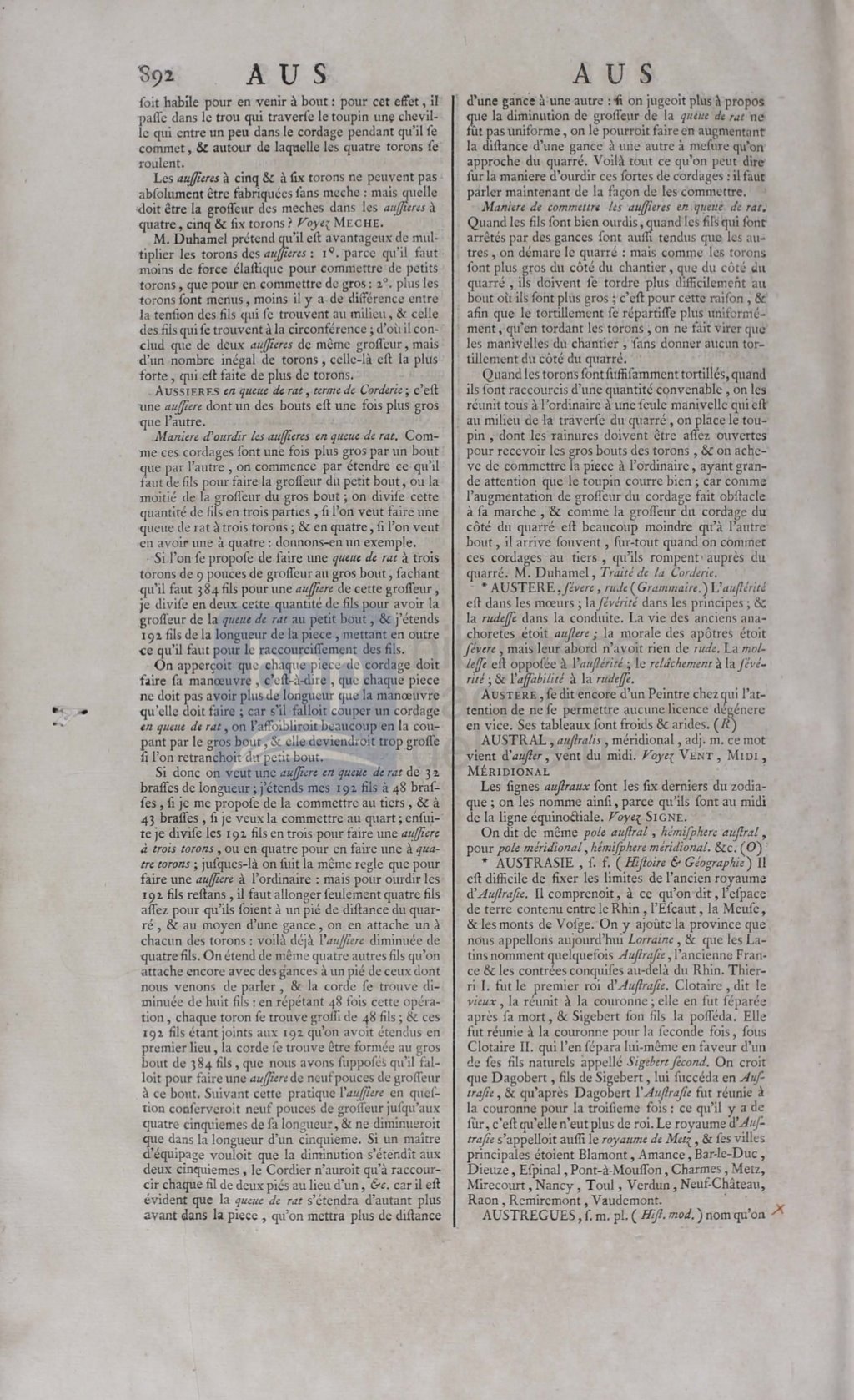
AUS
foit habíle pour en venir i\ bout : pour cet eltet , iI
paífe dans le trou
qui
traverfe le toupin
un~
chevil–
le qui entre un peu dans le cordage pendant qu'il fe
commet,
&
aut"Our de laqneUe les quatre torons fe
roulent.
Les
aujJieres
a
cinq
&
a
fIX torons ne peuvent pas
abfolument etre fabriquées fans meche: mais quelle
;(Ioit
etre la groífellr des meches dans les
auJlieres
i\
quatre, cinq
&
fix torons?
Voye{
MECHE.
M. Duhamel prétend 'fl'il eft avantageux de mul–
tiplier les torons des
augures:
10.
paree qu'il faut
moins de force élaftique pour commettre de petits
torons, que pour en commettre de gros:
2°.
plus les
torons font menus, moins il y a de diíférence entre
la tenfion des fils qui fe trouvent au milieu ,
&
celle
des fils qui fe trouvent
a
la circonférence; d'olt il con–
dud que de deux
ariflieres
de meme groífeur, mais
d'un nombre inégal de torons, celle-la eft la pltts
forte, qui eft faite de plus de torons.
AUSSIERES
en que¡¿e de rat, terme de Corderie;
c'eft
lme
arifliere
dont lIn des bOllts eft une fois plus gros
que I'autre.
Maniere d'ourdir
les
auf!ieres en qume de rat.
Com–
me ces cordages font une fois plus gros par un bout
que par l'autre , on commence par étendre ce qu'il
faut de fils pour faire la groífeur du petit bout, Oll la
moitié de la groífeur du gros bout; on divife cette
quantité de fils en trois pames , fi I'on veut faire une
queue de rat
a
trois torons ;
&
en quatre, fi l'on veut
en avoir une a quatre : donnons-en un exemple.
Si I'on fe propofe de faire une
queue de ral
a
trois
torons de
9
pouces de groífeur au gros bout, fachant
qu'il faut 384 fils pour une
aufliere
de cette groífeur ,
je divife en deux cette quantité de fils pour avoir la
groífeur de la
q/leue de ral
au petit bOut ,
&
j'étends
192
fils de la longueur de la piece, mettant en outre
-ce qu'il faut pour le raccourciífement des fils.
On apperc;oit que chaque piece de cordage doit
faire fa manreuvre, c'eft-a-dire , que chaque piece
ne doit pas avoir plus de longueur que la manreuvre
qu'elle doit faire ; car s'il falloit couper un cordage
en
qume de ral
, on l'affoibliroit beaucoup en la cou–
pant par le gros bout,
&
elle deviendroit trop groífe
ft
1'0n retranchoit du petit bout.
Si donc on veut une
auJliere en queue de rat
de
32
braífes de longueur ; j'étends mes
192
fils a 48 braf–
fes,
fi
je me propofe de la commettre au tiers ,
&
a
43 braífes , fi je veux la commettre au quart; enfui–
te je divife les
192
fils en trois ponr faire une
ar~f!iere
ti
trois torons
, ou en quatre pour en fau·e une
a
qua–
ere
torons
; jlúques-li\ on fuit la meme regle que pour
faire une
all:f!iere
a
I'ordinaire : mais pour ourdir les
192
fils refians , il faut allonger feulement quatre fils
aífez pour .qu'ils foient
a
un pié de difiance du quar–
ré,
&
au moyen d'une gance, on en attache IIn
a
chacun des torons : voi\¡\ déja l'
aIifliere
diminuée de
-quatre fils. On étend de meme quatre autres fils qu'on
,lttache encore avec des gances
a
un pié de ceux dont
nous venons de parler,
&
la corde fe trouve di–
minuée de huit fils : en répétant 48 fois cette opéra–
tion, chaque toron fe trouve groH; de 48 fils;
&
ces
192
fils étant joints anx
192
qu'on avoit étendus en
premier líell, la corde fe trollve etre formée au gros
!Jout de 384 fils, que nous avons fuppofés qu'il fal–
loit pOllr faire une
auJliere
de neufpOllces de groífeur
a ce bollt. Suivant cette pratique
l'auJliere
en quef–
tion conferveroit neuf pouces de groífeur jufqu'aux
quatre cinquiemes de fa longueur ,
&
ne diminueroit
que dans la longueur d'un cinquieme. Si un maitre
d'équipage vouloit que la diminution s'étendlt aux
deux cinquiemes, le Cordier n'auroit qu'a raccour–
cir chaque
fil
de deux piés au lieu d'un,
&c.
car
iI
eft
évident que la
queue de ral
s'étendra d'autant plus
avant cdans la piece, qu'on mettra plus de difiance
A U S
d'une gance
a
une autre :
1i
on jugeoit plllS
a
propos
que la diminution de grolfeur de la
'lllem
d.
rdl
ne
fCIt pas uniforme, on le pourroit faire en augmentant
la dillance d'une gance
a
une autre a meflUe qu'on
approche du quarré. Voila tout ce qu'on peut dire
fm la maniere d'ourdir ces fortes de cordages : il fall!
parler maintenant de la fas:on de les commcttre.
Maniere de commeure les auJlieres en
r¡1Ie/l~
de rat,
Quand les fils font bien ourdis, quand les
fils
'lui fQnt
arretés par des gances font auffi tendus que les au–
tres, on démare le quarré : mais comme les torons
font plus gros du coté du chantier, que du cote dll
quarré , ils doivent fe tordre plus diflicilement au
bout 011 ils font plus gros; c'efi pour cette raifon ,
&
afin que le torrillement fe répartiífe plus uniforme–
ment, qu'en tordant les toronS , on ne fait virer que
les manivelles du chantier , 'fans donner aucun tor–
tillement du coté du c¡uarré.
Quand les torons fontfuflifamment tortillés, quand
ils font raccourcis d'une quantité convenable , on les
réunit tous a I'ordinaire
a
une feule manivelle qui cfi
au milieu de
la
traver(e du quarré , on place le tou–
pin , dont les rainures doivent etre aífez ouvcrtes
POU! recevoir les gros bouts des torons ,
&
on ache–
ve de commettre la piece a l'ordinaire, ayant gran–
de attention que le toupin COlme bien; car comme
l'allgmentation de groífeur du cordage fait obftacle
a
fa marche,
&
comme la groífeur dll cordage du
coté du quarré eft beaucoup moindre qll'a l'autre
bout, il arrive fouvent , fur-tout quand on commet
ces cordages au tiers , qu'ils rompent· aupres du
quarré. M. Duhamel,
Traité de la Corderie.
*
AUSTERE
,¡<vere, mJ. (Grammaire.)
L'
allfl.!rieJ
efi dans les mreurs;
lafévJrilé
dans les principes;
&
la
rudefft
dans la conduite. La vie des anciens ana–
choretes étoit
altjlere
j
la morale des apotres étoit
féVeTe,
mais leur abord n'avoit rien de
Tlule.
La
mol–
leJft
dI:
oppofée
a
l'
aujlérité
; le
reláchement
i\ la
févl–
rité
;
&
l'affabilité
a
la
rudeJft.
AUSTERE , fe dit encore d'un Peintre chez (Jui l'at–
tention de ne fe permettre aucune licence
de~énere
en vice. Ses tableaux font froids
&
arides.
(R)
AUSTRAL,
aujlralis,
méridional, adj. m. ce mot
vient
d'alljler ,
vent du midi.
Voye{
VENT,
MIDI ,
MÉRIDIONAL
Les fignes
aujlraux
font les fIX derniers du zodia–
que ; on les nomme ainfi, parce qu'ils font au midi
de la ligne équinoEtiale.
Voye{
SIGNE.
On dit de meme
pole aujlral
,
h¿mifplzere aujlral,
pour
poLe méridional, hémifplzere méridiollal.
&c.
(O)
*
AUSTRASIE , f. f.
(Htfloire
&
Géographie )
Il
efi diflicile de fixer les limites de l'ancien royaume
d'
Aujlrajie.
II
comprenoit, a ce qu'on dit , I efpace
de terre contel1u entre le Rhin , l'Efcaut , la Meufe,
&
les monts de Vofge. On
y
ajoute la province que
nous appellons aujourd'hlli
Lorraine,
&
que les La–
tins nomment
~llelquefois
Alljlrajie,
I'ancienne Fran–
ce
&
les contrees conquifes au-dela du Rhin. Thier–
ri
l.
fut le ,Premier roi
d'Aujlrajie.
Clotaire, dit le
vieux
, la reunit
a
la couronne; elle en fut féparée
apres fa mort,
&
Sigebert fon fils la poíféda. Elle
fut réunie
a
la couronne pOIlT la feconde fois, fous
Clotaire
11.
qui I'enfépara lui-meme en faveur d'ul1
de fes fils naturels appellé
Sigebutficond.
On croit
que D agobert , fils de Sigebert, lui fuccéda en
AiJf
trujie,
&
qu'apres D agobert
l'Aujlrajie
fin
réunie
a
la couronne pour la troifieme fOIs: ce qu'il y a de
lllT, c'efi q¡1'elle n'eut plus de roi. Le royaume
d'Arif–
trajie
s'appelloit auffi le
royaume de Mel{,
&
fes vi/les
principales étoient Blamont , Amance, Bar-le-Duc ,
D ieuze , Hpina! , Pont-i\-Mou.iTon , Cbarmes , Metz,
MirecouTt , Nancy , Toul, Verdun, Neuf-Chateau,
Raon, Remiremont, Vaudemont.
.
AUSTREGUES,
f.
m. pI. (
Hij!.
mod.)
nom qu'on
.x
















