
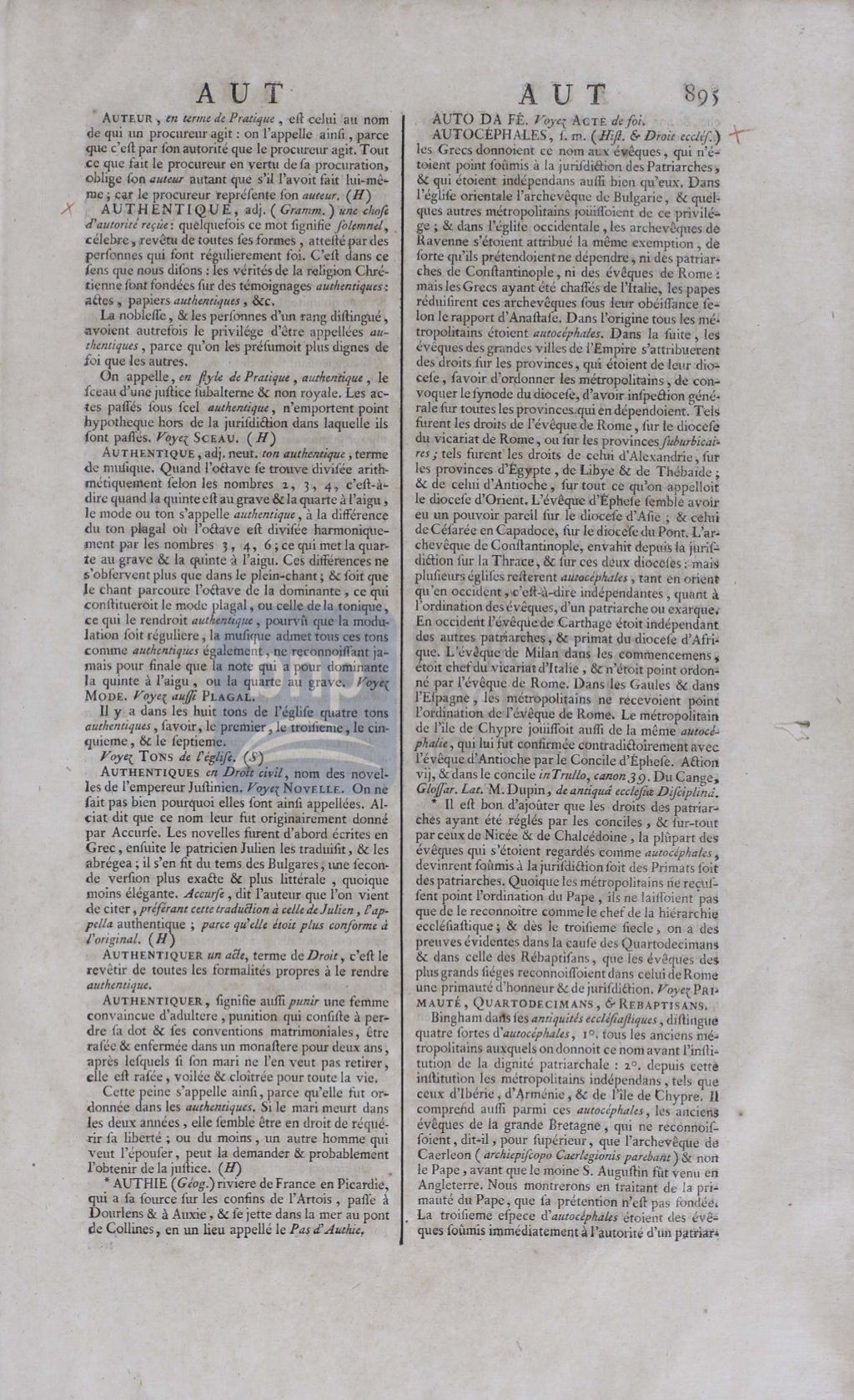
AUT
AUTEUR,
m
umledePraá"lu~,
eil-oelui au nom
de
qui un procurenr agit ; on l'appelle ainfi, parce
que c'eil par ron autorité que le procureur agitoTout
,ce que faíe le procureur en vertu de [a procuration,
oblige ron
t1UtelU
autant que s'i1I'avoít fait lui-me–
me.
qu:
le
pr,ocureur repréfente fon
auttllr.
eH)
x
AUTHENTI<2UE, adj.
e
Gramm.) une chofl
.¿'
autorité reyue;
quelquefois ce mot fignifie
jOlemnd,
célebre) ;revétu de toutes tes
fo~mes,
atteilépardes
perfonnes qui fone régulierement foí. C'eíl: dans ce
fens que nous di[ons ; les vérités de la religiOll Chré–
tÍenne font fondées [ur des témoignages
authmtiques,
aaes
~
papiers
authentiques
,
&c.
La nobleLre,
&
les per[onnes d'un rang dillingl1é
~
avoient autrefois le pl'
ivilé.ged'erre appellées
au–
lhentiqrus,
paree qu'on
les
pré{umoit plus dignes de
foí que les autres.
On appelle,
c,z
ftyle de Prati'lzu
,
autltentU¡ut,
le
fcean d'une juilice tUbalterne
&
non royale. Les ac–
tes paífés [ous fce!
autluntique,
n'emportent point
hypotheqtle hors de la jurífdifrion dans laquelle ils
font pafiék
Voye\.
SCliAU.
eH)
AUTHENTlQUE, adj. neut.
ton alllhentique,
terme
de I11niique. Quand I'oaave fe trouve divifée arith·
rnétiquement fe!on les nombres
2,
3, 4,
c'eil-a–
dice quand la quinteeil au grave
&
la quarte
a
I'aigu ,
le mode ou ton s'appelle
authentique
,
a
la di/férence
OU
ton plagal Ol! I'oaave eil divífée harmonique–
ment par les nombres
3, 4, 6;
ce qui met la quar–
te au grave
&
la quinte
a
l'aígu. Ces di/férences ne
5'obfervent plus que dans le plein-chant;
&
foit que
le chant parcoure I'oaave de la dominante, ce qui
conilitueroit le mode plagal, on celle de la tonique,
.ce qui le rendroit
allthentiqzu
,
pourvll que la modu–
lation foit réguliere , la mufique admet tous ces ton5
comme
authenti'llus
également, ne reconnoiiI"ant ja–
maís pom finale que la note qui a pour dominante
la quinte
el
I'aigu, ou la quarte au grave.
Voye\.
MODE.
Voye{ au.f!i
PLAGAL.
Il Y
a dans les huit tons de l'égli{e quatre tons
authelltiqlles,
favoir, le premier, le ttoifieme, le cin–
qllieme,
&
le feptieme.
Voy't
TONS
de Nglife.
(S)
AUTHENTIQUES
en Droit civil,
nom des novel–
les de I'empereur Juilinien.
Voye{
NOVELLE. On ne
fait pas bien pour<'{uoi elles font ainu appellées. AI–
eiat dit que ce nom leur fut originairement
donn~
par Accurfe. Les novelles finent d'abord écrites en
Grec, enfuite le patricien Julien les traduifit,
&
les
abrégea; i/ s'en fit du tems des Bulgares,
u.nefecon–
de vernon plus exaae
&
plus littérale , quoique
moins élégante.
Accurfe, dit
l'auteur que l'on vient
de citer ,
priférant ctUe traduélion
a
,elle
de
J
u[ien
,
l'
ap–
pclla
authenti~le
;
paree qu'elle étoit plus conforme
ti
l'original.
eH)
AUTHENTIQUER
/In aéle,
terme de
Droit,
e'eille
revetir de toutes les formalités propres
a
le rendre
awhenti'lzu.
AUTHENTIQUER, íignífie auffi
punir
une femme
convaínCble d'adultere , punition qui confiile
a
per–
dre fa dot
&
fes conventions matrimoniales, etre
rafée & enfermée dans un monafiere pour deux ans ,
apres lefquels fi (on mari ne l'en veut pas retirer,
elle eíl: ra{ée , voilée
&
cloitrée pour tollte la vie.
Cetre peine s'appelle ainfi, paree qu'elle filt or–
donnée dans les
authentiques.
Si le mari meurt dans
les deux années , elle femble etre en droit de réqué–
rir
fa liberté; ou du moins, un lIutre homme qui
Veut I'épou(er, peut la demander & probablement
l'obtenir de la jufUce.
eH)
*
AUTRIE
(Glog.)
riviere de France en Picardie,
qui
a [a {ource fm
les
con.fins de l'Artois, paíle
el
Dourlens &
el
Auxie,
&
fe jette dans la mer au pont
de Collines) en un lieu appellé le
Pas
d'
Autlzie,
AUT
AUTO
DA FÉ.
Yoye{
A1::TE
d~foi,
AUTOCÉPHALES, f. m.
e
Hift.
&
Eroit ecel?)
-\
les Grecs donnoient ce nom al.'( éveques, qui n'é–
tcient point foflmis
a
la jurifdiélion des Patriarches,
&
qui étoient indépendans auffi hien <Ju'eux. Dans
I'églife orieBtale I'archeveque de Btúgarie,
&
quel–
qlles autres métropolitains joiüifoient de ce privilé"
ge; & daos l'égliíe occidentale, les archev&p.tes de
Ravenne s'étoient attribué la meme exemption, de
forre qll'ils prétendoient ne dépendre, ni des patriar.
ches de Conilantinople,
ni
des éveques de Rome :
mais les Grecs ayant été chaifés de l'Italie, les papes
réduifuent ces archeveques fous leur obéilfance fe"–
Ion le rapport d'Anaíl:a{e. Daos I'origine tous les mé–
tropolitains étoient
alllocépluúes.
Dans la hlite, les
éveques des grnndes
villes
de l'Empire s'attribuerent
des droits fur les provinces, qu& étoient de le'ur dio–
cefe, favoir d'ordonner les métropolítains , de con..
voquer lefynode du diocefe, d'avoir infpeaion géné–
rale
hu
toutes les provinces..qlú én dépeneloiel1t. Tels
filrent les droits de
I'év~que
de Rome, fur le diocefe
du vicariat de Rome, ou fi1r les provinces
fuhurbicai–
res;
te!s ttlrent' les droits de cel1\i d'Alexandrie, fur
les provinces d'Égypte , de Libye
&
de Thébaide ;
&
de cellli d'Antioche, fur tout ce CJu'on appelloit
le diocefe d'Orient. L'éveqUe d''Éphc/e femble avoir
eu un pOllvoir pareil fur le dioce(e el'Afie; & cehü
de Céfarée en
Capadoce~
úu le dioce1e du Ponto L'ar–
cheveque de Con1l:antinople, envahit
depui~
lá
jurif–
diaion {ur la Tlutate ,
&
fur ces deux diocefes; mais
plufieurs églifes reil:erent
autoa¿phales
,
t.ant én orient
qu 'en occident
,\e'eft~-'<Üre
inelépendantes , quant
a
l'ordination des év.eques, d'un patriarche ou exarque.
En occident lIéveqtle:de .Carthage étoit indépendant
des autres patriÍarches,
&
primat du diocefe d'Afri–
~ue.
L'éveqtle"de Mi/an dans les commencemens;
etoít chefdu'vi'Carilltd'Italie;
&
n'etoit point ordon–
né par
l'év&~le
de
Rome. I}ans les Gaul\!s
&
dans
l'Efpagne, les métropolitain5 ne recevoient point
L'ordination de
l'6I~que
de Rome, Le métropolitain
de I'ile de Chypre joiüifoit auffi de la meme
aTJtocé~
phalie,
qllí lui fut confirmée contradiaoirement avec
l'éveque &Antioche par le Concile d'Éphefe. Aaion
vij, &dansle concile
inTmllo, cano1l39.
Du Cange,
GlOffar. Lat.
M.
Dupin,
de antiqud ecclejifE Difciplind.
.. II
ell:
bon d'ajoíl.ter que les droíts des patriar'"
ches ayant été rcíglés par
les
conci/es,
&
fur-tout
par ceux do Nicée & de Chalcédoine , la plftpart des
éveques qui s'étoient regardés comme
(/lltoclphalcs,
devinrent fo.llmis
a
la juriíQjaion[oit des Primats {oit
des patriarches. Ql10iqlle les métropolitains ne
re~ttf
fent point l'ordination du Pape, ils ne lailfoiem pas
que de le reconnoitre comme le chefde la hiérarchie
eccléíiaíl:iqlle; & d(¡s le troiíieme fiecle, on a des
prellves évidentes dans la caufe des Quartodecimans
&
dans celle des Rébaptifans, que les éveqtles des
plus grands fiéges reconnoiífoientdans celui de Rome
une primauté d'honneur
&
de jurifdiaion.
Voye\.
PR1"
MAUTt, QUARTODECIMANS,
&
REBAPTISANS.
Bingham dal1s fes
antiquités tccUfiaftiques
,diflingue
quatre {ortes
d'autocéphales,
l°.
fous les anciens mé.
tropolitains auxquels on donnoit ce nom avant l'inili.
tution de la dignité patriarehale ;
2°.
depuis cette
infUtution les métropolitains indépendans , tels que
ceux d'lbérie , d'Arménie ,
&
de l"'tle ele Chypre.
n
compreiíd auffi parmi ces
autocéphales,
les ancieJU
éveques de la grande Bretagne, qui ne reconrioíf–
foient, dit-il , pour fupérieur,
.qll~
l'archeveque de
Caerleon (
archupifcopo Caerügloms
par~bant
)
&
noñ
le Pape, avant que le moine S. Augufrin fllt venu en
Angleterre. NOlls montrerons en traitant de la
pri~
mauté du Pape, que fa prétention h'efi pas fondée.
La troiGeme efpece
d'autoc¿phaüs
éroient des éve"
ques follmi.s ímmédiatemel1t
a
l'autolité d'un p.íltriar.
















