
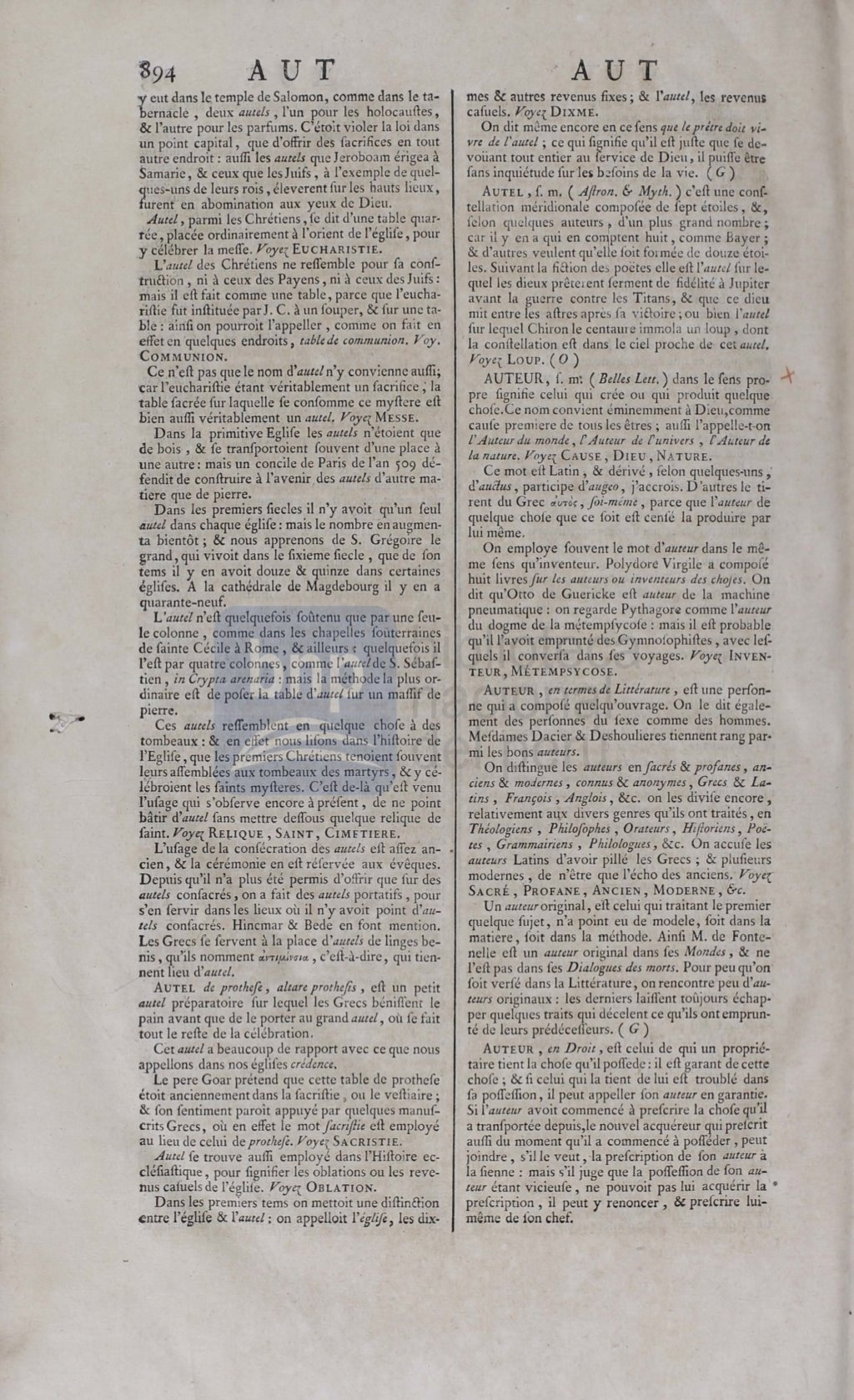
AUT
y
ent daos
le.
temple deSalomon, comme daos le ta·
bernáclé, deux
alUels,
¡'uo pour les holocauíl:es,
&
I'autre pour lesparnlms. C'étoit violer la loi dans
1m
point capital, que d'olfrir des facriñc(:s en tout
autre endroit: auffi les
autels
que Jeroboam érigea a
Samarie,
&
ceux que les Juifs , a l'exemple de quel–
ques-uns de leurs rois , éleverent fm les hauts lieux,
furent en abomination aux yellx de Dieu.
AuteL,
parmi les Chrétiens, fe dit d'une table quar–
rée, placée ordinairement a l'orient de I'églife, pour
y
célébrer la meífe.
Voye{
EUCHARISTlE.
L'
autel
des Chrétiens ne reífemble pour Ca cónC–
truétion, ni a ceux des Payens, ni
a
ceux des Juifs:
mais il eíl: fait comme \Ine table, parce que I'eucha–
rií1:ie fut iníl:itllée par
J.
C.
a un fouper,
&
Cur une ta–
ble: ain{j on pourroit I'appeller , comme on fait en
e/fet en quelques endroits,
tahle de cOllllllunion. Voy.
COMMUNION.
Ce n'eíl: pas que le nom
d'aulel
n'y convienne auffi;
'Cal' l"euchariíl:ie étant véritablement un Cacriñce ; la
table Cacrée Cur laquelle Ce conComme ce myfiere e1t
bien auffi véritablement un
alUel. Voy/{
MESSE.
Dans la primitive Eglife les
alUels
n'étoient que
de bois ,
&
Ce
tranfporroient fouvent d'une place a
une autre; mais un concile de Paris de I'ao 509 dé–
fendit de confuuire a l'avenir,des
alUels
d'autre ma–
riere que de pierre.
Dans les premiers {jec1es il n'y avoit qu'un Ceul
/lutel
dans chaque églife; mais le nombre en augmen–
la
bientat ;
&
nous apprenons de S. Grégoire le
grand, qui vivoit dans le {jxieme {jede, que de fon
tems il y en avoit douze
&
quinze dans certaines
~gliCes.
A la cathédrale de Magdebourg il y en a
quarante-neuf.
L'autel
n'e1t quelquefois Coutenu que par une [eu·
le c010nne , comme dans les chapelles Coüterraines
de Cainte Cécile aRome,
&
aillenrs ( quelquefois il
l'eíl: par quatre colonnes, comme
l'alttelde
S. Sébaf–
tien,
in Crypta. arenaria
:
mais la méthode la plus or·
dinaire eft de pofer la table d'
aueeL
fur un maffif de
pierre.
Ces
autels
reífemblent en quelque chofe
a
des
tombeaux :
&
en e/fet nous lifons dans I'hiftoire de
l'Eglife, que les premiers Chrétiens tenoient fouvent
lr,urs aífemhlées aux tombeaux des martyrs,
&
Y
cé–
lébroient les Caints myl1:eres. C'el1: de-la qu'efr venu
l'ufage qui s'obCerve encOre a préfent, de ne point
bíhir
d'autel
fans mettre deífous quelque relique de
faint.
Voy/{
REpQuE, SAINT, CIMFTIERE.
L'ufage de la confécration des
autels
e11 aífez'an–
cien,
&
la cérémonie en eíl: réfervée aux évec¡ues.
Depuis <¡u'il n'a plus été permis d'o/frir que fur des
autels
confacrés, on a fait des
auteLs
portatifs , pour
s'en Cervir dans les lieux Oll il n'y avoit point
d'au–
te/s
confacrés. Hincmar
&
Bede en font mention.
Les Grecs fe (ervent a la place
d'alfeels
de linges be–
nis, qtr'ils nomment
d.mp.lvIFJ<1.
,
c'e11-a-dire, qui tien·
nent lieu d'
aUlel.
AUTEL
de proehefe, altare prothefis,
efl un petit
auteZ
préparatoire fuI' lequel les Grecs béniírent le
pain avant que de le porter au grand
aueel,
orl fe fait
tout le refte de la célébration,
Cet
aued
a beaucollp de rapport avec ce que nous
appellons dans nos églifes
"édence.
Le pere Goal' prétend que cette table de prothefe
étoit anciennement dans la facriftie , ou le vefliaire ;
&
fon fenciment paroit apPllyé par quelques manuf–
crits Grecs, oll en effet le mot
facriflie
ell employé
au lieu de celui de
proehefe. VO'ye{
SACRISTIE.
Autel
fe trouve auffi employé dans I'Hifroire ec–
clé{jafuque, pour {jgnifier les oblations ou les reve–
nus cafuelsde I'églife.
Voy/{
OBLATlON.
Dans les premiers tems on mettoit une dillinétion
entre l'églife
&
¡'aueei;
on appelloit
l'égLife)
les dix·
AUT
mes
&
autres revenus lixes;
&
l'auteL,
tes
revenu~
cafuels.
V'?)'t{
DIXME.
On dit meme encore en ce{ens
'1m le p,¡ere doít vi.
vre de talUd;
ce qui {jgniñe qu'il e11 julte que Ce de–
voiiant tout entier au fervice de Dieu, il puiífe erre
fans inquiénlde fur 'le,
b~foins
de la vie.
(G)
AUTEL, f. m.
(Ajlron.
&
Myth.
)
c'e11 une conC·
tellaríon méridionale compoCée de Cept étoiles,
&,
felon quelques auteurs
r
d'un plus grand nombre;
car il y en a c¡ui en conwtent huit, comme Bayer;
&
d'al1tres veulentqu'elle foit fOlmée de dOl1ze étoi–
les. Suivant la ñétion des poetes elle efl:
I'autel
fm le·
quelles dieux pretelent (erment de lidélité a Jl1piter
avant la guerre contre les Titans,
&
que ce dieu
mit entre les altres apres fa viétoire; ou bit!n l'
/l/uel
fur lec¡uel Chiron le centaUl e ¡mmola un 10llp , dont
la conítellation el1: dans le ciel proche de cet
aueel.
Voye{
Loup. ( O )
AUTEUR,
f.
m:
(Belles Lett.)
dans le Cens pro-
-1
pre {jgniñe celui qui crée ou qui produit quel<¡ue
chofe,Ce nom convient éminemment
a
D ieu,cornme
caufe premiere de tous les etres ; auili l'appelle-t-on
L'AlUertrdu monde,
l'
AUlear
de
L'univers
,
L'
AUleur de
la natare. Voye{
CAUSE, DIEU ,
N
ATURE.
Ce mot el1: Lacin ,
&
dérivé, felon quelques-uns ,–
d'auC1us,
participe
d'augto,
j'accrois. D 'autres le ti–
rent du Grec
dUTO~,
/oí-mime,
parce que l'
autmr
de
quelC/ue chofe que ce (oit eft cente la produire par
luimeme.
On employe Couveot le mot
d'auteur
dans le me·
me fens qu'inventeur. Polydore Virgile a compofé
huit
livresfur les allteurs ou inventeurs des cllOJes.
On
dit qu'Otto de Guericke eíl
auteur
de la machine
pneumatique: on regarde Pythagoró: comme
l'allteur
du dogme de la
m~tempfycofe
: mais il eft probable
qu'ill'avoit emprunté des Gymnofophifles , avec le[·
quels il converfa dans fes voyages.
Voye{
INVEN·
TEUR, MÉTEMPSY COSE.
AUTEUR ,
en termes de Littérature,
efl: une penon.
ne qui a compofe c¡uelqu'ouvrage. On le dit égale.
ment des perfonnes du fexe comme des hommes.
Mefdames Dacier
&
Deshoulieres tiennent rang par–
mi les bons
aut<urs.
On difl:ingue les
auteurs
en
facrés
&
profanes, an·
ciens
&
Illodemes, connus
&
anonymes, Grecs
&
La·
tins, Frall
y
ois, Anglois,
&c.
on les divife encore ,
relativement aqx divers genres qu'ils ont traités , en
Théologiens
,
Philofophes, Orate/LrS, Hifloriens, Poc.
tes, Grammairiens, Philologues,
&c.
On accufe les
auteurs
Latins d'avoir pillé les Crecs ;
&
plu{jeurs
modernes , de n'erre que l'écho des anciens.
Voye(
SACRÉ, 'PROFANE, ANClEN, MODERNE,
&c.
Un
autmr
original, en celui c¡ui traitant le premier
quelque Cujet, n'a point eu de modele,
Coit
dans la
matiere, foit dans la méthode. Ain{j M. de Fonte·
nelle efr un
allleur
original dans fes
Mondes,
&
ne
l'efr pas dans fes
Dialogues des momo
Pour peu qu'on
foit verfé dans la Littérature, on rencontre peu d'
au–
teurs
originaux; les derniers Iailrent tOfljOtlTS échap.
per qllelc¡ues traits C/ui décelent ce c¡u'ils om empnm–
te de leurs prédéceífeurs. (
G )
AUTEUR ,
e7l
Droit,
efr celui de qui un proprié–
taire tient la chofe qu'il poífede: il efr garant de cette
chofe;
&
íi
celui qui la tient de lui efr troublé dans
fa poífeffion, il peut appeller fon
almur
en garantie.
Si
l'auteur
avoit commencé
a
prefcrire la chofe qu'il
a tranCportée depuis,le nouvel acquéreur
~lli
preterit
auffi dll moment qu'il a commencé
a
poífeder , peut
joindre,
s'ille
veut , la prefcription de fon
auteur
a
la [lenne : mais
~'il
juge que la poífeffion de fon
au–
teur
étant vicieufe, ne pouvoir pas lui acquérir la •
prefcription , il peut
y
renoncer,
&
prefcrire luí–
meme de Ion chef.
















