
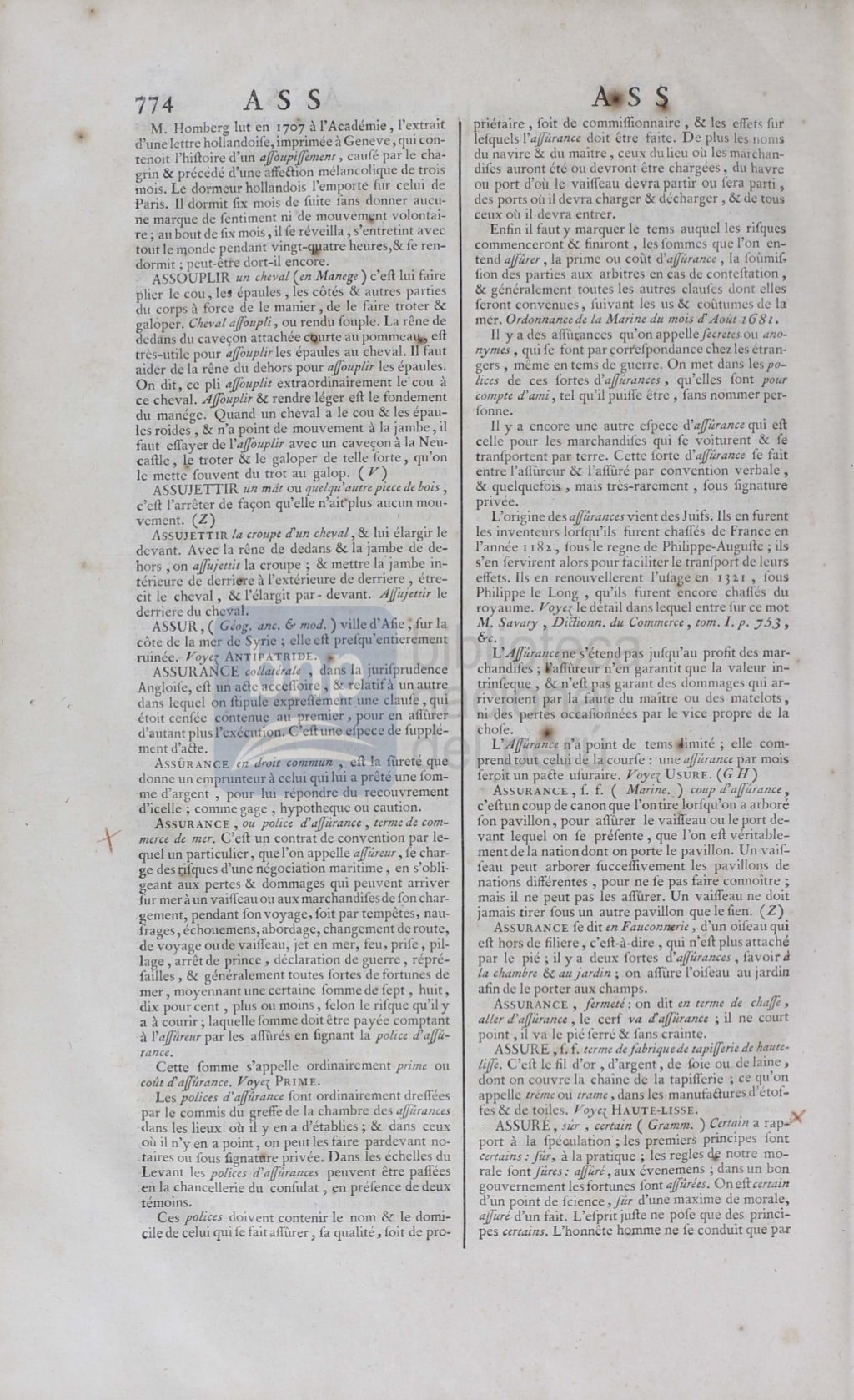
774
ASS
M. Homberg lut en 1707 a ['Académie, l'extrait
el'une lettre hollandoife, imprimée
a
Geneve, qui con–
tenoit l'hií!:oire d'un
a./Joupij{ement,
callfé par le cha–
grin & précédé d'une affellion mélancolique de trois
mois. Le dormem hollandois l'emporte
(ur
celui de
Paris. Il dormit {¡x mois de [uite fans donner aucu–
ne marque de [entiment
ro
de mouvement volontai–
re; au bout de
[IX
mois,
i~
[e réveilla , s'entretint avec
tout le monde pendant vmgt-qpatre hemes,& [e ren–
dormit ; peut-etre dort-il encore.
ASSOUPLIR
un c!Leval (en Manege
)
c'eí!: lui faire
plier le cou, le! épaulcs , les cotés & autres parties
du corps
a
force de le manier , de le faire troter
&
galoper.
C!Leval a./Joupli,
ou rendu [ouple. La rene de
dedans du cavec;:on attachée cQurte au pommeal1o, eí!:
o'es-utile pour
a./Jouplir
les épaules au cheval. Il faut
aider de la rene du dehors pour
a./Jouplir
les épaules.
On dit, ce pli
a./Jouplit
extraordinairement le cou
a
ce cheval.
A./Jouplir
&
rendre léger
ell:
le fondement
du manége. Quand un cheval a le con & les épau–
les reides , & n'a point de mouvement a la jambe, il
faut eífayer de l'
a./Jouplir
avec un cavec;:on
a
la Neu–
caille,
~e
O'oter
&
le galoper de telle (orte, qu'on
le mctte (ouvent du trot au galopo
(Y)
ASSUJETTIR
un mil
ou
quelqu'autre piece de hois ,
c'eí!: l'arreter de fac;:on qu'eIle n'aieplus aucun mou-
vement.
(Z)
,
ASSUJETTIR
la croupe cfun e!Leval,
& lui élargir le
devant. Avec la rene de dedans
&
la jall,lbe de de–
hors ,on
affujettit
la croupe ; & mettre la jambe in–
térieure de
derri~e
a
l'extérieure de derriere, étre–
cit le cheval,
&
l'élargit par- devant.
Affujutir
le
derriere du cheval.
ASSUR, (
Géog. ane.
&
modo
)
ville d'
A{¡e
,
{m la
cote de la mer de Syrie ; elle eí!: pre(qu'entierement
ruinée.
Yoye{
ANTIPATRIDE.•
ASSURANCE
eollatérale
,
dans la juri{prudence
Angloi(e, eí!: un aél:e acce!foire , & relatifa un autre
dans lequel on ftipule expre!fément une clau(e, qui
étoit cen{ée contenue au premier, pour en a!ftu'er
d'autant plus l'exécntion. C'eft une e(pece de {upplé–
mentd'aél:e.
AssúRANcE
en droit eommun
,
eíl: la íllreté que
donne un emprunteUl'
a
celui qui lui a preté une (om–
me d'argent , pour lni répondre du recouvrement
d'icelle ; comme gage , hypotheque ou caution.
ASSURANCE ,
ou polia d'a.f!ilranee, lerme de eom–
mera de mero
C'eí!: un contrat de convention par le–
quel un particulier, que l'on appelle
ajJurwr,
fe char–
ge des
~i{ques
d'une négociation maritime, en s'obli–
geant aux pertes
&
dommages qui peuvent arriver
fur mer
a
un vai!feau ou aux marchandi{esde ron char–
gement, pendant (on voyage, (oit par tempetes, nau–
trages, échouemens,abordage, changement de reute,
de voyage ou de vaiífeau, jet en mer, feu, pri{e , pil–
lage, arret de prince, déclaration de guerre , répré–
failles,
&
généralement tolltes {ortes de fortunes de
mer, moyennant une certaine [omme de {ept, huit,
dix
pour cent , plus ou moins , (elon le ri[que qu'il y
a
a
courir ; laquelle (omme doit etre payée comptant
a
l'
ajJúreur
par les aífiLrés en {¡gnant la
police d'a.fJú–
rance.
Cette {omme s'appelle ordinairement
prime
ou
COrlt
cfa.fJúrance. Yoye{
PRIME.
Les
poliees d'a.f!itrance
(ont ordinail'ement dre!fées
par le commis du greffe de la chambre des
a.fJúrances
dans les lieux Oll il Y en a d'établies;
&
dans ceux
oa il n'y en a point, on peut les faire pardevant no–
taires ou fous {¡gnatt'lre privée. Dans les échelles du
Levant les
polices d'a.f!itranees
peuvent etre paífées
en la chancellerie du con(ulat,
~n
pré{ence de deux
témoins.
Ces
polices
doivent contenir le nom
&
le domi–
cile de celui qui {e fait acrtuer , {a qualité, {oit de pro.
A
S
priétaire , {oit de commiffionnairc ,
&
les efrets fUI
lefquels
l'a.fJúrance
doit erre faite. De plus les n0111S
du navire & du maitre, ceux du lieu Oll les marchan–
Mes auront été
011
devront erre chargées, du havre
ou port d'oll le vai!feau devra partir ou fera parti
des ports Olt il devra charger & décharger ,
&
de
tou~
ceux
0\1
il devra entrer.
Enfin il faut y marquer le tems allquel les ri{ques
commenceront
&
finiront , les (ommes que I'on en–
tend
affitrer
,
la prime ou cOla d'
a.f!itrance
,
la {otlmi{,
{¡on des parties aux arbitres en cas de conteí!:ation ,
& généralement toutes les alltres claules clont elles
[eront convenues, {uivant les us
&
cOlltumes de la
mero
Ordollnallcede la Marim du mois cfAOtil z68l.
Il
ya des aíflltanCes qu'on appelleflcreus ou
ano·
"ymes,
qlli {e font par corre(pondance chez les étran–
gers, meme en tems de guerreoOn met dans les
po–
lices
de ces {ortes d'
aJlúranees,
qu'elles {ont
pour
comple d'ami,
tel qll'il puiífe etre , fans nommer pero
fonne.
Il
y a encore une autre efpece
d'ajJúrance
qui
dI:
celle pour les marchandifes qui (e voiturent
&
(e
tran(portent par terreo Cette {orte
d'a.f!ilrance
{e fait
entre I'aflltreur
&
I'aíftué par convention verbale,
& quelquefois , mais tres-rarement , (ous {¡gnamre
privée.
L'origine des
a.ffilrallees
vient des
J
uifs. Ils en furent
les inventenrs lor[qu'ils furent chaífés de France en
l'année
J J
82,
[ous le regne de Philippe-Auguí!:e ; ils
s'en {ervirent alors pour faciliter le rran(port de lems
effets. Ils en renouvellerent I'uiage en
J
3
2
J ,
fous
Philippe le Long, qu'ils furent encore chalrés du
royaume.
Yoye{
le détail dans lequel entre fur ce mot
M.
Savary
,
Diaionn. du Commerce, lomo
l.
p.
:;.53,
&c.
L'A.f!itrance
ne s'étend pas ju{qu'au profit des mar·
chandi(es; falrí'U'eur n'en garantit que la valeur in–
trin{eque ,
&
n'eí!: ras garant des dommages qui ar–
riveroient par la faute du maitre ou des matelots,
ni des pertes occa{¡onnées par le vice prepre de la
chofe.
L'AffUrance
n'a point de tems ./imité ; elle como
prend tout celui de la cour(e: une
affitrance
par mois
[eroit un paél:e uluraire.
Yoye{
USURE.
(G H)
ASSURANCE, f.
f. (
Marine.
)
eoup d'a.f!ilrance,
c'eftun coup de canon que I'ontire lor(qu'on a arboré
ron pavillon, pour afitU'er le vaiífeau ou le port de–
vant lequel on (e pré(ente, que I'on eí!: véritable–
mentde la nationdont on porte le pavillon. Un vaif–
{ean peut arborer {ucceffivement les pavillons de
nations différentes , pour ne fe pas faire cormoltre ;
mais il ne peut pas les aífluer. Un vaiífeau ne doit
jamais tirer {ous un autre pavillon que le (¡en.
(Z)
ASSURANCE (e dit
en Faucomurie,
d'un oi(eau qlÚ
eft hors de filiere, c'eí!:-a-dil'e , qui n'eft plus attaché
par le pié; il
Y
a deux [orres
d'ajJúrallces,
{avoir
ti
la chamhre
&
au jardín;
on aíflue I'oifeau au jardin
afin de le porter aux champs.
ASSURANCE,
firmeté:
on dit
en terme de c!Lafo,
aller d'aJlilrance
,le cerf
va cfajJtiranee
;
il ne COtU·t
point , il va le pié {erré
&
fans crainte.
ASSURE ,{. f.
mme de fabrique de tapi(Jerie de haute·
lij{e.
C'eí!: le fil d'or , d'argent, de {oie ou de laine,
dont on couvre la chaine de la tapi!ferie ; ce qu'on
appelle
lréllle
ou
trame,
dans les manufaél:ures d'¿tof–
fes
&
de toiles.
Yoye{
HAUTE-L1SSE.
ASSURÉ,
SIL/'
,
certain
(
Gramm.
)
Certain
a rap–
port
a
la {pécuJation; les premiers principes {ont
certains
"
jlr,
a
la pratique ; les regles
c1&
notre mo–
rale (ont
jures,' affiré,
aux évenemens ; dans un hon
gOllvernement les fortunes {ont
a.f!iírJes.
On eft
certain
d'un point de {cience
,jtir
d'une maxime de morale,
af!uré
d'un fait. L'efprir juJl:e ne po{e que des prínci–
pes
certains.
L'honnete hornme ne (e conduit que pa.r
















