
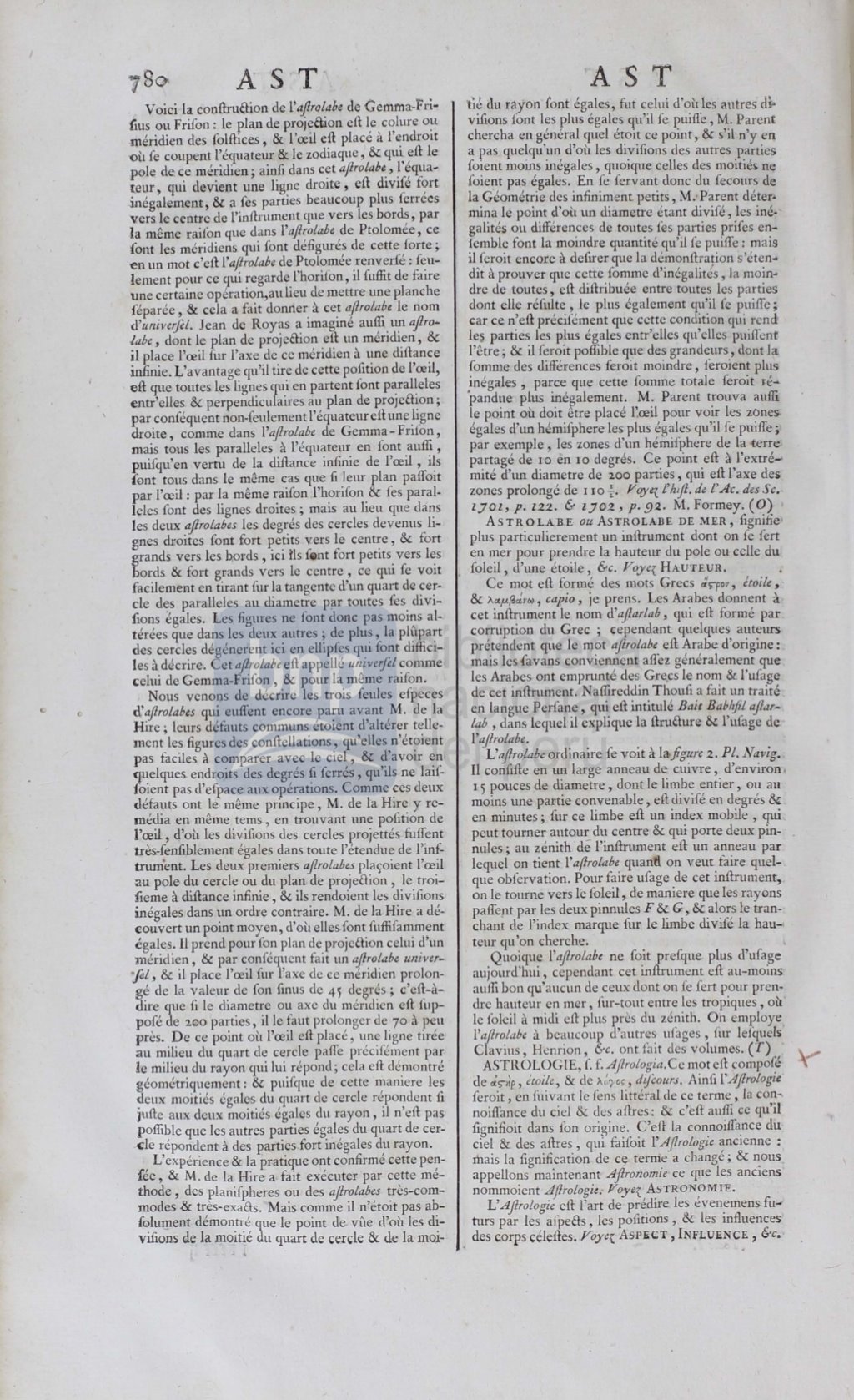
AST
Voiei [a cotlfu-uéhon de
l'aJlrolabe
de Cemma-Fri–
{¡us ou Frifon: le plan de projeaion efi le eolure
O~l
méridien des folfuces,
&
I'reil efi placé
a
I'endrolt
-oll fe coupent I'équateur
&
[e zodíaque,
&
qui efi le
pole de ce méridien; ainfi dans
e~t
aflrolabt.,
!'~qua
teur, qui devient une ligne drOlte, efi dlvlfe fort
.jnégalement,
&
a fes parries beaucoup plus ferrées
vers le centre de l'infirument que vers Les bords, par
la meme raí[on que dans l'
ajlrolabe
de Ptolomée, ce
follt les méridiens qui font défigurés de eette force;
-en un mot e'efi
I'aftrolabe
de Ptolomée renveóé: feu–
lement pour ee
~
regarde l'horuon, il fuffit de faire
une certaine operation,au lieu de mettre une.planche
féparée,
&
cela a fait donner
a
cet
aJlrolabe
le nom
d'univeifel.
lean de Royas a imaginé auffi
1m
aJlro–
.¿abe,
dont le plan de projefuon eH un méridien,
&
il place l'reil {itr I'axe de ce méridien
a
une diil:ance
.iniinie. L'avantage qu'i[ tire de cette pofition de I'reil,
efr que toutes les lignes qui en partent font paralleles
entr'elles
&
perpend.iculaires au plan de projeétion;
par conféquent non-feulementl'équateureHune Iigne
droite, comme dans
I'aftrolabe
de Gemma - Frilon,
mais tous les paralleles
a
I'équateur en font auHi,
puifqu'en vernt de la d.iil:ance infinie de l'reil , ils
Úmt tous dans le meme cas que fi leur plan paífoit
par I'reil : par la meme raifon l'horifon
&
fes paral–
leles font des lignes droites ; mais au lieu que dans
les deux
aJlrolabes
les degrés des cerdes devenus li–
gnes droites (ont fort perits vers le centre,
&
fort
grands vers les bords , ici tls (Qnt fort petits vers les
bords
&
fort grands vers le eentre, ee quí fe voit
facilement en tirant (ur la tangente d'un qtlart de cer–
de des paralleles au diamerre par toutes fes divi–
ftons egales. Les figures ne font done pas moins al–
térées que dans [es dellX autres ; de plus, la plllpart
des eerdes dégénerent ici en ellipfes quí font diffiei–
les
a
décrire. Cet
ajl.rolabe
efi appeUé
unive1jet
eomme
eeluí de Gemma-Frifon,
&
pour la meme raifon.
Nous venons de décrire les troís feules efpeees
d'aJlrolabes
qui eulfent encore pam avant M. de la
Hire; leurs défauts eommuns étoient d'altérer telle–
ment les figures des confteUarions, qll'elles n'étoient
pas faciles
a
comparer avec le cie!,
&
d'avoir en
que!ques endroits des degrés fi ferrés , qu'ils ne lai[–
foient pas d'efpace aux opérations. Comme ces dellx
défallts ont le meme principe, M. de la Hire y re–
méd.iaen meme tems, en troLlvant une poíltion de
l'reil, d'oh [es diviiions des cerdes
~rojettés
fuífent
tres-fenfiblement égales dans toute I'etendue de I'inf–
trtun·ent. Les deux premiers
aJlrolabes
plas;oient ['reil
au pole du eerde ou du plan de projeétion, le troi–
fteme
a
diil:ance infinie ,
&
i[s Tendoient les divifions
inégales dans un ordre contraire. M. de la HiTe a dé–
couvert un point moyen, d'Oll elles font fuffiíamment
égales. 11 prend pOllT fon plan de projeétion eelui d'un
méridien,
&
par coníéquent fait un
aJlrolabe univer–
"fol,
&
il plaee l'reil fur l'axe de ce méridien pro[on–
gé de la valeur de fon {inus de 45 desrés; c'efi-a–
tlire que flle diametre ou axe du méndien efi ¡¡Ip–
pofé de
2.00
parties, i[ [e faut prolonger de
70
a
peu
preso De ce point ola l'reil eíl: placé, une ligne tirée
au milieu du quart de cercle paífe préciíément par
le mi[ieu du rayon qui lui répond; cela efi démontré
géométriquement:
&
pui[que de eette maniere [es
deux moitiés égales du quart de eerde répondent fi
jufte aux deux moitiés égales du rayon, ji n'eH pas
poffible que les autres parties égales du quart de cer–
<le répondent
a
des parties fort inégales du rayon.
L'expérience
&
la pratique ont confirmé cette pen–
fée,
&
M. de la Hire a fait exéeuter par eette mé–
thode, des planiípheres ou des
aJlrolabes
tres-com–
modes
&
tres-exaéls. Mais comme il n'étoit pas ab–
{olument démontré que le point de vlle d'Oll les di–
vifions de la moitié du quart de ceede
&
de la
mQi-
AST
lié
du rayon font égales, fut ce!u! d'oll [es atltres
&.
vifions iont les plus égales qu'il fe plúífe , M. Parent
ehercha en général quel éroit ce point,
&
s'il n'y en
a pas que!qu'lIn d'oh les divi{ions des autres parries
foient mOlIlS lllégales, quoique celles des moiriés ne
foient pas égales. En fe fervant done du fecours de
la Géométrie des infiniment perits, M. Parent déter–
mina le paint d'oh uo d.iametre étant d.ivifé, les iné–
galités ou d.ilférences de toutes (es parties prifes en–
!embl~
font la moindre quantité qll'il fe plliife: mais
il feroa encore a defrrer que la démonfiration s'éten–
dit
a
prouver que cette fomme d'inégalité"s, la moin–
dre de toutes, eft d.iil:ribuée entre tomes les parties
dont elle réfulte , le plus éga[ement qu'il fe puiífe;
car ee n'eíl: précifément que eette condition qui rend
les parties les plus égales emr'elles qu'elles puiífent
l'etre;
&
i1
feroie poffible que des grandellTs, dont la
[omme des d.iiférenees feroit moindre, ü:roient plus
inégales, paree que cette [omme totale [eroit ré–
'pandue plus
iné~alement.
M. Parem trouva auffi
le point ola doit etre placé ['reil pour voir les zOnes
égales d'un hémifphere les plus ég¡¡les qu'il fe pniife;
par exemple , les zones d'un hémiíphere de la terre
partagé de
10
en
10
degrés. Ce point efi
a
I'cxtré–
mité d'un d.iametre de
2.00
parties , qui efi I'axe des
zones prolongé. de
110
f .
I/qyer
l'IuJl.
de l'Ac. des Se.
lJOl,
p.
l22.
&
lJ02,
p.
92. M. Formey.
(O)
ASTROLABE ouAsTROLABE DE MER, figniJie
plus particulierement un iufirument dont on fe [ert
en mer pOllT prendre la hauteur du poie
011
celle du
[oleil, d'une étoile,
&e. Voye{
HAUTEUR.
.
Ce mot eH formé des mots Grees
J,p•• ,
étoiie,
&
Aa.P.~d."""
capio,
je prenso Les Arabes donnent
a
eet infumnent le nom
d'aJlar/ab,
qui efi formé par
eorruption du Grec ; cependant que!ques auteurs
prétendem que le mot
aJlrolabe
eft Arabe d'origine:
mais les (avans conviennent aífez généralement que
les Arabes ont emprunté des Grecs le nom
&
l'ufage
de eet iníl:mment. Naffireddin Thoufi a fait
1m
traité
en langue Penane, qlú efr intitulé
Bait BabhfiL IlJlar–
lab
,
dans leqlle!
il
explique la íl:ruEture
&
l'ufage de
l'aJlrolabe.
L'aftrolabe
ordinaire fe voit a
[afgure
2.
Pl. Nal'ig.
Il confilie en un large anneall de cuivre, d'environ
I
5 pOllees de diametre , dont le limbe entier, ou au
moins une partie convenable, efi tlivifé en degrés
&
en minutes; fur ce
[imbe
eH un index mobile ,
qui
peut tomner autour du eentre
&
qui porte deux pin–
nules;
a1l zénith de I'inil:rument eíl: un anne3U par
lequel on tient
I'aflrolabe
quanti on veut faire quel–
que obfervarion. Pour faire ufage de cet inftrulllent,
on le tOllrne vers le [oJeil, de maniere que
les
rayoas
pa{fent par les deux pinnules
F
&
G,
&
alors le tran–
ehant de l'index marque fm le limbe divifé la hau–
tem qu'on eherche.
QlIoique
['aJlrolabe
ne foit pre[que plus d'ufage
alljourd'hlú, cependant eet infuument
eft
au-moins
auffi bon qu'aucun de eeux dont on fe (en pour pren–
dre hauteur en mer, fm-tout entre les tropiques, ou
le foleil
a
midi eíl: plus pres du zénith. On employe
l'
aflrolabe
a
beaucoup d'autres ulages, fur lelque/s
Cfavius, Henrion,
&c.
ont fait des volumes.
(T)
ASTROLOGlE,
f.
f.
AJlrologia.Cemor eH compofé
de
';'"P,
écoi/e,
&
de
A.'ro~,
difcours.
Ainfi
l'AJlrologic
feroit, en fuivant le fens Iittéral de ce terrne , la
con~
noiífance dtl ciel
&
des afhes:
&
c'eH auffi ce qu'il
{ignifioit dans Ion origine. C'eflla connoiífanee du
ciel
&
des aíl:res, qui failoit
l'AJlrologie
aneJenne :
lhais la fignificarion de ce terme a changé;
&
nous
appellons maintenant
AJlronomie
ce que les anciens
nommoient
Ajlrologie. Voye{
ASTRONOMIE.
L'AJlrologie
eft ['art de prédire les
éven~mens
fu–
turs par les alj)eéts, les poliuons,
&
les mfl.uences
des corps céleftes.
Yoye{
ASPliCT, INFLUENCE,
&c.
















