
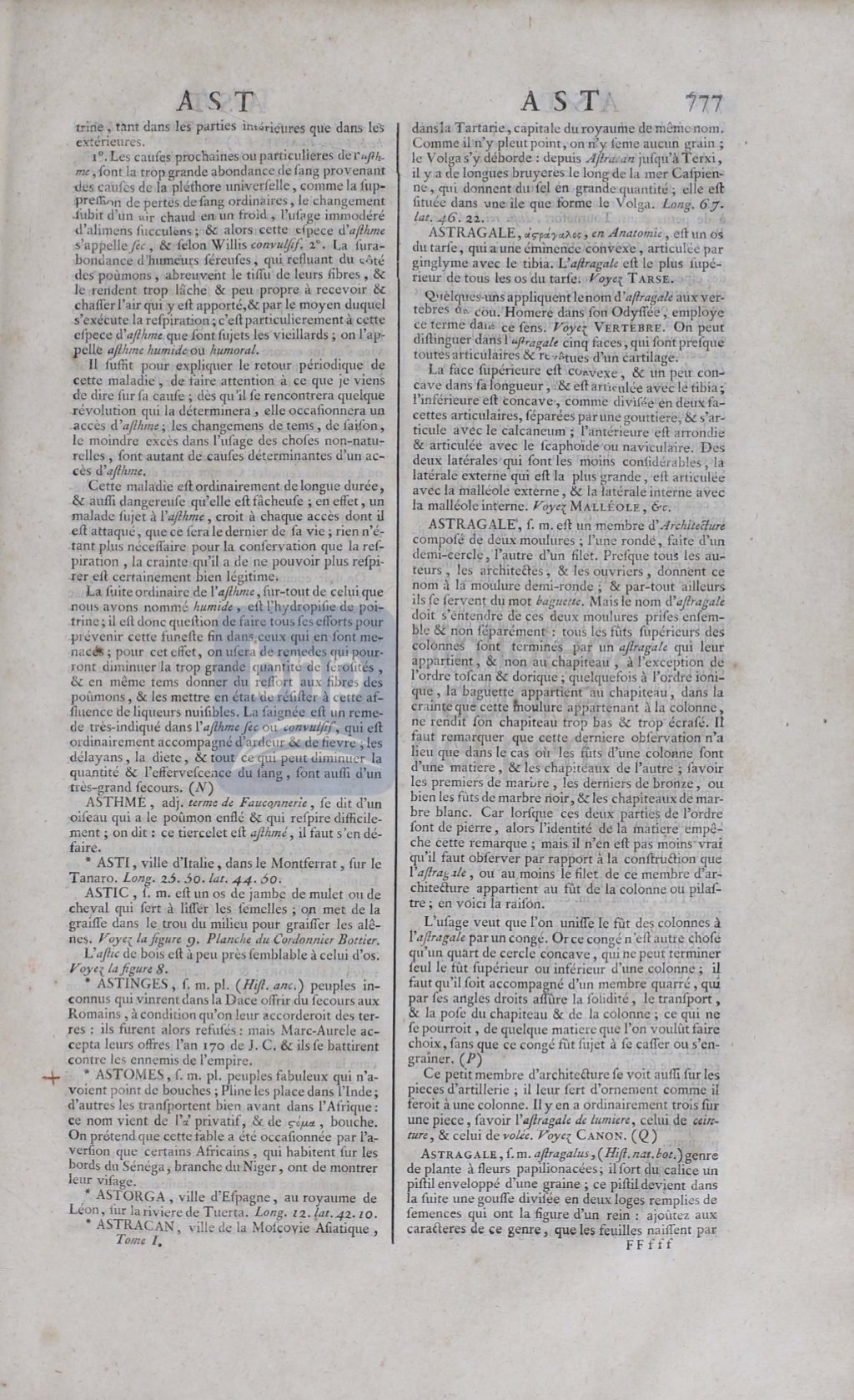
AST
trine, tant dans les parties int"rieures qtle dans les
extérieures.
10.
Les cauCes prochainesou particulieres de1"11!"
me,
font la trop arande abondance de{ang provenant
-des caufes de la"pléthore univerfelle, COlTIme la fup–
pre~V)\1
de pertes de fang
ordinaire~,
le
ch.angem:n~
.nlblt d un "ir chaud en un frold,
1
ufage IlTImodere
d'alimens {ucculens;
&
alors certe c(pece
d'ajlhme
s'appeUeflc, & {elon \Villis
con'Yuljif
1.' . La {ura–
bondance d 'humeLl\'s féreu{es, qui refluant du coté
des poumons, abreuvent le tiífu de leurs fibres ,
&
le rendent trop Htche
&
peu propre
a
recevoir
&
chalrer l'air qui yell: apporté,& par le moyen duquel
s'exécllte la refpiration; c'ell:partieulierement
a
cette
efpece d'
aflhme
que [ont fujets les vieillards; onl'ap–
pelle
tifi11lfle humiderou /tumoral.
11
fuffit pour expliqt1er. le retour périodique de
cette maladie, de faire attention
a
ce que je viens
de dire fur fa cauCe ; des qu'i·1{e rencontrera quelque
révolution qui la déterminera
>
elle occanonnera un
acc€!s d'
afllwze;
les changemens de tems, de faifon ,
le moindre exces dans I'u{age des chofes non-natu–
relles, {orítautant de cauCes déterminantes d'un ac–
ces
d'tifilllne.
Cette maladie eí!: ordinairement de longue durée,
&
<mili dangereu{e qu'elle eí!: facheu{e ; en effet, un
malade fujet
a
l'
tifihme
,
croit achaque acd!s dont
il
ell: attaqué, que ce {era le dernier de fa vie; rien n'é–
tant plus néce{faire pour la confervation que la re{–
piration , la crainte qu'il a de ne pouvoir plus refpi–
rer eí!: certainement bien légitime.
La {uite ordinaire de l'
aflhme,
fllT-tout de celui que
nous avons nommé
humide,
eft l:hydropifie de poi–
trine; il efi done quefiion de faire
10 US
{es efforts pour
prévenir ceue funefte fin dans.cellx (lui en {ont meT
nacé!; ; pour cet effet, on ufera de remedes (¡tÚ pour–
ront diminller la trop grande quantité de ferofités ,
&
en meme tems donner du relrort aux fibres des
poí'lmons,
&
les mettre en état de réfifier
a
cette af–
fluence tle liqueurs nuifibles. La faigné.e eft un reme–
de tres-indiqué dans l'
aflhme flc
ou
convuLff,
qui eft
ordinairement accompagné d'ardeur
&
de fievre ; les
délayans, la diete,
&
tout ce qui peut diminuer la
quantité
&
I'elferve{cence du fang, (ont auili d'un
n-es-grand fecours.
(N)
ASTHMÉ, adj.
termc de Faucq.nnerie,
{e dit d'un
oi{eau qui a le pOllmon enflé
&
qui refpire difficile–
ment; on dit : ce tiercelet efi
tifihrné,
il faut s'en dé–
fairé.
.. ASTI, ville d'ltalie, dans le Montferrat, {ur le
Tanaro.
Long.
2.-'.
-'o.
lato
4+
60.
ASTIC ,
e
m. eft un
05
de jambe de mulet on de
cheval qui (ert
a
lífI'ér les femelles ; on met de la
graíífe dans le tron du milieu pour graiífer les ale–
nes.
Voye{ lafigure
9.
Planche du Cordonnier Bouier.
L'
aflie
de bois efi
a
peu
prt!S
{emblable
a
celui d'os.
Voye{ lafigure
8.
.. ASTINGES,
f.
m. pI.
(HijI.
anc.)
peuples in–
connus qui vinrent dans la Dace offrir du {ecours aux
Romains ,
a
condition qu'on leur accorderoit des ter–
res: ils furent alors reftú<Ís: mais Marc-Aurele ac–
cepta leurs olfres ['an
170
de
J.
C.
&
ils {e battirent
contre les ennemis de l'empire.
+ ...
A TOMES,
f.
m. pI. peuples fabuleux qui n'a–
voíent point de bouches ; Pline les place dans l'lnde;
d'autresles tran{portent bien avant dans l'Afrique:
ce nom vient de 1',,' privatif,
&
de
,,¿p4,
bouche.
On prétend que cette fahle a été occanonnée par I'a–
verúon que certains Mricains, qui habitent {ur les
bords dl! Sénéga, branche du Niger , ont de montrer
lem vifage.
ji-
AS!ORGA , viUe d'Efpagne, au royaume de
Léon, fur la nviere de Tuerta.
Long.
l2..
lato
42..
lO.
• ASTRACAN, ville le la Mo[coyie Anatique ,
Tome
l.
AST
777
dansla Tartarje, capitale du royaume de menie nomo
Comme
ü
n'y pleut point, on ri'y feme aUClill grain ;
le Volga s'y déborde : deptÚs
.JIjlra,an
ju{qu'a Terxi,
ü
y a de longues bruyeres
le
long de la mer Cafpien–
ne,
qu
i
donnent du {el én grande quantité; elle ell:
fttuée dans une ile que forme le Volga.
Long.
6.7-
lato
46.
2.1..
ASTRAGALE,
d"p'¿?,,,¡.o~,
en Anatomi.
,
efiun os
du tarfe, qui a une éininel1ce cOÍlvexe, articulée par
ginglyrne avec le tibia. L'
aflragale
eílle plus fupé–
rieur de tollS les
05
du tar{e.
Voye{
T ARSf,.
Q.'lélques-uns appliquent lenom d
'a(lragale
aux ver–
tebres
Oto-
cou. Romere d<lns {on Odyifée , employe
ce t.erme dah. ce Censo
nje{
VERTEBRE. On peut
dlfimguel:
dan~
1
"jlra¡rale
cinq faces, qui font prefque
toutes'arhculaltes
&
rt;·'~tues
d'1.m éartilage.
La face fupérieure eft cv...vexe,
&
un péu COI1-
cave dahs fa longueur ,
.&
eft art'lculée avec le tibia;
l'ínférieure ell: concave·, comme divirée en deux fa–
cetres articulaires, féparées par une gouttlere,
&
s'ar–
ticule avec le calcaneum; l'antérieure efi arrondie
&
articuléé avee le fcaphoide ou naviculaire. Des
deux latérales qui {ont les moins conlidérables, la
latérale externe quí efi la plus grande, efi articulée
avec la malléole externe,
&
la latérale interne avec
la malléole interne.
Voye{
MALLÉOLE ,
&c.
ASTRAGALE', f. m. dI: un membre d'
Arehiteélure
compofé de deux moulures; l'une ronde, faite d'un
demi-eercle, l'autre d'un filet. Prefque tous les au–
teurs, les architeéles,
&
les ouvriers, donnent ce
nom
<\
la moülure demi-ronde;
&
par-tout ¡¡iUellrS
íls {e fervent du mot
baguette.
Mais le nom d'
aflragale
doit s'éntendre
de
ces deux moulures prifes enfem–
ble
&.
non {éparément : tous les fÍlts {upéneurs des
colonnes font ten1)inés par un
tifiragale
'luí leur
appartient,
&
non al! chapiteau,
a
I'exception de
l'ordre torcan
&
donc¡ue ; quelquefois
a
l'ordre ioni–
que, la baguette appartient au chapiteau, dans
la
crainte
~ue
cette moulure appartenant
a
la colbnne,
ne rendlt fon chapiteau trop bas
&
trop écra{é.
n
faut remarquer que cette derniere obfervation n'a
líeu que dans le cas
011
les fUts d'une coloRne {ont
d'une matiere,
&
les chapiteaux de l'autre ; {avoir
les premiers de mar!.re , les derniers de bronze, ou
bien les hits de marbre rioir,
&
les chapiteaux de mar–
bre blanc. Car lor{que ces deux parties de l'ordre
font de pierre, alors l'identité de la matiere empe–
che éette remarque; mais il n'en eíl pas moins'vrai
qu'il faut ob{erver par rapport
~
la conílrullion que!
l'aflra
l5.
t
/e,
Ol!
au moins le filet de ce membre
d'ar~
chiteéture appartient atl fUt de la colonne ou pilaf–
tre; en voici la raifon.
L\,fage veut que I'on uni/re le rot de$ colonnes
a
l'aflragale
panm congé. Orce congé n'eí!:autre <;hofe
qu'un 'luart de cercle concave, qtÚ he peut terminer
feul le fUt fupérieur ou inférieur d'une colonne;
il
faut qu'il {oit accompagné d'un membre quarré , qtd
par fes angles droits alrllre la folidité, le tral1fport ,
&
la pofe du chapiteau
&
de la colonne; ce qui ne
{e pourroit , de quelque matiere que I'on voulllt faire
choix, fans que ce congé frlt {ujet
a
{e calrer ou s'en–
grainer.
(P)
Ce petit membre d'architefutre fe voit auili fur les
pieces d'artillerie ; illeur (ert d'ornement comme il
feroit
a
tme colonne. Il y en a ordinairement troís filr
une piece, favoir l'
aflragaü de lumiere,
celui de
ceirr–
ture,
&
celui de
volie. Voye{
CANON.
(Q)
ASTRAGALI!, f. m.
aflragalus,
(HijI.
nato bot.)
genre
de plante a fleurs papilionacées;
il{ort
dt~
calice un
pi1l:il enveloppé d'une graine ; ce piftildevient dans
la {lúee tme gou{[e divifée en deux
loges
remplies de
{emences qtÚ ont la figure d'un rein: ajolltez attx;
caraéleres de ce genre, que les feuilles naiífent par
FF fH
















