
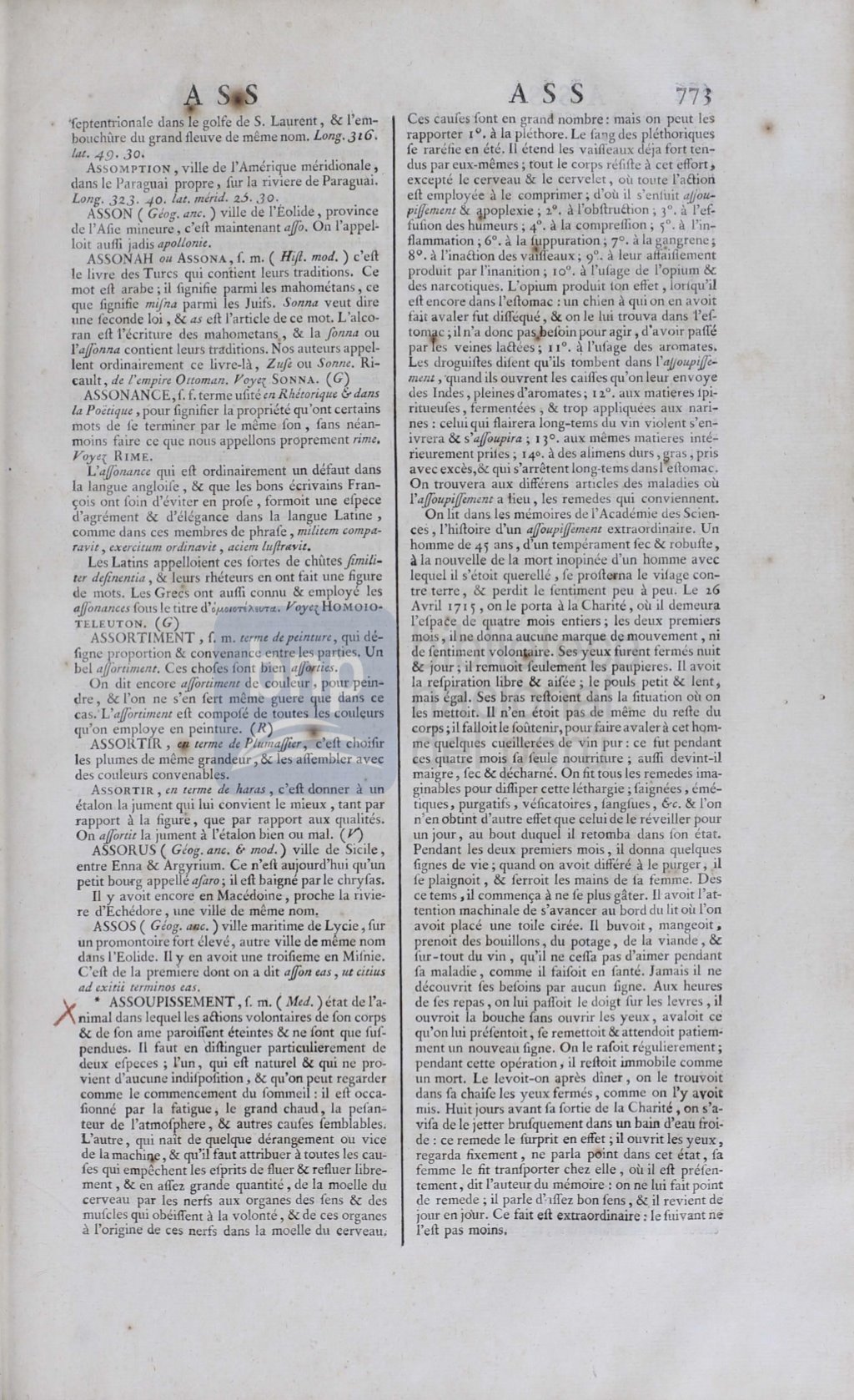
A S S
'[eptentrionale dans le golfe de S. Laurent, & l'em–
bouchf¡re du grand fleuve de meme nomo
Long.
.3
z
G.
lat.
49.
.30,
ASSOMPTlON , ville de I'Amérique méridionale,
dans le Para<1uai propre, [ur la riviere de Paraguai.
Long.
.323.40.
lato mérid.
2".
.30.
ASSON
(
G.!og. anc.
)
ville de l'Éolide, province
de l'Afie mineure , c'efr maintenant
affo.
On l'appel–
loit auffi jadis
apollonie.
ASSONAH
0/4
ASSONA,
f.
m. (
Hifl.
modo
)
c'efr
le livre des Turcs qui conhent leurs traditions. Ce
mot efr arabe;
iI
fignilie parmi les mahométans , ce
que úgnifie
mifna
parmi les Juifs.
Sonna
veut dire
une {econde loi , &
as
efr I'article de ce moto L 'alco–
ran efr 'l'écriture des mahometans ,
&
la
fonna
ou
l'affonna
contient leurs traditions. Nos auteurs appel–
lent ordinairement ce livre-Ia,
Zufo
ou
Sonne.
Ri–
cault,
de rempíre Ottoman. Poye{
SONNA.
(G)
ASSONANCE,f. f. terme ufité
m
Rf'¿torique &dans
la Poetique ,
pour úgnifier la propriété qu'ont certains
mots de
ü:
terminer par le meme fon, fans néan–
moins faire ce que nous appellons prOprement
rime.
Voye{
RIME.
L'affonance
qui eí!: ordinairement un défaut dans
la langue angloife , & que les bons écrivains Fran–
~ois
ont foin d'éviter en profe, formoit une efpece
d'agrément & d'élégance dans la langue Latine,
comme dans ces membres de phrafe ,
milítem compa–
ravit, exercitum ordinavit, aciem luflrl1.vit.
LesLatins appelloient ces fortes de chilteS
fimili–
tlr dejinemia,
&
leurs rhéteurs en ont fait une lipure
de mots. Les Grecs ont auffi COTUm
&
employe les
affonances
fous le titre
d'0I"0'O.,JAW""'.
Voye\.
HOMOIO–
TELEUTON.
(G)
ASSORTIMENT , {. m.
mme de peimure,
qui dé–
figne proportion
&
convenance entre les parties. Un
be!
affortimem.
Ces chofes font bien
afforties.
On dit encore
affortimwt
de couleur, pour pein–
dre, & I'on ne s'en (ert meme guere que dans ce
caso L'
affortiment
efr compofé de toutes les couleurs
qu'on employe en peinture.
(R)
ASSORTIR,
w
terme de PLumajJier,
c'efr choi[1T
les plumes de meme grandeur ,& les aíl'embler avee
des couleurs convenables.
ASSORTIR,
en terme de haras,
c'efr donner a un
étalon la jument qui lui convient le mieux , tant par
rapport a la figure, que par rapport aux qualités.
On
affortit
la jument
a
l'étalon bien ou mal.
(P)
ASSORUS (
Géog. ane.
&
mod.)
ville de Sicile,
entre Enna & Argyrium. Ce n'eíl: aujourd'hui qu'tm
petit bou('g appelle
aJaro;
iI
efr baigne par le chryfas.
II y avoit encore en Macédoine , proche la rivie–
re d'Echédore, une ville de m&me nom,
ASSOS
(
Géog. aac.
)
ville maritime de Lycie ; (ur
un promontoire fort élevé, autre ville de meme nom
dans l'Eolide.
n
y en avoit une troifieme en Mifnie.
C'eí!: de la premiere dont on a dit
affon eas, ut citius
ad exitii urminos eas.
'v
*
ASSOUPISSEMENT, f. m.
é
Med.
)
état de l'a–
/\ rumal dans lequelles aétions volontaires de fon corps
& de (on ame paroiíl'ent éteintes & ne {ont que fu(–
pendues. I1 faut en 'diíl:inguer particulierement de
deux e(peces ; ['un, c¡ui eí!: naturel &
qui
ne pro–
vient d'aucune indi{pofition, & qu'on peut regarder
comme le commencement du (ommeil : il efr occa–
{¡onné par la fangue, le grand chaud, la pe(an–
teur de I'atmofphere, & autres cauCes (emblables.
L'autre, qui mut de c¡uelc¡ue dérangement ou vice
de la machille,
&
qu'il faut attribuer a toures
les
cau–
{es qui emp&chent les e(prits de fluer & refluer libre–
ment,
&
en aífez grande c¡uantité, de la moelle du
cerveau par les nerfs aux organes des {ens & des
mu(cles qui obéiffent
a
la volonté, & de ces organes
a
l'origine de ces nerfs dans la moelle du cerveaUi
A S S
773
Ces cauCes (ont en grand nombre: mais on peut les
rapporter 10.
a
la pléthore. Le fa '1g des pléthoriques
(e raréfie en été. II étend les vailI'eaux déja fort ten–
dus par eux-memes ; mut le corps réfiíl:e a cet effort,
excepté le cerveau
&
le cerve!et, Oll toute l'aétion
eí!: employée
¡\
le comprimer; d'oll
il
s'enlllit
aJjou–
piffement
&
~poplexie;
zO. a I'obíl:ruétion ;
3°.
a
I'ef–
fuúon des humeurs;
4°.
a la compreffion;
)0.
a
l'in–
flammation; 6°.
a
la fuppuration; 7°.
a
la gangrene;
8
0 .
a
I'inaétion des vaill'eaux;
9~'
a
leur affáiílement
produit par I'inanition; 100.
a
l'ufage de l'opium &
des narcotiques. L'opium produit ton effet , 10rÚju'il
efr encore dans l'efromac : un chien a qui on en avoit
fait avaler fut dilI'équé,
&
on le lui uouva dans 'l'e(–
tom¡¡c; i1n'a donc pas be(oin pour agir, d'avoir paffé
par les veines laétées;
11
0 .
~
I'u(age des arOmates.
Les droguií!:es difent c¡u'i1s tombent dans
l'aJJoupiffe–
mem,
'c{lland ils ouvrent les caiíl'es qu'on leur envoye
des lndes, pleines d'aromates;
IZO.
aux matieres fpi–
ritueu[es, fermentées ,
&
trop appliquées aux naTi–
nes : celui qui flairera long-tems du vin violent s'en–
ivrera
&
s'affoupíra
;
13
O.
aux m&mes matieres inté–
rielITement pri/cs;
'4
0 •
a des alimens durs , gras, pris
avec exces,& qui s'arr&tent long-tems dansl eí!:omac.
On trouvera aux différens ameles des maladies OU
l'affoupiffement
a Iiell, les remedes qui conviennent.
On lit dans les mémoires de l'Académie des Scien–
ces, l'hiíl:oire d'un
affoupiffemem
exuaordinaire. Un
homme de 45 ans, d'un tempérament (ec & robufre,
él
la nouvelle de la mort inopinée d'un homme avec
lequel il s'étoit querellé, fe profrema le vilage con–
tre terre, & perdit le (entiment peu a peu. Le z6
Avril
171
5 , on le porta a la Charité , oll il demeura
l'efpace de quatre mois entiers; les deux premiers
mois,
il
ne donna aucune marque de mouvement ,
ni
de {entiment volontaire. Ses yeux furent fermés nuit
& jour; il remuoit (eulement les paupieres. II avoit
la re{piration libre & aifée ; le pouls petit & lent
j
mais égal. Ses bras refroient dans la fituanon ou on
les mettoit.
n
n'en étoit pas de meme du reíl:e du
corps; il falloitle (oittenir, pourfaire avaler
a
cet hom–
me c¡uelques cueillerées de vin pur: ce fut pendant
ces qnatre mois fa {eule nourrinlre ; ouffi devint-il
maigre, (ec & décharné. On lit tous les remedes ima–
ginables pour diffiper cette léthargie ; [aignées, émé–
tiques, purgatifs, véúcatoires, fang(ues,
&e.
&
I'on
n'en obtint d'autre effet que celui de le réveiller
pour
un jour, au bout duquel il retomba dans fon état.
Pendant les deux premiers mois, il donna quelques
fignes de vie; quand on avoit différé a le pllrger, iI
fe plaignoit, & ferroit les mains de [a femme. Des
ce tems ,
iI
commen<;a a ne (e plus gatero
n
avoit I'at–
tention machinale de s'avancer au bord duIit olll'on
avoit placé une toile cirée. Il buvoit, mangeoit,
prenoit des bouillons , du potage, de la viande, &
ÚIT-tout du vin, qu'il ne ceíl'a pas d'airner pendant
{a maladie , comme il faifoit en Canté.
J
amais
iI
ne
découvrit fes be(oins par allcun figne. Aux hellres
de (es repas, on lui paffoit le doigt [ur les levres , iI
ollvroit la bouche (ans Ollvrir les yeux, avaloit ce
qu'on lui pré(entoit, {e remettoit
&
attendoit patiem–
ment un nouveau figne. On le ra{oit régulierement;
pendant cette opération,
iI
refroit irnmobile comme
un mort. Le levoit-on apres dlner, on le trouvoit
dans fa chaife les yeux fermés , comme on I'yavoit
mis. Huit jours avant {a (ortie de la Charité , on s'a–
vira de le jetter bmfc¡uement dans un bain d'eau froi–
de : ce remede le [urprit en effet ; iI ouvrit les yeux
>
regarda fixement, ne parla point dans cet état, (a
femme
le
lit tran{porter chez elle, Olt il eí!: pré(en–
tement, dit l'auteur du mémoire.: on ne lui fait point
de remede;
iI
parle d'-líl'ez bon fens , & il revient de
jOlIT en jo·ur. Ce fait efr extraordinaire : le (uivant ne
l'eíl: pas moins.
















