
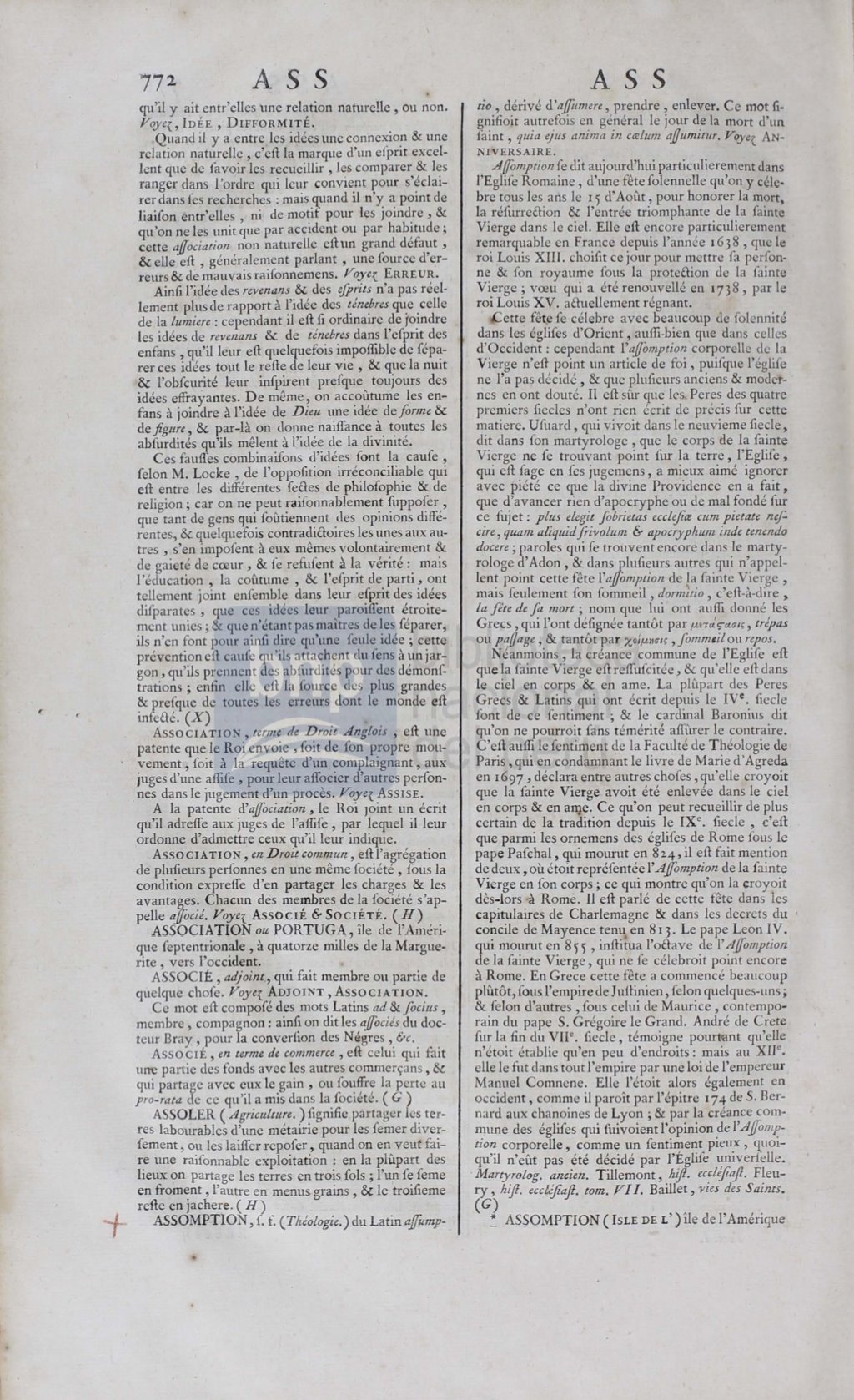
A S S
qu'il y aít entr'elles une re!atíon nature!le, ou non.
Vqye{,
IDÉE , DIFFORMITÉ.
QlIand il ya entre les ídées une connexion
&
une
relarion naturellc , c'eíl: la marque d'un eíprit excel–
Ient que de favoir les recueillir , les comparer
&
les
l'anger dans l'orclre 'luí leur convient pour s'édai–
rer dans fes recherches ; mais quand il n'y a point de
liaifon entr'elles ni de motif pour les joindre,
&
qn'on ne les unit que par accident ou par hab!tude;
cette
aiJociation
non nattlrelle eíl:un grand defaut ,
& elle ell: , généralement parlant , une fOLUce d'er–
reurs &de mauvais raifonnemens.
Voye{
ERREUR.
Ainli l'idée des
revenans
& des
efprits
n'a pas réel–
Iement plus de rapport
a
l'idée des
timbres
que celle
de la
lumiere
;
cependant il eíl:
Ii
ordinaire de roinclre
les idées de
revenans
&
de
ténebres
dans l'efprit des
enfans , qu'illeur eíl: quelquefois i,?poffible de
{ép~rer
ces
idées tout le l'eíl:e de leur Vle , & que la mut
& l'ob{curité leur infpirent prefque toujours des
idées efFrayantes. De meme , on aCCOllttlme les en–
fans
a
joindre
a
l'idée de
Dieu
une idée de
forme
&
de
figure,
& par-la on donne naiífance a toutes les
abfurdités qu'ils melent
a
l'idée de la divinité.
Ces fauifes combinaifons d'idées {ont la caufe,
{elon M. Locke , de l'oppolition irréconciliable qui
eíl: entre les difFérentes {eéles de philo{ophie
&
de
religion; car on ne peut raifonnablement filppofer ,
que tant de gens qlli foutlennent des opinions difFé–
rentes, & quelquefois contradiéloires les unes aux au–
tres, s'en impofent a eux memes volontairement
&
de gaieté de creur ,
&
fe refufent
a
la vérité; mais
!'édllcation , la coutnme ,
&
I'efprit de partl, ont
tellement joint en{emble dans leur efprit des idées
difparates, que ces idées leur paroiífent étroite–
ment unies;
&
que n'étant pasmaltres de les féparer,
ils n'en font ponr ainli dire qu'une feule idée ; cette
prévention eíl: caufe qu'ils attachent du {ens a un jar–
gon, qu'ils prennent des ab{urdités pour des démonf–
trations ; enfin elle eíl: la (ource des plus grandes
&
prefque de toutes les erreurs dont le monde eíl:
infeélé.
eX)
ASSOCIATlON
,terme de Droit Angloís
,
ell: une
patente que le Roi envoie , foit de fon propre mou–
vement, foit a la requete d'un complaignant , aux
jllges d'une affife , pour leur aífocier d'autres perfon–
nes dans le jugement d'un proceso
Voye{
ASSISE.
A la patente d'
affociation
,
le Roi Joint un écrit
qu'il adreífe aux juges de l'affife, par leqllel illeur
ordonne d'aclmettre ceux qu'illeur indique.
AssoclATION,
en Droit eommun,
ell:
l'a~régation
de plufieurs perfonnes en une meme {ociéte , fous la
condition expreífe d'en partager les charges
&
les
avanta&;s. Chacun des membres de la (ociété s'ap–
pelle
aJlocié. VoyC{
ASSOCIÉ
&
SOCIÉTÉ.
eH)
ASSOCIATlON
or¿
PORTUGA, ile de l'Améri–
que feptentrionale , a quatorze milles de la Margue–
rite, vers l'occident.
ASSOCIÉ ,
adjoint,
qui fait membre ou partie de
quelque chofe.
Voye{
ADJOINT, ASSOCIATION.
Ce mot ell: compo{é des mots Latins
ad
&
Jocius ,
membre, compagnon : ainli on dit les
affociis
du doc–
teur Bray, pour la converfion des Négres,
&e.
ASSOCIÉ,
en terme de commerce
, etl celui qui fuit
une partie des foncls avec les autres commer<;:ans , &
qtlÍ partage avec eux le gain , ou (oufFre la perte au
pro-rata
de ce qu'il a mis dans la fociété.
e
G)
ASSOLER
e
AgricrdLUre.
)
lignifie partager les ter–
res labourables d'une métairie pour les femer diver–
{ement, ou les laiífer repo{er , quand on en veut fai–
re une raifonnable exploitation : en la plupart des
lieux on partage les terres en trois {ols ; l'un fe (eme
en froment , I'autre en menus grains , & le troiúeme
reíl:e en jachere.
(H)
ASSOMPTlON, (,
f.
(TMologie.)
du Latín
affump-
A S S
tio
,
dérivé d'
affumere
,
prenclre , enlever. Ce mot
Ii–
gnifioit autrefois cn général le jour de la mort d'un
faint ,
quía o/us anima in ca;[urTt ajumitur. V<rye{
AN–
NIVERSAIRE.
Affomption
fe dit aujourd'hui particulierement dans
l'Eglife Romaine, d'une fete folennelle qtl'on
y
céle–
bre tous les ans le 15 d'Ao(h, pour honorer la mort,
la réfurreétion & l'entrée triomphante de la fainte
Vierge dans le ciel. Elle eíl: encore particulierement
remarqtlable en France depuis I'année 1638, qtlC
1<:
roi Louis XIII. choilit ce jour pour mettre {a per{on–
ne
&
fon royaume {ous la proteétion de la [ainte
Vierge ; vreu qui a été renouvellé en 1738, par le
roi Louis XV. aétuellement régnant.
.eette fete fe célebre avec beaucoup de {olenníté
dans les églifes d'Orient, auffi-bien que dans celles
d'Occident ; cependant
l'
ajomption
corporelle de la
Vierge n'eít point un article de foi, pui{que I'églife
ne I'a pas décidé ,
&
que plulieurs anciens
&
moder–
nes en ont domé. Il eíl: SlU
~ue
les.Peres des quatre
premiers ficeles n'om rien ecrit de précis fur cette
matiere. Ufuard, qui vivoit dans le neuvieme fieele,
dit dans fon martyrologe ,que le corps de la {ainte
Vierge ne fe trouvant point íiu la terre , I'Eglife,
qui ell: {age en {es jugemens , a mieux aimé ignorer
avec piété ce que la divine Provídence en a fait,
que d'avancer rien d'apocryphe ou de mal fondé
{UT
ce {ujet;
plus elegít Jobrietas ecclefire wm pietate mJ:"
cire, quam aliquídfríllolum
&
apocryphum inde tenendo
doeere
;
paroles qui {e trouvent encore dans le marty–
rologe d'Adon ,
&
dans plufieurs autrcs qui n'appel–
lent point cette fete
l'affomption
de !a {ainte Vierge ,
mais {eulement ron {ommeil ,
dormitio
,
c'ell:-a-dire ,
la fite de
fa
mort
;
nom que lui ont auffi donné les
Grecs ,qui l'ont déúgnée tantot par
P.fT<l.<;"'Uil~,
tripas
ou
pajage
,
&
tantot par
XO;P.",71~
, fommlíl
ou
repos.
Néanmoins, la créance commune de l'Egli{e efr
que la {ainte Vierge ell:reífu{cirée, & qu'elle ell: dans
le cie! en corps & en ame. La pltlpart des Peres
Grecs
&
Latins qui ont écrit depuis le
Ive.
{jeele
{ont de ce {entiment ;
&
le cardinal Baronius dit
qtl'on ne pourroit fans témérité affiher le cOl1traire.
C'ell: auffi le{entiment de la Faculté de Théologie de
París, qui en condamnant le livre de Marie d'Agreda
en 1697, déelara entre autres cho{es ,c¡u'elle croyoit
qtle la {ainte Vierge avoit été enlevee dans le ciel
en corps
&
en all1e. Ce c¡u'on peut recueillir de plus
certain de la tradition depuis le IX". {jeele , c'efr
que parmi les ornemens des égli{es de Rome fous le
pape Pa{chal, qui mourut en 824,
il
ell: fait mention
de deux, all étoit repré{entée l'
Affomption
de la {ainte
Vierge en ron corps ; ce qui montre qu'on la croyoit
des-Iors
o¡\
Rome. II efr parlé de cette rete dans les
eapittllaires de Charlemagne
&
dans les decrets du .
eoncile de Mayence tenq en 813. Le pape Leon IV.
qui mourut en 85
í ,
inilitua I'oélave de l'
Affomption
de la {ainte Vierge, qtlÍ ne {e célcbroit point encore
a
Rome. En Grece cette fere a commencé beJucoup
plutot,{ous l'empirede
J
uitinien, {elon quelqtles-uns;
&
felon d'autres , fous celui de Mamice , contempo–
rain du pape S. Grégoire le Grand. Anclré de Crete
{ur la fin du VII". úeele, témoigne pom1'ant qu'elle
n'étoit établie ql1'en peu d'enclroits; mais au XII".
elle le filt dans tout l'empire par une loi de l'empereur
Manuel Comnene. Elle l'étoit alors également en
oecident, comme il parolt par I'épitre 174 de S. Ber–
nard
3UX
chanoines de Lyon ;
&
par la créance com–
mune des églifes qui fuivoieflt l'opinion
del'A./fomp–
don
corporelle, comme un {entiment pieux , quoi–
qu'il n'eut pas été décidé par l'Églife univerlelle.
Martyrolog. aneien.
Tillemont,
hijl. eecléfuzfl.
Fleu–
ry,
hijl. eccliJiaft. tomo VI
l.
Baillet,
lIies des Sain/s.
(G)
~
ASSOMPTION (ISLE DE L' ) lle de l'Améríc¡ue
















