
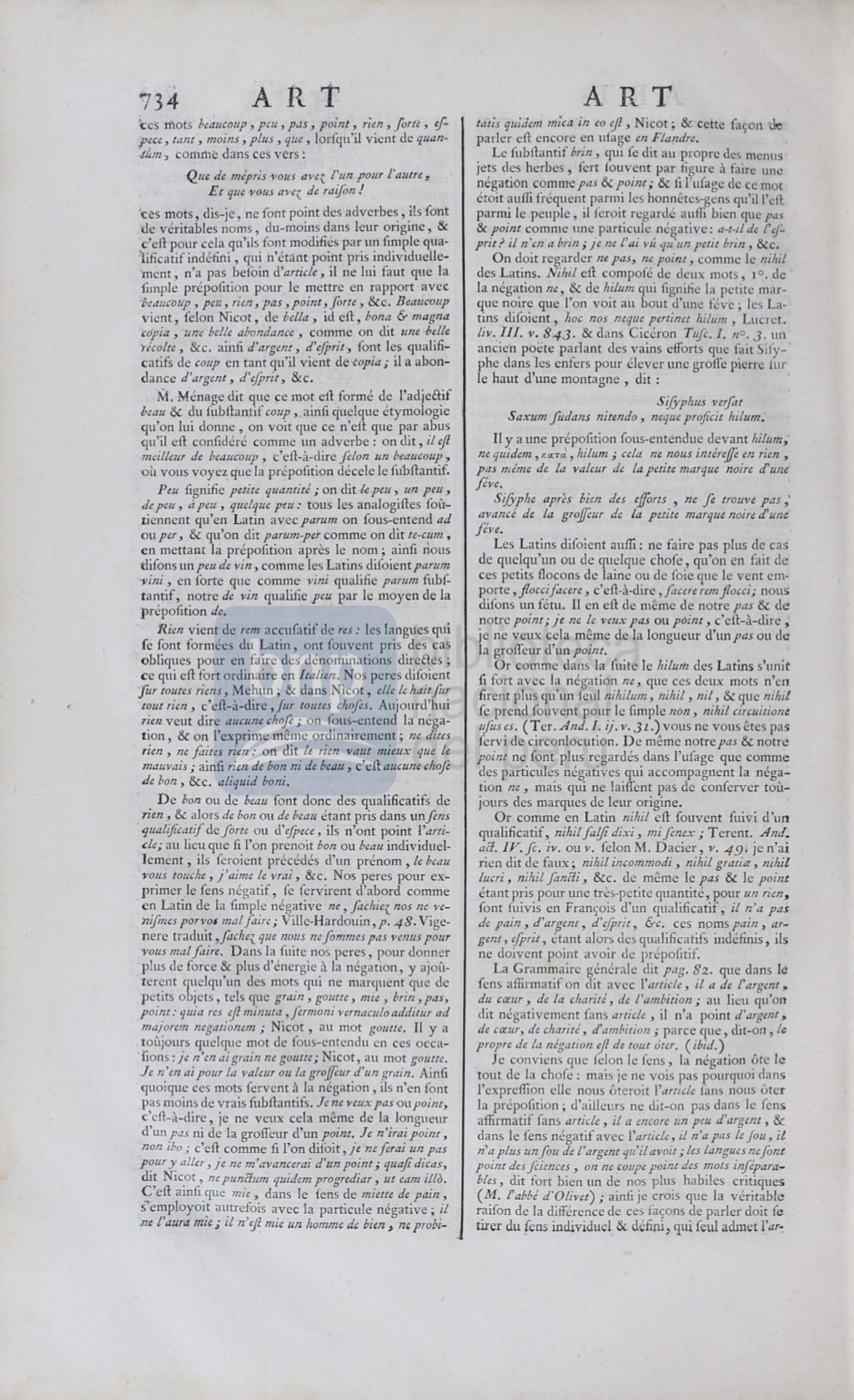
73 4
ART
'ces mots
heaucoup, peu
,
p,ts
,
point
,
r¡en, fora,
if–
)Jece, tant, moins, plus, que,
lorfqu'il vient de
quan–
.J"m~
comItle dans ces vers
~
-Que de mépris vous ave{ l'un pour ['autre,
Et que vous ave{ de raifon!
'ces mots, dis-je, ne font po!nt des adverbes., .11s{Ol1t
de véritables noms,
dll-mom~
dans le ur ongme,
&
c'efi pour cela ql1'ils font modinés par tm fimple qua–
llficatif indéliñi , qui h'étant point pris individuelle–
'mcnt, n'a pas beloin
d'anicle ,
il ne lui faut que la
fimple prépofition pour le mettre en rapport avec
'beallcoltp
,
pea, rien, pas ,point, fone
,
&c.
Beattcoup
vient, felon Nicot, de
bella,
id efi,
bona
&
magna
c0l'iít ,
UITe
bzlle abondance,
comme on dit
une
b~lle
'rtcolte, &c.
ainfi
d'argent , d'eJPrit.,
font les quahfi–
catifs de
coup
en tant qu'il vient
de'topia;
il
a abon–
dance
d'argent , d'eJPrit,
&c.
M.
Ménage~it
que ce mot eíl: formé de l'adjefuf
heau
& du fubíl:antif
coup
,
ainfi quelque étymolQgie
qu'on lui donne, on voit que ce n'eít que par abus
<ju'il efi confidéré comme un adverbe : on dit,
il
ifi
meilleur de beauC1Jltp,
c'eíl:-a-dire
filon un beaucoup ,
011
vous voyez que la prépofition décele le ftibítantif.
Peu
fignifie
petiu quantité ;
on dit
le
pert) un. pUl,
de.peu,
a
pe¡¿, <¡uelque pert:
tous les analogiíl:es fou–
riennent qu'en Latin avec
parum
on fous-entend
ad
ou
pu,
& qu'on dit
parum-per
comme on dit
te-cum,
en mettant la prépofition apres le nom; ainfi nOlls
tlifons un
pw de vin,
comme les Latins difoient
parum
.."ini,
en forte que comme
vini
qlJalifie
parum
fubf–
tantíf, notre
de vin
qualifie
peu
par le moyen de la
prépofition
de.
Rien
vient de
rem
accufatií' de
res .'
les langues {{ui
fe font formées du Latín, ont fouvent pris des caS
obliCI1les pour en. fa!re des
dé~ominatións di¡:e~es
;
ce qui eíl: fort ordmaue en
ltalten.
Nos peres d¡fOlent
fur toutes riens,
Mehun; & dans Nicot,
elle le haitfur
tout rien,
c'eíl:-a-dire
,fur tolttes chofis.
Aujourd'hui
rien
veut dire
aucune chofi;
on fous-entend la néga–
tion, & on l'exprime meme ordinairement ;
ne dites
rien, ne foites rien:
on dit
le
rien
vaut mieux que le
mauvais ;
ainfi
rien de bon ni de beau,
c'eíl:
aucune chofe
de bon,
&c.
aliquid boni.
D e
hon
ou de
beau
font donc des CI1lalificatifs de
rien,
& alors
de bOIl
ou
de beau
étant pris dans un
fins
éjualificatifdeforce
ou
d'eJPece,
ils n'ont point
l'arti–
ele;
au lieu que fi l'on prenoit
ban
ou
beau
individuel–
l ement, ils feroient précédés d'un prénom,
le
beau
YOUS touche, j'aime le vrai ,
&c. Nos peres pour ex–
primer le fens négatif, fe fervirent d'abord comme
en Latín de la fimple négative
ne, fac!u.e{ nos ne ve–
nijines porvol malfaire ;
ViLle-Hardouin,
p.
48.Vige–
nere traduit
,fache{ que nOllS nefommes pas venus pour
youS malfaire.
D ans la (uite nos peres, pour donner
plus de force
&
plus d'énergie
a
la négation, yajoll-
1:erent CI1lelqll'un des mots qui ne marqllent que ele
petits objets, tels que
grain, gOlltle , mie, brin ,pas,
p oint: quia res
ifi
minuta ,firmoni yernaculoadditllr ad
fllajorem negationem;
Nicot, au mot
gOlllle.
Il y a
tOí'ljOLUS quelque mot de fOlls-entendll en ces occa–
Jions
:je n'enaigrain ne goutte;
Nicot, au mot
gOlllte.
Je n'm aipour la yaleur ou la groffiur d'un grain.
Ainfi
CI1loique ces mots fervent
tI
la négation , ils n'en font
pas moins de vrais fub!l:antifS.
le
ne
veuxpas
ou
poim,
c'eíl:-a-dire, je ne veux cela meme de la longueur
el'un
pas
ni de la groífeur el'un
poim.
le
n'irai poiru,
non ibo;
c'eíl: comme
Ji
1'0n difoit
,je ne ferai un pas
pour
y
aller ,je ne m'avancerai d'un poillt; qwifidicas,
dit Nicot,
ne pUnallm quidem progrediar, ut eanl illo.
C'efl: ainfi. CI1le
mie ,
elans le fens de
mime de pain,
s"employoit autrefois avec la particule négative ;
il
lle
tanTa mie ; il
12'
eJl
mie
un
/LOmme de bim , ne probi-
A
p,-
T
llitis 911iami mica in eo
ejl,
Nicot;
&
eehe fas:ol1
'de
parler eíl: encore en ufage
en
Flandr~.
Le fubíl:antif
brin,
qui fe dit au propre des menus
jets des herbes, fert louvent par figure a faire une
négation comme
pas
&
point;
&
fi l'ufage de ce mot
étoit auffi fréCI1lent parmi les honnetes-gens qu'il l'eil:
parrni le peuple,
iJ.
feroit regardé auffi bien que
pas
&point
comme une particule négative:
a-t-Lide fe¡:
prit? il n'en a brin; je ne
t'
ai vú éju'lln pelit brin,
&c.
On doit regarder
ne pas, ne point,
comme le
nihil
des Latins.
Ni"il
eíl: compofé de deux mots,
l0.
de
la négatíon
ne,
& de
hilum
qui fignifie la petite mar–
que noire que l'on voit au bout d'une féve; les La–
tins difoient,
hoc nos neque pertina hilum
,
Lucret.
liv.
UI.
Y.
843.
&
aans Cicéron
TuJc. l. nO.
3. un
anéien poete parlant des vains efforts que fait Sify–
phe dans les enfers pour élever une groífe pierre fur
le haut d'une montagne , dit :
Si.JYp/ms verfat
Saxum fudans nitendo, neque projicit "ilum.
Il
y a une prépofition fous-entendue devant
hilt"tz;
ne quidem
,
"-ct.Td. ,
/úlum; cela ne no/IS intéreffi
m
rien ,
pas mime de la yaleur de la
pet.i.temarque noire d'UIz&
five.
Si.JYp"e apres bien des ejforts
,
ne
fi trouve pas;
avancé de la groffiur de la puite marque noire d'une
five.
Les Latins difoient auffi : ne faire pas plus de cas
de quelqu'un ou de CI1lelCI1le chofe, qu'on en fait de
ces petits flocons de laine ou de foie que le vent em–
porte ,
floccifacere
,
c'efl:-a-dire
,faceleremflocci;
nous
difons un fétu.
I1
en eíl: de meme de notre
pas
& de
notre
poim; je ne
le
veux pas
ou
point ,
c'eít-a-dire,
je ne veux cela meme de la longueur d'un
pas
ou de
la groífeur d'un
point.
Or comme dans la fuite le
/ti/mil
des Latins s'unit
fi
fort avec la négation
ne,
que ces deux mots n'en
firent plus c¡n'un
leulnihilum, ni"il , nil,
& que
nihil
fe prend fouvent pour le fmlple
IZan,
nihil circuitio1le
ufuses.
(Ter.
And. l.
ij.
Y.
3
lo)
vous ne vous etes pas
fervi de circonlocution. D e meme notre
pas
& notre
point
ne font plus regardés dans l'lIfage que comme
des particules négatives CI1Ii accompagnent la néga–
tion
ne ,
mais qui ne laiífent pas de conferver tOí'I–
jours eles marques de leur origine.
Or comme en Latin
nihil
efl: fouvent fuivi d'un
qllalificatif,
nihilfo!Ji dixi, mifinex
;
Terent.
A nd.
aa.
I V,
Jc. iy.
ou
v.
felon M. D acicr,
v.
49. je n'ai
rien dit de faux ;
nihil incommodi, nihil gratia, ni/,il
lucri, nihil fallai ,
&c. de meme le
pas
& le
poillt
étant pris pour tme tres-petite quantíté, pour
un ríen,
font Úlivis en Frans:ois d'un qualificatíf,
il n'a pas
de pain, d'argent, d'eJPrit, &c.
ces nDms
pain, ar–
gent, eJPrit,
étant alors des qualificatifs indéfinis , ils
ne doivent point avoir de pr pofitíf.
La Grammaire générale dit
pago
82. que dans le
fens affi¡matif on dit avee l'
(miele , il a de fargent
~
du cceur, de la e/larid,
d~
l'ambition;
au lieu qll'on
dir négativement fans
anicle
,
il n'a point
d'argmt
~
de ca:ur, de e/larid, d'ambition;
paree que, dit-on,
le
propre de la Ilégation e(l de tout óter. ( ibid.)
J
e conviens que relon le fens, la négation ?te le
tout de la chofe: maís je ne vois pas pourquOl dans
l'expreffion elle nous oteroit
l'aflicle
lans nous oter
la prépofition; d'ailleurs oe dir-on pas dans le fens
affirmatif fans
aflicle, il a encore un peu d'argent,
&
dans le fens négatifavec
l'articü, il n'a pflS
le
fou, il
n' apÜIS unfou
de
l'argem qu'ilavoit; les languesncfont
point des¡eiences, Oll ne coupe point des mots infépara–
bies,
dit fort bien un de nos plus habiles cririques
(M.
l'
abbt d'Oliyet)
;
ain1i je crois que la véritable
raifon de la différence de ces fas:ons de parler doir fe
tirer du [eos individuel & défini, qui feul admet l'
aro
















