
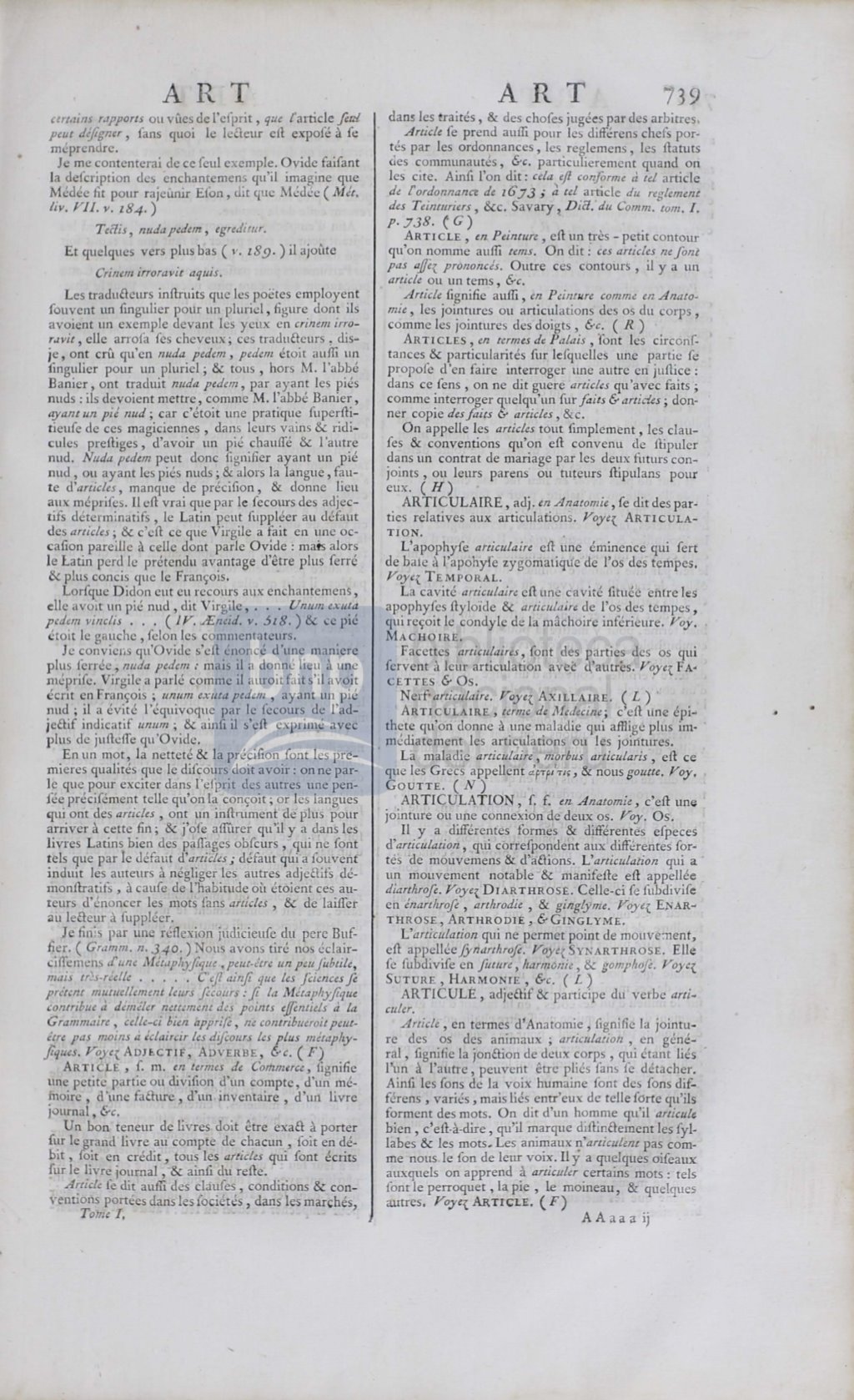
ART
art,tjns
r.Jpports
ou vues de l'cípnt ,
que
[amele
flal
peut d<fgmr,
fans quoi le I.::l.eur en expofé
a
fe
m';prendrc.
Je mc cOnlenterai de ce feul exemple. Ovide faifant
la defcription des enchantemens qu'il
ima~ine
que
Médée lit pour rajeunir Efon,
dI[ (
uc M¿dcc
(M/c.
liv.
VII.
v.
l84.)
Teflis, nudapdem, egrtdu/lr.
Et quelques vers plus bas (
l'.
z89'
)
a ajoÍite
CrilU11I irroravit a'luis.
Les tradu8eurs iníl:ruits quc les poetes employent
fouvent un fingulier pOllr un pluriel , figurc dont ils
avoient un exemple dcvant les yCl ' en
crine11l irro–
rolvit,
elle arrora fes cheveux; es tradu8eurs ,
dis–
je , ont cro qu'en
mula
pedem , pedem
toir auffi un
fingulier pour un pluriel; & tous , hors
M.
I'abbé
Banier, ont traduit
nuda pedun,
par ayam les piés
nuds ; ils devoient mettre, comme M.I'abbé Banier,
ayant un pié nud
;
car c'étoit une prariqlle fuperfii–
tieufc de ces magiciennes , dam leurs vains & ridi–
cules prefiiges, d'avoir un pié chau!l'é & I'alltre
nudo
Nudo pedem
peut donc fignifier ayant un pié
nud, ou ayant les piés nuds;
&
alors la langue , fau–
te
d'articles,
manqlle de précifion,
&
donnc licu
au
méprife~.
II
eft vrai que par le fecours des adjec–
tifs déterminarifs , le Larin peut fuppléer au défaut
des
aNides;
& 'cft ce que irgae a fait en unc oc–
cafion pareillc
a
cellc dont parle Ovide ; mm alor
lc Latin perd le prétendu avanrage d'erre plus ferré
& plus concis que le
Fran~ois.
Lorfque Didon eut eu recours aux en hantemens ,
elle aVOLt un pié nud , dit Virgile, . . .
Unulfl
exUla
pede", vi/lclis
...
(Iv'
.JEmid. v.
Sl8.)
& ce pié
étoit le gauchc , felon les commentateurs.
Je conviel; qu'Ovide s efi énoncé d'une maniere
plus J(:rré
,nuda pede",
..
mais il a donné lieu
a
une
méprife. Virgile a parlé comme il auroit fait s'il avoit
écrit en
Fran~ois
;
unum exttla pedem
,
ayam un pié
nud ; il a évité
1
'équivoque par le fecours de I'ad–
¡eaif indicarif
unu",;
& ainfi a s'eft exprimé avec
plus de jufie{[e qu'Ovide.
En un mor, la netteté & la précifion font les pre–
mieres qualirés que le di{cours doit avoir; on ne par–
le que pour exciter dans l'efin'it des atltres une pen–
fée précifément telle qu'on la
con~oit
; or Ics langues
qui om des
anicles
,
om un intl:rument de plus pour
arTivcr ¡\ cette fin; & j'ofe a{[i1rer qu 'il y a dans les
livres Latins bien des paírages obfcurs , qui ne font
tel 9ue par le d faur
d'artidiS;
défaut qui a fOllvent
indUlt les allreurs
a
négliget les autres adjcélits dé–
monfitatits
,a
aufe de
1
'habimde
011
étoient ces au–
teurs d'énon et le 1110ts ÜU1S
anic/es,
& de laiírer
llll leaeur
a
fllppleer.
Je
nn:s
par une réflexion jndicieufe du pere Buf–
her. (
Gramm.
11.340.
) .
ous avons tiré nos éclair–
ciíremens
,f,
no
M¿tolP"JJl'lue
,p<Ilt-ltr~
un peuJ'ubtiLe,
m,lÍs
fr
s-r, lle
. . . . .
C
eJl
airifi que les fcimces fl
priunt mUllldl mmt lmrs flcours
..
Ji
In Métap/¡yJique
ontribm
ti
dem¿ler
nUt~m
nt des poillls eJ!mliels
a
la
Grammairc , ce/lt-ci bien. appri/e,
m
contribueroit p
m–
¿tr, pas mO/flS a ;clair Ir les d¡Jeours les plus lIletap'zy–
Ji'lutS. YO)e{ADH.CTIF,
ADVERBIO,
&c.(F)
ARTI LE, f. 111.
en
termes de CoTtuntrce,
fignífie
une perite partie ou divifion d'tU1 compte, d'un mé–
inoirc , d 'une fafutre , d'un invenraire , d'un livre
joumal ,
&c.
n
bon teneur de livres doit etre exaa
a
porter
Cur
le
~tand
livte au compte de cbacun , loit en dé–
bit. toit en ctédit tons les
artides
qui
[ont écrits
fUt le liHe journal , & ainíi du refie.
ANide
le
dit aulli des elaufes , conditions & con–
"en .ons portees dans l s fo i t '
S ,
dans
1
s mar hés,
TOI!I l.
ART
739
daos les traités,
&
des chofes jugées par d s arbitres.
Artic/e
fe prend auffi pOUt
le~
dilférens chef por–
tés par les otdonnances, les teglemens, les ftatuts
oes communautés,
&c.
particulierement quand on
les cite. Ainfi I'on dit;
cela efl cOllforme
ti
fU
arride
d. l'ordonnanct de 16:73;
d
ul
artide
dll regl mellt
des Teinturiers,
&c. Savary,
D ifl. du Comm. lomo
l.
p .
.738.
(G)
ARTIClE,
en
Peinture,
etl: un tres - perit COmour
qu'on nomme auffi
U1IlS.
On dit;
ces anicles
ne
fOllí
pas a./l'... prononds.
Olltre ces contours, a
y
a un
artide
on un tems ,
&c.
Anide
fignifie auffi,
en
P.illture comme
en
Anato–
mie ,
les joinrmcs Ol! articulation des os du corps,
comme les jointures des doigts,
&c.
(R)
AR
TI
ClES ,
en
termes de Palais
,
rom les circonf–
tances & particularités fur lefquclles une partie fe
propofe d'en faire interrQger une autre en jutl:ice;
dans ce fens , on ne dit guere
anides
qu 'avec faits ;
comme interroger quelqu'un fur
foils
&
anicús
;
don–
ner copie
desfoits
&
anides,
&c.
On appelle les
articlcs
tout limplement, les c1au–
fes
&
conventions qu'on etl: convenll de Jlipuler
dans un contrat de mariage par les deux filtllrs con–
joints , ou lems parens ou tuteurs llipulans pour
eux.
(H)
ARTICULAIRE, adj.
en Anatomie,
fe ditdespar–
ties relarives aux arriculations.
VOY'{
ARTI CULA–
TION.
L'apophyfe
articulaire
etl: une émmence qui fert
de bale
a
J'apohyfe zygomaliqúe de I'os des rempes.
Voy ...
TEMPORAL.
La cavité
artÍculaire
ctl: une cavité fitu 'e enlre les
apophyfes tl:yloide
&
arlÍClllaire
de I'os des tempes,
quire~oit
le condyle de la machoire inféricure.
Voy.
MACHOIRE.
Facettes
artic/llaires,
font des parties des os qui
fervent
a
lem atticulation avec d,'autr1:s.
Voyet
FA'
CETTES & Os.
Nerf· arlÍculair•. Voye{
AXILlAIRE.
(L)
ARTlCUlAIRE,
terme de
Al
decine;
c'eft llne épi–
thete qu'on donne
a
une maladie qui amige plus im–
médiatement les articulations ou les joinntres.
La maladie
articulair., morbus arLÍcularis,
etl: ce
qu les Gr cs appellent
drrF/'TI~ ,
&
nous
gOlltte. Yoy.
GOUTTE. (
)
ART ICULATION,
r.
f.
en
Ana/omi. ,
c'etl: une
joimure ou une connexion de deux os.
Voy.
Os.
I!
y a dilférentéS formes
&
dilférentes efpeces
d'arlÍculalÍon,
'luí cbrrefpondent aux dilférentes for–
tés 'de mouvemens
&
d'a:élions.
L'aniwlation
'lui a
un mouvement notable & manifefte eft appellée
dúmhrofl. V oye{
DIARTHROSE. Celle-ci fe fubdivife
en
énart/¡rofi
,
artlzrodie
,
&
ging/yme. Voyt{
ENAR–
THROS.E, ARTHRODIE, &GINGlYME.
L'articulation
qui ne permet point de mouve-nent,
efi appelléeJYnan/¡rtife.
Voyt{
SYI\"ARTHROSE. Elle
fe fubdivife en
fut/Lrt, !umnó,úe
,
&
gompf¡oje. VoyC{
SUTURE, HARMO lE,
&c.
(
L)
ARTICULÉ , adjeilif & participe du velbe
arti–
CIder.
Anide,
en termes d'Anatomie, fignifie la jointu–
re des os des animaux ;
articulatioll
,
en géné–
ral, fignifie la jonilion dc deux COtpS , qui étant liés
l'un
a
I'aútre , peuvent etre pliés fans fe d 'tachero
Ainú les fons de la voix humaine font dc fons dif–
férens , variés , mais liés entr'eux de telle lorre qu'i1s
formem des mots. On dir d'un homme qu'il
articule
bien, c'etl:·¡\-dire , qu'il marque dillin8emcm les fyl–
labes & les mots. Les animaux
n'articulent
pas com–
me nous le fon de ICltr voix.
11
y
a quel'lues oifeaux
alL'l:q~lels
on apprend
a
arlÍcultr
certams mots; re/s
fonr le perroquet • la pie, le moineau,
&
quel'lucs
autrcs.
VoYer.
AATICLE.
(F)
A A
aa
a
ij
















