
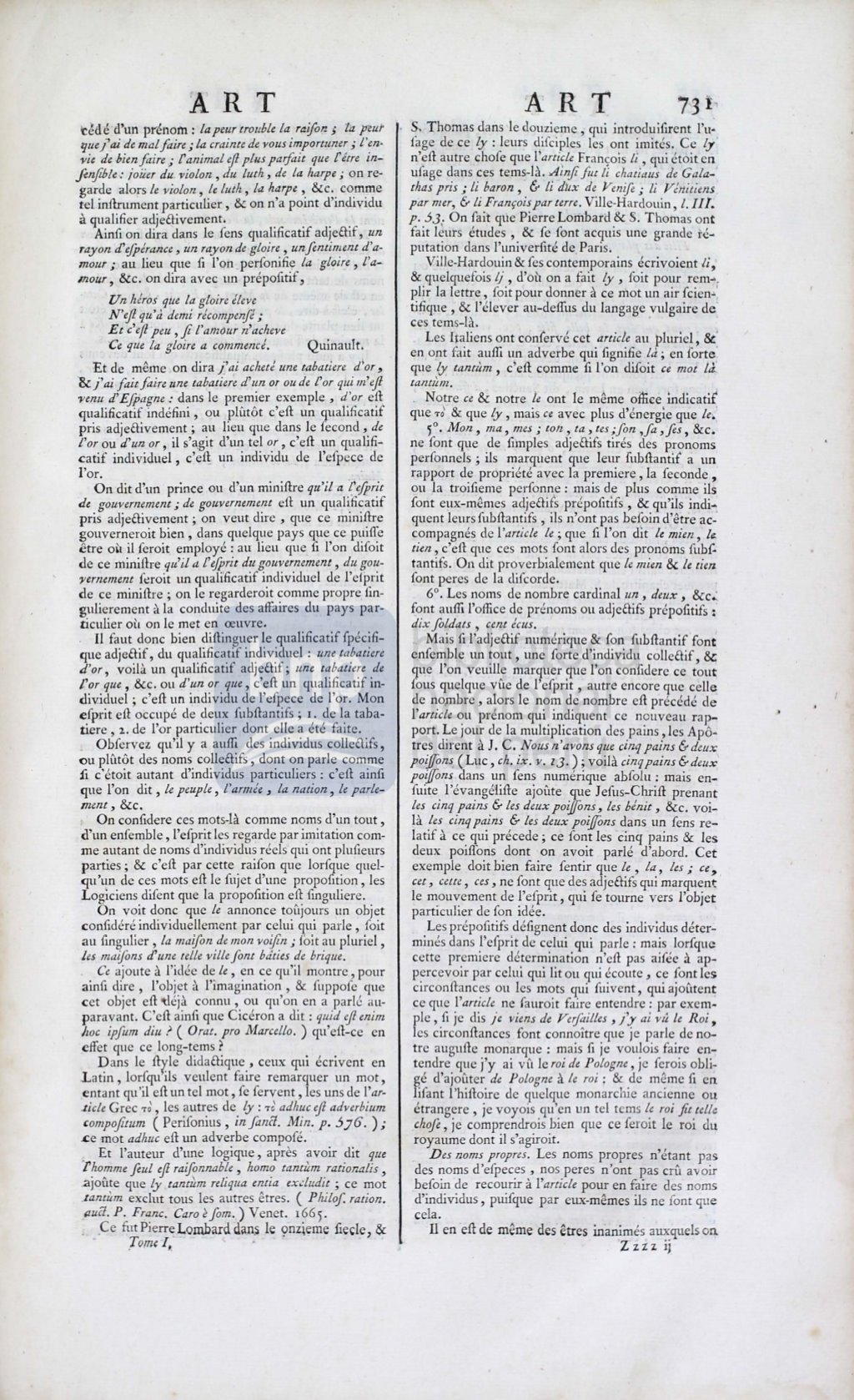
ART
tédé
d'un pl'énom :
lapeur trouble la raifon
j
la peut
quej'ai de malfoire; la crainee de vous imponuner; ['en'
vie de bien foire
;
r
animal ejl plus paifait que fétre in–
flnjibü ,' joiter du violon ,du luth, de la lIarpe;
on re-
garde alorsle
violon,
le
bah,
Ül
h~rpe
'.
&c;. co:m:n e
teLinfuument particulier,
&
on n a pomt d mdivldu
a
qll3lifier adjeélivement.
....
Ainli on dira dans le {ens qualificauf ad¡eéhf,
un
rayon d'e.fPlrance, un rayon de gloire, unfimimene d'a–
mour;
au lieu que íi 1'on per{onifi
y
la gloire, ['a–
mour,
&c. on dira avec un prépoíitif,
11n héros qla la g/oire/leve
N'ejl qu'a demi dcompenJé;
Etc'efl peu ,ji l'amour n'acfzeve
Ce gue la gloire a cOn/meneé.
Quinault.
Et de meme on dira
j'ai acheté une tabatiere d'or>
'&j'ai faitfoire une tabatiere d'un or oude l'or qui
lIl'eJl
lIenu d'EJPagne
:
dans le premier exemple ,
~'or e~
qualificatif indéfini, ou pllttat c'eft un quablicatlt
pris adjefrivement;
~u
IIeu que
dan~
le fecond '.
de
L'or
ou
d'un or,
ils'a.glt d un tel
or,
c eft un quahfi–
catif individue!, c'efl un individu de I'e{pece de
1'0r.
On dit d'un prince ou d'un miniftre
qu'iln (e.fPrit
de gouvemement; de gouvernemene
eH un
qual~fi~atif
pris adjefrivement; on veut dire , que ce
mml~e
gouverneroit bien, dans quelque pays que ce pudre
etre ou iI feroit employé : au lieu que íi l'on di(oit
de ce miniftre
qu'iL a l'e.fPrit du gouvemement, du gou–
yemement
(éroit un quaIlficatif individuel de l'e{prit
de ce miniftre ; on le regarderoit comme propre ún–
gulierement a la conduite des affaires du pays par–
ticulier oiL on le met en reuvre.
. Il
faut donc bien diftinguer le qualiticatif {péciti–
que adjeélif, du qua.litica.tif in.div!duel :
une
ta~atiere
d'or
voilit un qualIficatlf ad¡eélif;
une tabatlere de
i'or
~ue
,
&c. ou
tj.'un or que,
c'eft un qualificatif in–
div:iduel ; c'eft un individu de I'e{pece de l'or. Mon
e(prit ea occupé de deux {ubfiamifs;
l.
de la taba–
tiere,
2.
de I'or particulier dom elle a éré faite.
Obfervez qu'il ya auffi des individus colleélifs,
ou plutar des noms colleélifs, dont on parle comme
fl c'étoit autant d'individus particuliers: c'eft ainíi
que l'on dit,
le
peuple, l'armée , la nation, le par/e–
mem ,
&c.
On conúdere ces mots-lIt comme noms d'un tout ,
d'un enfemble, I'efprit les regarde par imitation com–
me autant de noms d'individus réels qui ont plllÚel\Ts
parries; & c'eft par cette rai(on que lorfque quel–
<¡u'un de ces mots eft le fujet d'une propoútion, les
Logiciens d¡{ent que la propoútion efi únguliere.
On voit donc que
le
annonce tolljOurs un objet
conúdéré individuellement par celui qui parle, (oit
au úngulier ,
la maifon de mon voijin;
{oit au pluriel ,
Les lIlaifons d'une telle villefont haties de brique.
Ce
ajoute a I'idée de
le
,
en ce qu'il montre, pour
ainú dire, I'objet a l'imagination ,
&
{uppo(e que
cet objet eft 'tléja connu, ou qu'on en a parlé au–
paravant. C'efi ainú que Cicéron a dit :
quid
efl
enim
Izoc ipfum diu
? (
Orat. pro Marcello.
)
qu'efi-ce en
effet que ce long-tems?
D ans le
frr.ledidafrique, ceux qui écrivent en
Latin, lorfqu ils veulent faire remarquer un mot,
emant qu'iI eft un tel mot, {e {ervent, les uns de l'
ar–
.Licle
Crec
'T~
,
les autres de
ly:
T~
adlzuc
efl
adverbium
compojimm
(Pcrifonius ,
in foru1. Min. p•
.5;6. );
.ce mot
adlzuc
eft un adverbe compofé.
Et l'auteur d'tme logique, apn!s avoir dit
que
L'homme feul
ifl
raifonnablt, Izomo tantUm rationalis,
.ajoltre que
ly tanmm rdiqlla eneia ex.:ludit
;
ce mot
tantum
exclut touS les autTes etres. (
Philof. ratÍon.
(lUa.
P. Franc. Caro efom. )
Venet.
1665.
. .Ce fllt Pierre Lombard
dan~
le gnzieme fiede,
&
Jorml,
ART
~
Thomas dans le douzieme , c¡ui introduiGrent
I'u~
j¡lge de ce
ly
:
Jeurs difciples les om imités. Ce
ly
n'eft autre chofe que
llartifle
Fran<;ois
li,
qui étoit en
u(age dans
ces
tems-Ia.
Aznji
1m
li clzatiaus de Gala–
tizas pris
;
ti
baron,
&
li dux de Yenift; li Yénitiens
par mer,
&
ti
Fran~ois
par terreo
Ville-Hardouin ,
1.111.
p .
.53,
On fait que Pierre Lombara
&
S.
Th0tnas ont
fait leurs études , & {e {ont acquis une grande i'é–
putation dans l'univerfité de Paris.
Ville-Hardouin
&
{es contemporains écrivoient
Ji,
&
quelquefois
ij
,
d'on on a fait
ly
,
{oit pour
rem~.
plir la lertre, foit pour donner a ce mot un air {cien;
tifique , & l'élever au-deífus du langage vulgaire de
ces tems-la.
Les Italiens ont con{ervé cet
anide
au lJluriel,
&'
en ont fait auffi un adverbe qui úgnifie
la;
en [orte:
que
(y
tancum,
c'eft comme G1'0n difoit
ce mot
ltL.
ranullll.
. Notre
ce
& norre
le
ont le méme oiliee indicata'
que
7d
&
que
ly,
mais
ce
avec plus d'énergie que
le.
5°.
Mon
,
lila, mes; ton, ta, tes ;fon ,fa, fes,
&c.
ne font que de Ginples adjefrifs tirés des pronoms
per{onnels ; iJs marquent que leur [lIbfiami{ a un
rapporr de propriété avec la premiere, la {econde,
ou la troiGeme per{onne: mais de plus comme ils
font ellx-memes adjeélifs prépoGtifs , & qll'ils
indi~
qllent leurs (ubftantifs , ils n'ont pas befoin d'etre ac–
compagnés de
I'article le;
que G1'0n dit
le mien,
le.,
tien,
c'eft que ces mots font alors des pronoms {ubf–
tantifs. On dit proverbialement que
le mien
&
le
lÍen
(ont peres de la di[corde.
6°. Les noms de nombre cardinal
un
,
dtux,
&c':'
(ont auffi l'oRice de prénoms ou adjeélifs prépoGtifs .:
dix foldats, cene teus.
Mais Gl'adjeélif numérique
&
Con (ubfiantif font
enfemble un tout, une Corte d'individu colleélif,
&
que J'on veuille marqtler que I'on conlidere ce tout
{ous quelque vlle de I'efrrit , autre encore que celle
de no,mbre, alors le nom de nombre eft précédé de
l'anicle
ou prénom qui indiquent ce nCllveau rap–
port. Le jour de la multiplication des pains, les
Apa–
tres dirent a
1.
C.
Nous n'avons que cinq pains
&
deux
poij[on~
(Luc ,
clz. ix. v.
z3 . ) ;
voila
cÍnq
pains
&
deux
poij[ons
dans un {ens numérique ab{olu: mais en–
fuite I'évangélifie ajollte que Jefus-Chrift prenant
les cinq pains
&
les deux poijfons, les Mnit,
&c.
voi–
la
les cinq pains
&
les deux poijfons
dans un [ens re–
latif a ce qui précede; ce
(Ont
les cinc¡ pains
&
les
deux poiífons dont on avoit parlé d'abord. Cet
exemple doit bien faire {entir que
le, la, les; ce>
cet, cme, ces,
ne font que des adjeélifs qui marquent
le mouvement de l'eCprit, qni {e tourne vers I'objet
particulier de (on idée.
Les prépofttifs déúgnent donc des individus déter–
minés dans l'e{prit de celui qui parle: mais 10rCqllc
cette premiere détermination n'eft pas aifée
a
ap–
percevoir par celui qui lit ou qui écollte, ce {ont les
circonfiances ou les mots qui (uivent,
qui
ajolltent
ce que l'
article
ne fauroit faire entendre : par exem–
pIe, ft je dis
je viens de Veifailles
,
j'y
ai
Vii
le R oi ,
les circonftanccs font connoltre que je parle de no–
tre augufie monarC)lle : mais ft je voulois faire en–
tendre que j'y ai VlI le
roi de Pologne,
je (crois obli–
gé d'ajouter
de Pologne
a
le roi :
&
de meme ft en
Iifant l'hiil:oire de cJuelque monarchie ancienne ou
étrangere, je voyois qu'en un tel tems
le roí
fo
telle
clzofe,
je comprenclrois bien que ce (eroit Je roí dll
royaume dont ils'agiroit.
D es noms propres.
Les noms propres n'étant pas
des noms d'efpeces , nos peres n'ont pas crll avoir
befoin de recourir
a
l'article
pour en faire des noms
d'individus, pui(que par eux-memes ils ne (ont que
ccla.
II
en
efi
de meme des etres inanimés auxquels on
Z
HZ.
ij
















