
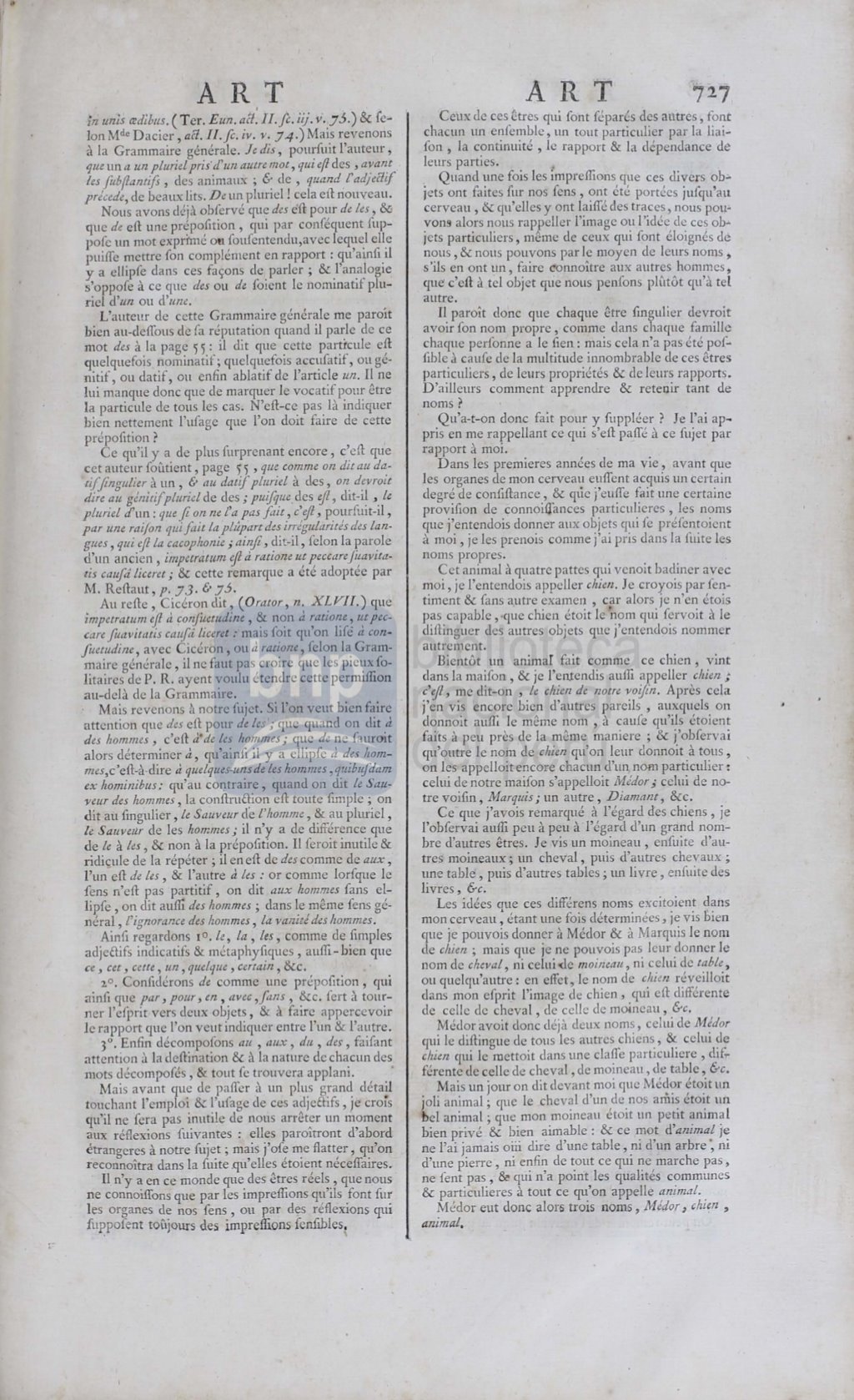
ART
in unis
I2dibl/s.
(Ter.
Eun.
atl:
II.fe.
iij. v.
7.5.)
&
Ce–
Ion
Mde
Dacier,
aa.
l/.fe.
iy.
Y •
.74.)
Mais revenons
a
la Grammaire générale.
Je
dis,
pOlll{uit l'auteur ,
'l/U
un
a un plurielpris'd'un autre mot, 'fui efl
des,
ayant
les fitbflantifi,
des animaux ;
&
de ,
qlland
['
adjeaif
précede,
de beam: lits.
De
un pluriel
!
cela eil: nouyeau.
Nous avons déji\ obfervé que
des
eil: pOl\l'
de les,
&
que
de
eil: une prépolition, qui par con[équent {up–
pofe un mot exprimé Oll {ollfentendu,avec lequel elle
puiffe mettre fon complément en rapport : qu'ainli il
ya ellipfe dans ces fa<;ons de parler ; & l'analogie
s'oppofe a ce que
des
ou
de
[oient le nominatif pllL–
riel
d'un
ou
d'lllze.
L'auteur de cette Grammaire générale me paroít
bien au-deffous de [a réputation quand il parle de ce
mot
des
a la page
55:
il dit que cette particule
ell:
Cjuelquefois nominatif; quelquefois accuL'ltif, ou gé-
11itif, ou datif, ou enfin ablatif de l'article
un.
Il
ne
lui manque donc que de marquer le vocatifponr
~tre
la parúcule de tous les caso N'eil:-ce pas la indiquer
bien ncttement l'ufagc que I'on doit faire de cette
prépolition ?
Ce qu'il y a de plus furprenant encore, c'eíl: que
cet auteur foutient, page
55 ,
que comme on die au da–
tifjingulier
a un, &
mt datifplurie!
a
des,
on devroit
dire au gbzitifpbtriel
de des;
puifl¡IlC
des
ifi,
dit-il ,
le
pluriel
d'un:
que ji onne l'a pas foit, c'ifi,
pourfuit-il,
par une raifon 'fui foit laplúpartdes irrégularitésdes lan–
gues, qui
ifi
la cacop!umie
;
ainji,
dit-il, Celon la parole
d'un ancien,
impetratum ifi
ti
ratione ue peccareJüayita–
lis caufá licmt;
& cette remarque a été adoptée par
M. Reíl:aut,p.
.73.
&
7.5.
Au reil:e, Cicéron dit,
(Oraeor, n.
XLVII.)
que
impetratum
ifi
ti.
confuuudine
,
&
non
d
racione, utpec–
care foavltatis caufá liceree
:
mais
Coit
qu'on Jife
d
con–
fimudine,
avec Cicéron, ou
d
ralione,
Celon la Gram–
maire générale, il ne faut pas croire que les pieuxCo–
litaires de
P.
R. ayent voulu étendre cette permi1Iion
au-dcla de la Grammaire.
Mais revenons
ti
notre fujet. Si l'on veut bien faire
attention que
des
eil: pOlU'
de les';
que quand on dit
d
des hommes,
c'eil:
ti'
de Les !lOmmes;
que
de
ne fauroit
alors déterminer
ti,
qu'ainli il y a ellipCe
ti
des !tom–
mes,c'eil:~.l·dire
ti
que!ques-unsde les hommes ,qltib/if'dam
ex hominibus:
qu'au cOl)traire, quand on dit
le Salt–
yeur des hommes,
la coníl:ruilion eíl: toute flmple ; on
dit au flngulier,
Le
Sauyeur
de
l'lzomme,
&
au pluricl,
le Sauyeúr
de les
homnzes;
il n'y a de différence que
de
le
a
üs,
& non a la prépoíition.
11
[eroit inutile
&
l'idicule de la répéter ; il eneíl: de
des
comme de
allX ,
l'un eíl:
de les,
&
l'antre
d
Les
:
or comme lorfque le
{ens n'eíl: pas partiúf, on dit
aux hommes
fans el–
lipCe, on dit aulJi
des honzmes
;
dans le
m~me
Cens gé-
11éral,
l'ignorarzce des IlOmmes, la yaniddes lzommes.
Ainli regardons
{o.
le,
la, les,
comme de fimples
adjeilifs indicatifs
&
métaphyflques, aulJi-bien qne
ce, ctt, celle, un, que/que, certain
,
&c.
].0.
Confidérons
de
comme une prépofition, qui
ainli que
par, pour, en, avec ,fans,
&c. Cert a tour–
ner l'efprit vers deux objets,
&
a
faire appercevoir
le rapport que l'on veut indiquer entre l'un
&
l'autre.
3°. Enfin décompofons
a/l
,
au."C, da, des,
fallant
attention
a
la
cleíl:inaúon & a la narme de chacun des
mots décompofés ,
&
tout fe tronvera applani.
Mais avant que de paífer a un plus grand détail
tonchant l'emploi & l'uCage de ces adjeétifs , je crois
qu'il ne fera pas inutile de nous
arr~ter
un moment
aux réflexions [uivantes : eUes paroltront d'aborcl
étrangeres
a
notre fujet ; mais j'ofe me flatter, qu'on
reconnoitra dans la [uite .qu'elles étoient néceífaires.
11
n'y a en ce monde que des etres réels , que nous
ne eonnoiífons que par les impreffions qu'ils font fur
les organes de nos Cens, ou par des réflexions qui
fURpof nt tOlljours des impreflions [enfililes,
ART
Ceux de ces etres qui font Céparés des autres , font
chacun un enfemble, un tout parúculier par la liai–
Con, la continuité , le rapport
&
la d 'pendance de
leurs parties.
.
Qlland une fois
les
impreffions que ces divers oh–
jets om faites fur nos [ens , ont été portées ju[qn'all
cerveau ,
&
c¡u'elles y ont laiffé des traces, nous pon–
von9 alors nous rappeller l'image ou I'idée de ces oh–
jets particuliers,
m~me
de ceux qui [om éloignés de
nous, & nous pouvons par le moyen de leurs noms;
s
'ils en ont un, faire connoltre aux autres hommes,
que c'eíl:
a
tel
objet que nous penCons pllltot qu'a tel
autre.
Il
parolt done que chaque
~tre
ftngulier devroit
avoir
Con
nom propre, comme dans chaqne famille
chaque per[onne a
le
flen : mais cela n'a pas été pof–
lible
d
caufe de la multitude innombrable de ces
~tres
particuliers, de leurs propriétés & de leurs rapports.
D'aiUeurs comment apprendre & reteoir tant de
noms?
Qu'a-t-on donc fait pour y fuppléer? Je l'ai
ap~
pris en me rappellant ce qui s'eil: paífé
a
ce
ft~et
par
rapport
a
moi.
Dans les premieres années de ma vie, avant que
les
organes de mon cerveau euífent acquis un certain
degré de confiíl:ance, & C¡lie j'euífe fait une certaine
provifion de connoi/Iances particulieres, les noms
que j'entendois donner alIJe objets qui fe préfentoient
a
moi, je les prenois comme j'ai pris dans la úlite les
noms propres.
Cet animal
a
quatre pattes qui venoit badiner avec
moi, je l'entendois appeller
e/lÍen.
Je eroyois par Cen–
timent & Cans autre examen, car alors je n'en étois
pas capable ,'que chien étoit le 'nom qui fervoit a le
diíl:inguer des autres objets que j'entendois nommer
autrement.
Bientot un animar faít comme ce chien, vint
dans la mai[on , & je l'entendis aulll appeller
c"ien;
c'ifi,
me dit-on ,
le chicn de notre yoijin.
Apres cela
j'en vis encore bien d'autres pareils , auxc¡uels on
donnoit auili.
le
meme nom ,
a
cauCe qu'ils étoient
fai'ts
a
peu pres de la
m~me
maniere; & j'obfervai
(lu'outre le nom de
clzien
qu'on lenr donnoit a tous ,
on les appelJoit encore chacnn d'un nOfll particnlier :
celui de notre maifon s'appelloir
MUor
j
cclni de no–
tre voifln ,
Marquis;
un autre ,
Dianzaflt,
&c.
Ce que j'avois remarqué
¡\
l'égard des ehiens , je
I'obfervai aufU pen
a
peu a I'égard d'un grand nom–
bre d'autres
~tres.
le vis un moineau , enCuite d'au–
tres moineaux; un cheval, lmis d'autres chevaux;
une table, puis d'autres tables;
lUl
livre, enfuite des
livres, &c.
Les idées aue ces différens noms excitoient dans
mon cerveau : étant une fois cléterminées, je vis bien
que je pouvois donner
a
Médor & a Marqnis le nom
de
e/lÍen;
mais que je ne pouvois pas leuT donner
le
110m de
cheval
,
ni celui <le
moimalt,
ni celui de
cable,
ou c¡uelc¡u'autre : en effet, le nom de
e/úerz
réveilloit
dans mon e[pri.t l'image de chien, qui eil: différente
de celle de cheval, de celle de moineau,
&c.
Médor avoit donc déja deux noms, celui de
MUor
qui le dillingue de tous les aun'es chiens,
&
celui de
chien
'lui le mettoit dans une claffe particuliere , dif,.
férente de ceHe de cheval, de moineau, de table,
&c.
Mais un jour on dit devant moi que Médor étoit un
joli animal; que le cheval d'un de nos arñis étoit un
be! animal; que mon moineau étoit un petit animal
bien privé & bien airnable: & ce mot
d'animal
je
ne l'ai jamais oiü dire d'une table, ni d'un arbre
~
ni
d'une pierre, ni enfin de tout ce qui ne marche pas,
ne Cent pas ,
&
qui n'a point les qualités communes
& particulieres
a
tout ce qu'on appelle
animal.
Médor eut done alors trois noms ,
Médor
1
chiell ,
animal,
















