
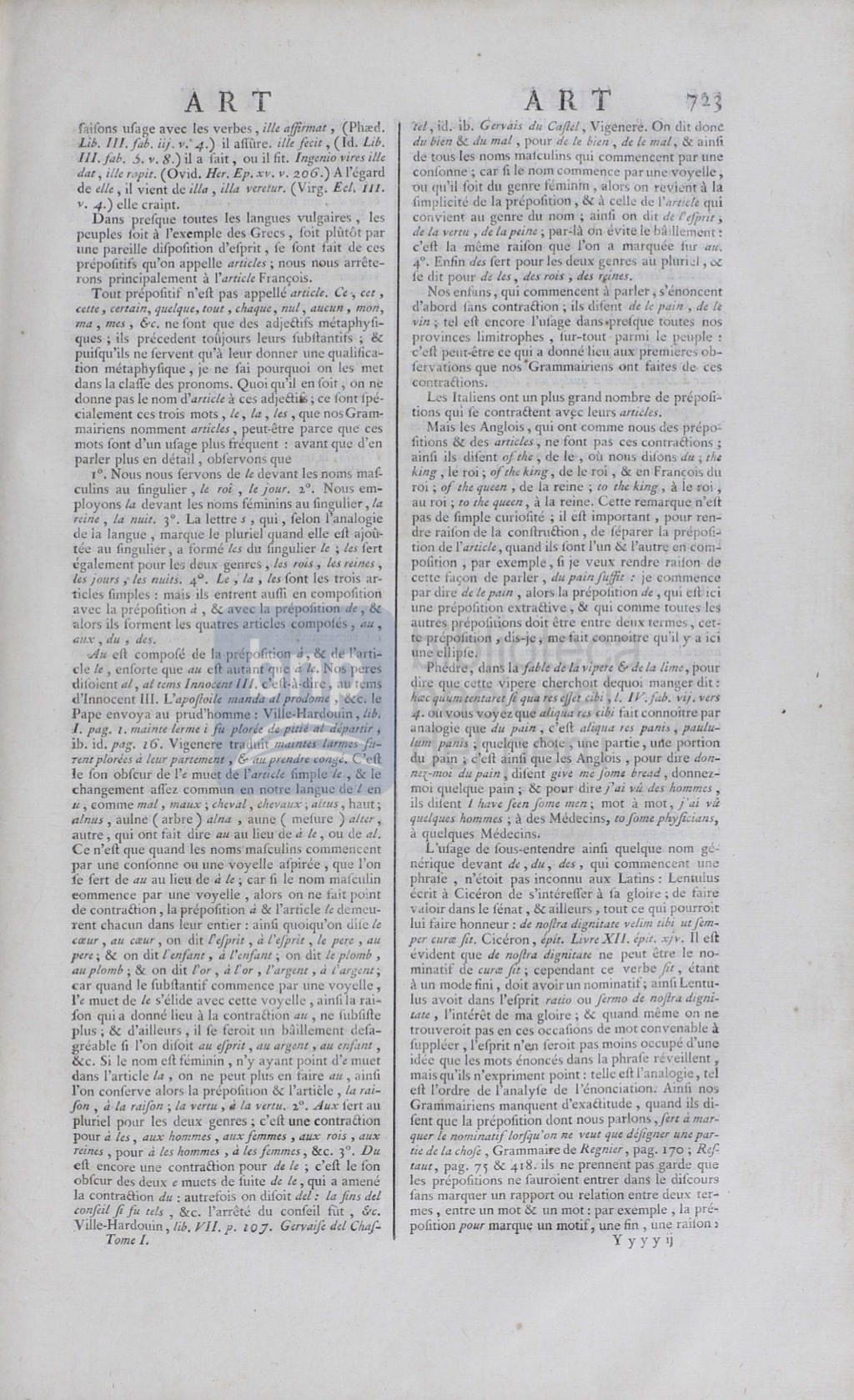
ART
[aifons ufage avec les verbes,
ille affirmat,
(Phred.
Lib. JII. Jab. iij. v.·
4 .)
il affúre.
i!le ficit
,
( Id.
Lib.
IlI.Jab.
j.
v.
8.)
il a fait, ou il nt.
Ingenio vires il/e
dat, i!le r"pit.
(Ovid.
Her. Ep. xv. v.
206.)
A I'égard
de
elle,
il vient de
i!la, i!la veretur.
(Virg.
Eel.
IlI.
v.
4-)
elle craipt.
.
Dans prefque toutes les langnes vulgaires, les
peuples foit a l'exemple des Grecs, foit plútot par
une pareille difpofition d'efprit, fe fom fait de ces
prépofitifs qu'on appelle
anieles;
nous nous arrete-
1'ons principalemem
a
l'aniele
Fran<;ois.
Tollt prépofitif n'eft pas appellé
aniele. Ce.,
cet ,
ceue, certain, ljuelljue, lOUl
,
cltaljue, nul, aucun, mon,
ma, mes,
&c.
ne font que des adjeébfs métaphyfi–
ques ; ils précedent toújours leurs fubfiantifs ;
&
puifqu'ils ne fervent qu'a leur donner une qualifica–
lÍon métaphyúque, je ne fai pourquoi on les met
dans la claffe des pronoms. Quoi qu'il en foit , on ne
donne pas le nom
d'aniele
a
ces adje8if6; ce font /pé–
cialement ces trois mots,
le, la, les,
que nos Gram–
mairiens nomment
anieles,
peut-etre parce que ces
mots font d'un ufage plus fréquent : avant que d'en
parler plus en détail , obfervons que
rO.
Nous nous fervons de
le
devant les noms mafe
culins au úngulier,
le roí, lejour.
2°.
Nous em–
ployons
la
devant les noms féminins au fm!?ulier
,la
reine, la ¡¡Uil.
3°.
La lettre
s,
qui, felon I analogie
de ia langue , marque le pluriel quand elle eft ajoll–
tée au fingnlier,
a
formé
les
du fingulier
le
;
les
iút
également pour les deux genres ,
les rois, les reims ,
les }ours
,
Les nuilS.
4
0 •
Le, la
,
les
font les trois ar–
tieles fimples :
mai~
ils entrent auili en compofition
avec la prépofition
ti
,
& avec la prépofition
de,
&
alors ils forment les quatres articles compo{és ,
au ,
aux, dlt, des.
Au
efi compofé de la prépofition
d,
& de l'ani–
ele
le
,
enforte que
au
efi autant que
ti
le.
Nos peres
di/oient
al, af tems Innocem
1/1.
c'eft-a-dire, au tems
d'Innocent
IIL
L'
apojloile manda al prodome
,
&c.
le
Pape envoya au prud'homme: Ville-Hardouin,
Lib.
1.
pago
l.
maime lerme i fu ploré, de piti.! al d¿partir,
ib.
id.
pago
z6.
Vigenere traduit
maimes larmes jit–
rentplorées
ti
Leur panemem
,
&
a/t prendre congé.
C'cft
le fon obfcur de
I'e
muct de
I'arúele
fimplc
le
,
& le
changement affez commun en notre langue de
l
en
lt,
eomme
mal, maux; cluval
,
,ltev({ux; altus,
haut;
alnus,
aulne ( arbre )
alna
,
aune ( meúu'e )
alter ,
autre, qui Ont fait dire
au
au lieu de
d
le,
ou dc
al.
Ce n'efi que quand les noms mafculin commencent
par une con/onne ou une voyelle afpirée , que I'on
fe fert de
au
au lieu de
ti
le
;
car fi le nom mafcnlin
eommence par une veyeHe , alors on ne fait point
de contra8ion , la prépofition
ti
& l'article
le
demeu–
rent chacun dans leur entier : ainíi quoiqu'on diíe
le
ca!/lr,
41t
creur,
on dit
fe/prie
,
a
L'eJprit, le pere
,
au
pere;
& on dit
l'enJant,
ti
l'enJant;
on dit
le
plomb ,
art plomb
;
& on dit
l'or
,
ti
[or
,
l'argent
,
ti
t'argcnt;
car quand le fubftantif commence par une voyelle
1
l'e
muet de
le
s'élide avec cette voyelle, ainfi la rai–
fon qui a donné lieu a la contra8ion
alt
,
ne fubfifie
plus;
&
d'ailleurs, il fe feroit Ull baillemem defa–
gréable fi I'on di{oit
alt eJPril
,
a/t argent
,
au en¡:,nt ,
&c. Si le nom eft féminin , n'y ayant point d', muet
dans I'article
la
,
on ne peut plus en faire
alt,
ainfi
1'on conferve alors la prépofition & l'artiCle ,
la rai–
flm,
ti
la raifon; la Vtrtu,
a.
la venlt.
2°.
Aux
fert au
pluriel pour les deux genres; c'efi une contra8ion
!)our
ti
les, aux Itommes
,
allX fimmes
,
aux rois
,
all..
reines,
pour
ti
les Iwmmes
,
ti
Les fimmes,
&c.
3°.
Du
efi encore une contraaion pour
de le
;
c'efi le fon
obfcur des deux
e.
muets de filite
de le,
qui a amené
la contraél:ion
du
:
autrefois on difoit
del: la fins del
cIJ,!fiiL ji jit
tels
,
&c. l'arreté du confeil ftlt ,
oYc.
Ville-Hardouin,
lib. VII. p .
z
0.7. Gervaífe del Chal-
Tome
l.
ART
id,
id. ib.
Gervais du Cajlel,
Vigénere. On dit done
dll
bim
&
dlt mal,
pour
de
Le
bien, de
le
mal,
& ainu
de tous les noms ma1culins qui commencent par une
confonne ; cal' fi le nom commence par une voyelle ,
uu (IU'il foit du genre féminin , alors on revient
a
la
fimpl!cité de la prépofition, &.a celle de
I'aniele
qui
convlent au genre du nom ; alllfi on eht
dé
l'eJPrit,
de la Verllt
,
de lapeine;
par-la on évite le b1llllement:
c'efi la meme raifon que l'on a marquée
{tu
alt~
4°.
Enfin
des
fert pour les deux genres au plllnd, oc
fe dit pOtlr
de les, des rois
,
des r¡ines.
Nos enfans, qui commencent
a
parler, slénoncent
d'abord
lims
conu'aél:ion ; ils difent
de
Le
pain
,
de le
vin
;
tel
dI:
encore I'll/age dans ,prcfque toutes nos
provinces limitrophes , {ur-tout parmi le peuple :
c'eft pellt-etre ce qui a donné lieu aux premieres ob–
fervations que nos 'Grammairiens ont faites de ces
contra8ions.
Les Italiens ont un plus grand nombre de prépofi–
tions qUl fe contra8ent av!,!c lellfs
anie/es.
Mais les Anglois, qui ont comme nous des prépo–
fitions
&
des
anieles
,
ne font pas ces contra8iolls ;
ainfi ils difent
ofllte
,
de le, Otl nOllS difons
du;
tflt
king,
le roi;
ofelte king,
de le roi , & en Franc;ois du
roi ;
of lhe 'lueen
,
de la reine;
lO
the king,
a le roi ,
au roi ;
LO
lite ljueen,
a
la reine. Cette remarque n'eft
pas de fimple curiofité ; il eft important , pour ren–
dre raifon de la confinlétion , de féparer la prépofi-'
tion de
I'aniele,
Cjuand ils /Ont I'un
&
I'aurre en com–
pofition , par exemple, fi je veux rendre raiJon de
cette fa<;on de parler ,
du painjiLffit
:
je commence
par dire
de lepllln
,
alors la prépo/ition
de
1
qui eft icí
une prépofition eA'tra8ive , & qui comme tomes les
alltres prépofitions doit erre entre deux termes, cet–
te prépofition, dis-je, me fait connoitre qu'il y a ici
une eHipfe,
Phédre, dans la
Jable de la vipete
&
de la lime,
pour
elire que cette vipere chercholt dequoi manger dit:
/uzc
tjltumtentarecji ljua res
ef1et
cihi,
t.
I V.jilb.
vi}.
vers
4·
oi! vous voyezque
({Li'lua reS cibi
fait connoltre par
analogie que
du p"in
,
c'eft
aLiljua res pani,
,
paulu–
Illm panis
;
quelque chole , une partie, urte portion
du pain ; c'efi ainfi que les Anglois , pour dile
don–
m{-moi du pain,
di/ent
give me loma bread,
donnez–
moi quelque pain; & pO\1f direj'ai
vú
des Itommes,
ils di/ent
1
have fien fome men;
mot
a
mot,
j'ai vú
ljltdljltes Itommes
;
a des Médecins,
to fome pl¡yjicians,
a quelqlles Médecins.
L'llfage de fous-entendre ainú c¡uelque nom
gé–
nérique devant
de, dll, des,
qui commencent une
phraíe , n'étoit pas inconnu aux Latins: Lennúus
écrit
a
Cicéron de s'intéreffer
a
fa gloire; de faire
"diolr dans le fénat , & ailleurs, tout ce qui pourroit
lui faire honneur :
de nojlra dignitate
v.ti", libi Uljem–
per wrre jil.
Cicéron,
épÍl. Livre XI
J.
éplt. xjv.
Il
eft
évident que
de noJlra dignitate
ne peut
~tre
le no–
minatif de
curre Jit
;
cependant ce verbe
jit,
étant
a un mode
fini,
doit avoir un nominatif; ainfi Lenru–
lus avoit dans l'efprit
ratio
Oll
firmo de nojlra digni–
tate,
I'intér&t de ma gloire ; & quand meme on ne
trouveroit pas en ces occafions de mot convenable
a
fL!ppléer, I'efprit n'en (eroit pas moins occupé d'une
idée que les mots énoncés dans la phrafe réveillent,
mais qu'ils n'expriment point: telle efi I'analogie, tel
eft l'ordre de l'analyfe de l'énonciation. Ainfi nos
Grammairiens manquent d'exa8itude , quand ils di–
(ent que la prépofition dont nous parlons
,fin
ti
fllar–
ljuer
le
nominatif10rfl¡Il'on ne veat que dijigner /lne par–
tie de la
cllOfo
,
Grammaire de
Regnier,
pago
170 ;
Rifo
taut,
pago 75 &
418.
ils ne prennent pas garde que
les prépoiitions ne famoient entrer dans le difcours
fans marql1er un rapport ou relation entre deux ter–
mes, entre un mot
&
un mot : par exemple , la pré–
pofition
pour
marque un motif, une fin , une rai/on )
yyyyij
















