
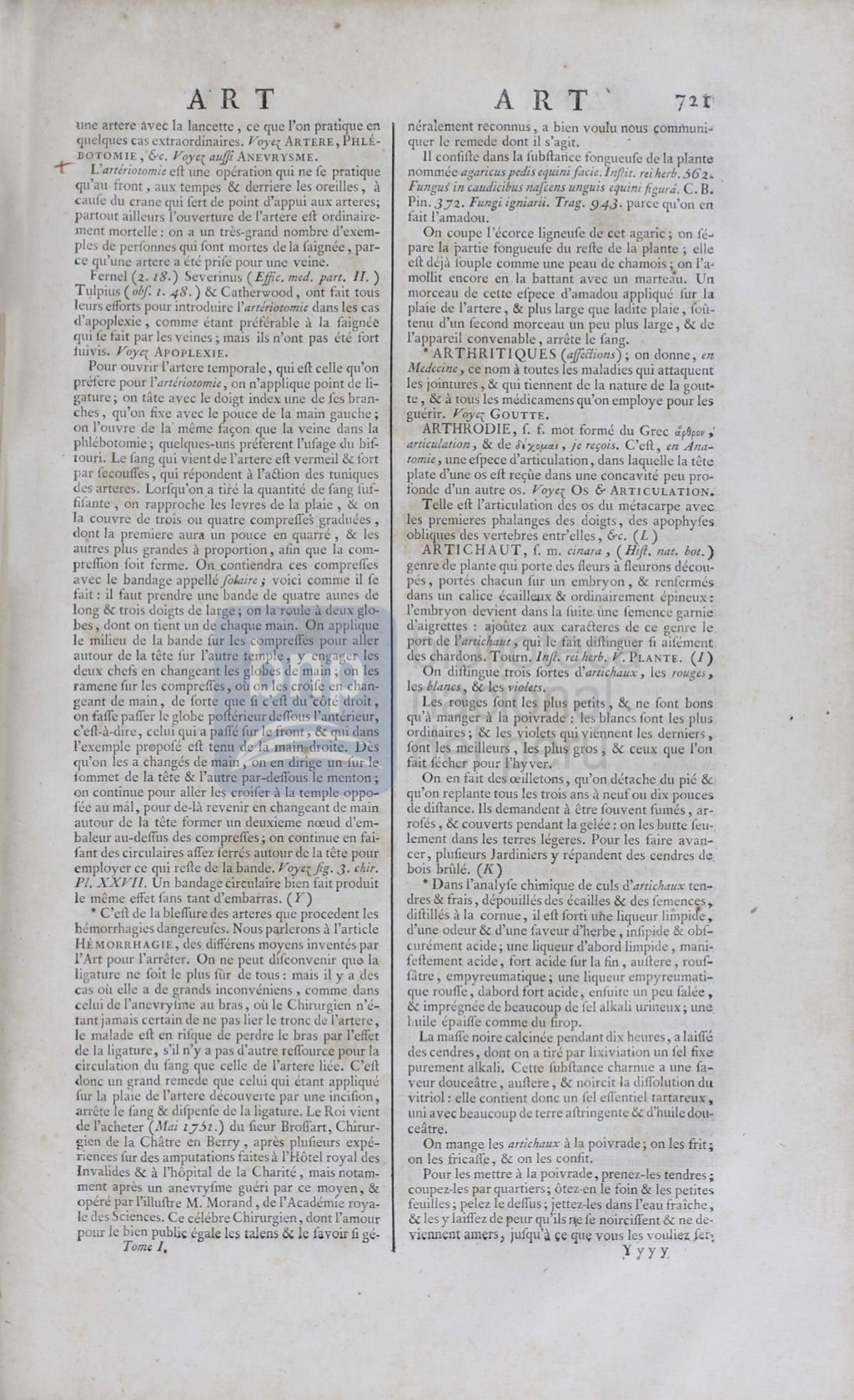
une artere avec la lancettc, ce que
1'011
pratique en
qnelclues cas cll.1:raordinaires.
Voye{
ARTERE, PHLÉ–
.BOTOMIE,
(,·e. Voyet auffi
ANEVRYSME.
~
L'aTdriolomi,
el!: une opération quí ne (e pratique
qu'au from, aux tempes
&
dcrrierc les oreilles, a
cau{c du cranc 'lui (ert de point d'appui aux arteres;
partollt ailleurs l'ouverture de l'artere efi ordinaire–
ment mortelle: on a un tres-grand nombre d'exem–
pies de perforll1es qui (ont mortes de la (aignée , par–
ee qu'une artere a été prí(e pour une veine.
Fernel
(.2.
l8.)
Severínus
(EfJie. medo parto
JI. )
Tlllpius
(oh;:
l.
48.)
&
Catherwood, ont faít tous
leurs efforts pour introduire
l'
artériotomie
dans lescas
d'apoplexie, comme étant préférable a la (aignée
'luí (e fait par les veines; mais ils n'ont pas été fort
fuivis.
Voyet
ApOPLEXIE.
Pour ouvrir l'artere temporale, qui eíl celle qu'on
préfere pour
l'artériotomie,
on n'applique point de li–
gature; on tihe avec le doigt index une de (es bran–
ches, qu'on nxe avec le pouce de la main gauche;
on l'ouvrc de la meme fa.,on que la veine dans la
phlébotomie; Cjuelques-uns préfcrent l'u(age du bi(–
romi. Le (ang qui vient de l'arterc eíl vermeil
&
(ort
par (ecoufres , qui répondent
a
l'aél:ion des tuniqucs
des artercs. Lor(qu'on a tiré la quantité de (ang (uf–
fi(ante , on rapproche' les levres de
la
plaie ,
&
on
la couvre de trois ou quatrc compreKes gradnées ,
dont la premiere aura un pouce en quané,
&
les
autres plus grandes
a
proportion, afin que la com–
preíIion (oit ferme. OR. contiendra ces comprefres
avec le bandage appellé
Jolaire;
voici commc il (e
fait: il faut prendre une bande de c¡uatre aunes de
long
&
trois doigts de large; on la 'J'oule
a
deux glo–
bes, dont on tient un de chaque main. On applic¡ue
le miliell de la bande (ur les comprefres pour aller
autour de la tete (ur l'autre temple, y engager les
deux chefs en changeant les globes de main; on les
ramene (m les compreKes, 011 on les croi(e en chan–
geant de main, de (orte que fi c'eíl dll 'coté droit,
on faire pairer le globe pofiérieur deirous l'antérieur,
e'efi-a-dire, cclni qui a paRe (ur le front,
&
c¡ui dans
l'exemple pro>po(é e!1: tenn de la main droite. Des
qu'on les a changés de main, on en dirige un (ur le
10mmet de la tete
&
l'autre par-defrous le menton ;
on continue pour aller les croi(er a la temple oppo–
fée au mal, pour de-la revenir en changeant de main
autour de la tete former un deuxieme nneud d'em–
baleur au-deirus des compreires; on continue en fai–
fant des circulaires aKez ierrés alltour de la tete pour
employer ce qui reíle de la bandeo
Voye{fig.
3.
ellir.
Pl. XXVlI.
Un bandage circl11aire bien fait prodtút
le meme effet fans tant d'embarras.
(Y)
*
C'el!: de la bleirure des arteres que procedent les
hémorrhagies dangereufes. Nous parlerons a l'article
HÉMORRHAGIE, des différens moyens invcntés par
l'Art pOli!' l'arreter. On ne peut di(convenir que la
ligature ne (oít le plus mr de tous: mais il
y
a des
cas oll elle a de grands inconvénicns, comme dans
ce/ui de l'anevryfine au bras, Ol! le Chinugien n'é–
tant jamais certain de ne pas lier le tronc de l'artere,
le malade eíl en ri('lue de perdre le bras par ]'effet
de la ligamre,
s'il
n'y a pas d'autre reirource pour la
circulation du (ang que celle de l'artere liée. C'el!:
donc un grand remede c¡ue celui 'lui étant appli'lué
(m la plaie de I'artere découvel1e par une incifion,
ancte le fang
&
difpen(e de la ligature. Le Roi vicnt
de l'acheter
(.lI1ai
l7.5Z.)
dll fiem Brofrart, Chirur–
gien de la Chatre en Berry , apres plufieurs expé–
riences (m des amputations faites
a
I'Hotel royal des
Invalides
&
a
l'hopital de la Charité, mais notam–
ment apres un anevryfme guéri par ce moyen,
&
opéré par !'illuílre M. Morand, de I'Académie roya–
le des Sciences. Ce célébre Chinugien, dont I'amour
pOll1' le bien publie égale 1
S
talens
&
le íavoir
íi
gé-
Tome 1,
ART
néralement reconnus, a bien vouln nous cOl1uhuni·
quer le remede dont
il
s'agit.
-
Il confiíl:e dans la (ubl!:arice fongueu(e de la plante
nommée
agariellS
p~disequinifocie.lnjlit.
roilurh.
.56.2.
Fungus in eaudicihus naJcens unguis equini figurd_
C.
B.
Pino
37.2.
Fallgi igniarii. Trag.
943.
paree qu'on en
fait l'amadou.
On coupe l'écorce ligneufe de cet agaric; on
fé..
pare la partie fongueu(e du reíl:e de la plante; elle
eíl déja (ouple comme une peau de chamois ; on I'a–
mollit encore en la battant avec un marteau. Un
morcean de celte e(pcce d'amadou appliqué (ur la
plaie de l'anere ,
&
plus large que ladite plaie, fOll–
tenu d'un (econd morceau un peu plus large,
&
de
l'appareil convenable, arrcte le (ang.
*
ARTHRITIQUES
(affiaiollS);
on donne,
en
Medecine>
ce nom a toutes les maladies qui attaquent
les joinnmc>s,
&
'luí tiennent de la namre de la gout–
te,
&
11 tous les médicamens qu'on employe pour les
guérir.
Voye{
GOUTTE.
ARTHRODIE,
f.
f. mot fomlé du Gree
rip9pov;
articula/ion>
&
de
t.'xop.a./
,
je
re~ois.
C'eíl:,
en Ana–
tomie,
lLlle e(pece d'articularíon, dans lac¡uelle la tete
plate d'une os
elt
re.,lle dans une concavité peu pro–
fonde d'un atltre os.
Voye{
Os
&
ARTICULATION.
Telle efi l'articulation des o_s du métacarpe avec
les premieres phalanges des doigts, des apophy(es
obliques des vel1ebres entr'elles,
&e.
(L)
ARTICHAUT, f. m.
cinara ,
(Hifl.
Tlat. hot. )
genre de plante qui porte des f1eurs
a
f1eurons décou–
pés, pOl1és ehacun (ur un embryon,
&
renfermés
dans un calice écailleux
&
ordinairement épineux :
l'embryon devient dans la (uite une (emence garnie
d'aigrettes : ajolitez aux caraél:eres de ce genre le
port de
l'artiehaut,
qui le fai! dillinguer fi ai(ément
des chardons.
Tourn.lnjl. rei herb. V.
PLANTE.
(1)
On diíl:ingue trois (ortes
d'artÍehallx,
les
rouges
~
les
bLanes,
&
les
lIiolets.
Les rouges (ont les plus petits ,
&
ne (ont bons
qu'a manger a la poivrade : les blancs (ont les plus
ordinaires;
&
les violets C¡lÚ viennent les derniers,
(ont les meilleurs , les plus gros,
&
ceux que 1'0n
fait (écher pour l'hyver.
On en fait des neilletons, qu'on détache du pié
&
qu'on replante tousles trois ans a neufou dix pouces
de difiance. lIs demandent
a
etre (ouvent flllUés, ar–
ro(és,
&
couverts pendant la gclée : on les butte (cu–
lement dans les terres légeres. Pour les faire avan–
cer, plufieurs
J
ardiniers y répandent des cendres de
bois brltlé.
(K)
*
Dans I'analpe chímiql1e de culs
ú'atticlwlIx
ten–
dres
&
frais, dépouillés des écailles
&
des (emences ,
diílillés
a
la cornue, il el!: (0l1i une liqueur limpide,
d'une odeur
&
d'tLlle (aveur d'herbe, infipide
&
ob(–
curément acide; une liqueur d'abord !impide, mani–
feílement acide, fort acide (ur la fin , auílere, rouf–
catre, empyreumatique; une liqlleur empyreumati–
que rouire, dabord fort acide, enCuite un peu (alée ,
& imprégnée de beaucoup de (el alkali urineux; une
huile épaiKe comme du firop.
La maire noire calcinée pendant rux heures, alaiJré
des cendres, dont on a tiré par lixiviation un (el fixe
puremenr alkali. Cette (ubílance charnue a une (a–
veur douceatre, aul!:ere,
&
noircit la diJrollltion du
vitriol : elle conrient done un (el eirenriel tartareux ,
lLlli avec beaucoup de tene aíl:ringente
&
ú'huile dou:
ccatre.
On mange les
articllaux
a
la poivrade; on les frit;
on les fricafre,
&
on les confito
Pom les mettre
a
la poivrade, prenez-les tendres ;
coupez-les par quartiers; otez-en le foin
&
les petites
feuilles; pelez le defrlls; jettez-les dans l'eau fraiche,
&
les y laiKez de peur qu'ils n,e (e noirciirent
&
ne de–
viennent amers, ju(clu'a
~e
que vous les voulie7.
fer~
';lYYY,
















