
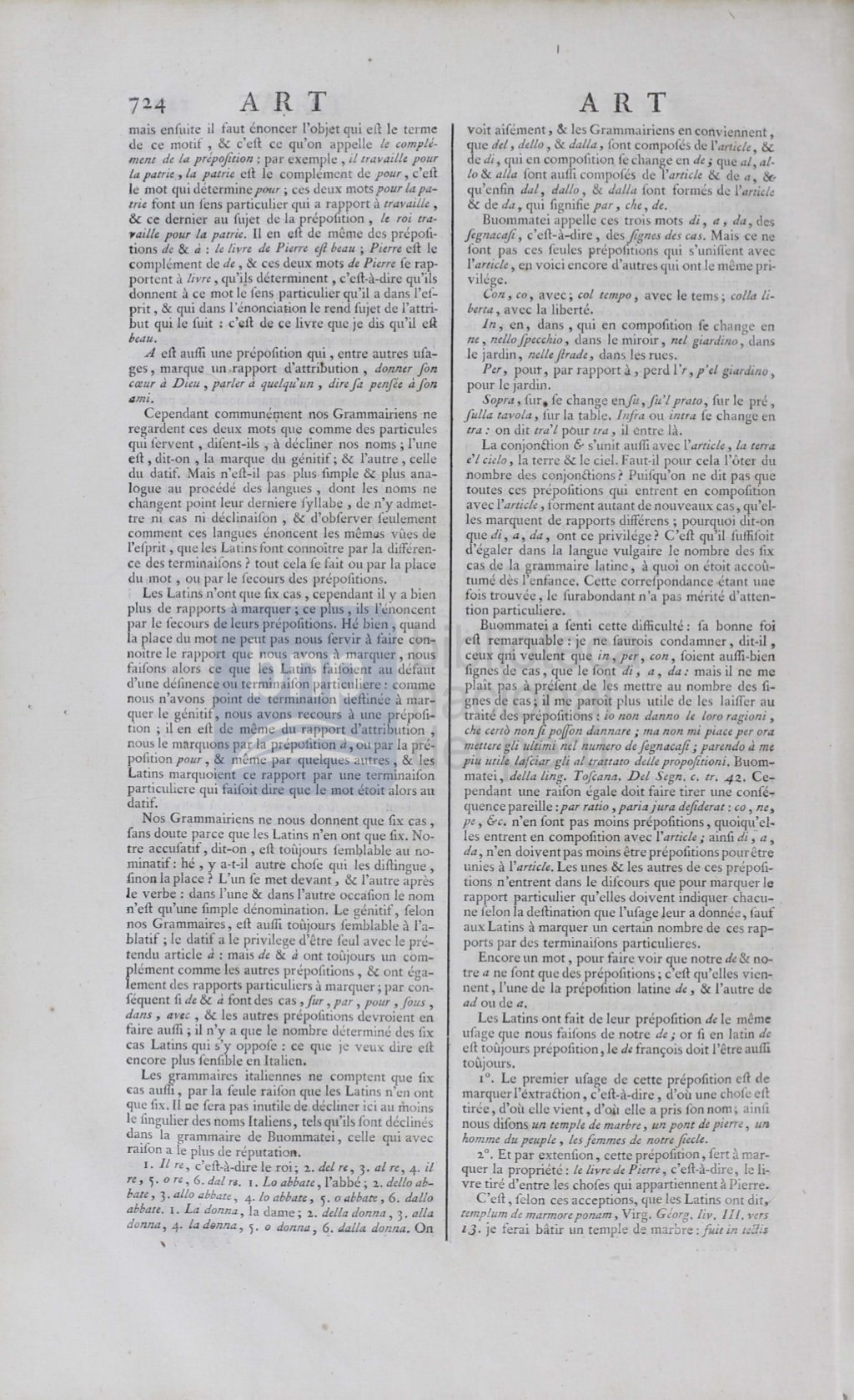
ART
mais enfuite il faut énonccr l'objet qui eil: le terme
de ce motif ,
&
c'eil: ce qu'on appelle
le eomplé–
ment de la prépojition
:
par exemple ,
il travaille pour
la patrie, la patrie
eíl: le complément de
pour,
c'eH
le mot qui détermine
paur
;
ces deux mots
pOla la pa–
trie
font un úms particulier qui a rapport a
travaiLl. ,
&
ce dernier au fujet de la prépoíition,
le roi tra–
."aiLle pour la patru. Il
en eil: de meme des prépoíi–
rions
de
&
ti
:
le livre de Pierre
ejl
beau
;
Pi"re
eíl: le
complément de
de
,
&
ces deux mots
de Pierre
fe rap–
portent a
livre
,
qu'ils déternlinent , c'eíl:-a-clire qu'ils
donnent a ce mot le fens particulier qu'il a dans I'ef–
prit,
&
qui dans l'énonciarion le rend fujet de l'attri–
but qui le fuit : c'eíl: de ce livl'e que je dis qu'il di
beau.
A
eil: auffi une prépoíition qui, entre autres ufa–
ges, marque un .rapport d'attriburion,
donner fon
clEur
ti
Dieu
,
parür
ti
quelqu'
UTl,
dire fa ptlZfée
ti
f on
IZmi.
Cependant communéIf1ent nos
Grammairie.ns'ne
regardent ces deux mots que comme des parncules
qui fervent , difent-ils , a décliner nos noms ; I'une
eíl: , dit-on , la marque du génitif;
&
I'autre, celle
du datif. Mais n'eíl:-il pas plus funple
&
plus ana–
logue au procédé des langues, dont les noms ne
changent point leur derniere fyllab , de n'yadmel–
tre ni cas ni déclinaifon ,
&
d'obferver feulement
comment ces langues énoneent
les
memas Vl¡eS de
l'efprit, que les Latins font connoitre par la di1féren–
ce des terminaifons
?
tout cela fe fait ou par la place
du mot , ou par le fecours des prépoíitions.
Les Latins n'ont que íix cas , cependant il ya bien
plus de rapports
a
marquer ; ce plus, ils I'énoncent
par le fecours de leurs prépoíitions. Hé bien, quand
la
place du mot ne peut pas nous fervir a faire eon–
noitre le rapport que nous avons
a
marquer, nous
faifons alors ce que les Latins faifoient au défaut
d'une définence
011
terminaifon particuliere : comme
nous n'avons point de terminaifon deftinee a mar–
quer le génitif, nous avons recours a une prépoíi–
lion ; il en efr de meme du rapport d'attribution ,
nous le marquons par la prépuíition
ti,
ou par la pre–
poíition
pour
,
&
meme par quelc¡ues autres ,
&
les
Latins marquoient ce rappon par une terminaifon
particuliere qui faifoit clire que le mot étoit alors au
darif.
Nos Grammairiens ne nous donnent que íix cas ,
fans doute parce que les Latins n'en ont que íix. No–
tre aecufatif, dít-on , eíl: tOlljours femblable au no–
minatif: hé ,
Y
a-t-il autre chofe qui les díftingue ,
finon la place? L'un fe met devam ,
&
I'autre apres
le verbe : dans I'une
&
dans l'autre oceaíion le nom
n'eft qu'une íimple dénomÍnation. Le génitif, felon
nos Grammaires, eíl: aulli toujours femblable
a
l'a–
blatif ; le datif a le privilege d'etre feul avec le pre–
tendu artide
ti :
mais
de
&
ti
ont tolljOurS un eom–
plément comme les autres prépoíitions ,
&
ont éga–
lement des rapports particuliers a marquer ; par eon–
féquent íi
de
&
ti
font des cas,
fur ,par, pour ,fous ,
dans, av"
,
&
les autres prépofirions devroiem en
faire auffi ; il n'y a que le nombre déterminé des íix
eas Latins qui s'y oppofe : ce que je veux dire eft
encore plus fenfible en ltalien.
Les grammaires italiennes ne comptent que
[DC
Eas auffi, par la feule raifon que les Latins n'en ont
que íix. Illle fera pas inutile de décliner ici au inoins
le íingtúier des noms Italiens, tels qu'ils font déclinés
da!ls la grammaire de Buomrnatei, celle
qui
avec
raifon a le plus de réputarioI1.
l.
II re,
e'eft-a-clire le roi;
2..
del re,
3.
al",
4-
il
re,
5.
o r.,
6.
dal
(d.
l.
Lo abbate,
l'abbé;
2..
dello ab–
bate,
3·
aILo abbate,
4.
lo abbate,
5.
o abbate
, 6.
dallo
abbate.
l.
La donna,
la
dame;
lo.
della donna
,
3.
alla
donna,
4.
la d9nna,
5.
o donna,
6.
dalta donna.
On
ART
voit aifément,
&
les Grammairiens en conviennent,
que
del, dello,
&
dalla,
font compofés de
I'artide,
&
de
di,
qui en eompoíition fe change en
de
j
que
al al–
lo
&
olla
[ont auffi compofés de l'
anide
&
de
a:
&
qll'enfin
dal, dallo,
&
dalla
fom form's de
l'ar¡i,ü
&
de
da,
qui íignifie
par , elle, de.
Buommatei appelle ces u'ois mots
di, a, da,
des
jegnaetifi,
c'eíl:-a-dire, des
jignes des eas.
Mai ce ne
font pas ces feules prépoíitions qui s'uniíl'ent avec
l'anide,
en voici encore d'autres qui
ontle
meme pri–
vilége.
Con , 'o ,
avec;
col tempo,
avec le tems;
colla li–
berta,
avcc la liberté.
In,
en, dans , qui en compofition fe change en
no, nellofpe,,¡'io,
dans le miroir,
ml giardillo,
dans
le jardin,
nell.jlrade,
dans les rues.
Pe¡,
pour, par rapport a , perd
l'r,
p'e! giardino,
pour le jardín.
Sopra,
fur. fe change
enfil,
flt'l prato,
fur le pré,
fulla tavoLa,
fur la table.
JI/fra
ou
imra
fe ehangc en
tra,'
on dit
tra'l
pour
ua,
il Cntre la.
La conjonB:ion
&
s'unit auffi avee l'
artide, la terra
e'l cido,
la terre
&
le
ciel. Faut-il pour cela I'oter du
nombre des conjonB:ions? Puifqu'on ne dit pas que
toures ces prépoíitions qui entrent en compofition
avec
l'anide,
forment alltant de nouveaux cas, qu'el–
les marquent de rapports différens ; pourquoi dit-on
que
di, a, da,
ont ce privilége? C'eft qu'il fuf!ifoir
d'égaler dans la langue vulgaire le nombre des
fDe
eas de la grammaire latine, a quoi on étoit aCCO\I–
turné des I'enfance. Cette eorrefpondanee étam une
fois trouvée, le furabondant n'a pa3 mérité d'atten–
tion particuliere.
Bllommatei a fenti cette difficulté: fa bonne foi
eíl remarquable: je ne faurois condamner, dit-il ,
ceux qni veulent que
in, per, con,
foient auili-bien
íignes de cas, que le font
di, a, da,'
mais il ne me
plait pas a préfent de les mettl'e au nombre des íi–
gnes de cas; il me paroit plus utile de le
lai{fer
au
traité des prépofltions :
io non danno
le
loro ragioni ,
che eerto nonji poJliJll dannare
;
ma non mi piace pe¡ ora
mellere gli rtltÍmi ml numero de fegnacaji
;
paruzdo
a
me
piu raile lafciar gli al trattato detle prop'?fitioni.
Buom–
matei,
della ling. T*ana. D el Segn.
c.
tr.
42.
Ce–
pend¡¡nt une raifon ¿gale doit faire tirer une confé–
quence pareille
:par ratio ,pariajara dejiderat: ca, ne,
pe, &e.
n'en font pas moins prépofitions, quoiqt(el.
les entrem en eompoúrion avee
l'anide;
ainíi
di, a,
da,
n'en doivent pas moins etre prépoíitions pouretre
unies
a
l'
anide.
Les unes
&
les autres de ces prépofi–
tions n'entrent dans
le
difcours que pour marquer
16
rapport paniculier qu'elles doivent indiquer ehacu–
ne lelon la deilination que l'ufage ¡eur a donnée, falú
aux Latins a marquer un certain nombre de ces ra
p–
ports par des terminaifons particulieres.
Encore un mot , pour fairevoir que notre
de
&
no–
tre
a
ne fom que des prépoíitions; c'eft qu'elles vien–
nent, l'une de la prépoíirion latine
de,
&
l'autre de
ad
oude
a.
Les Latins ont fait de leur prépofition
de
le meme
ufage que nous faifons de notre
de;
or fi en larin
de
efr toujours prépoíition, le
de
fran~ois
doit l'etre auffi
tOlljOurS.
10.
Le premier ufage de eette prépoíition eft de
marquer l'éxtraB:ion, c'eft-a-díre , d'ou une chofe eíl:
tirée, d'ol! elle vient , d'Oll elle a pris fon nom ; ainfi
nous difons
un temple de marbre, un pOn! de pierre,
l/TI
homme du peuple, les fimmes de notre jieele.
2.0.
Et par exteníion, cette prépoíition ,fert
a
mar–
quer la propriété:
le
livre de Pierr.,
c'eft-a-díre, le li–
vre tiré d'entre les chofes qui appartiennent
11
Pierre.
C'eft, felon ces acceptions, que les Latins ont dit,
umplum de mannoreponam,
Virgo
G.!org.liv. lll.wrs
l3.
jc ferai biltir un temple de marbre :
¡¡¿it
in
1~f1is
















