
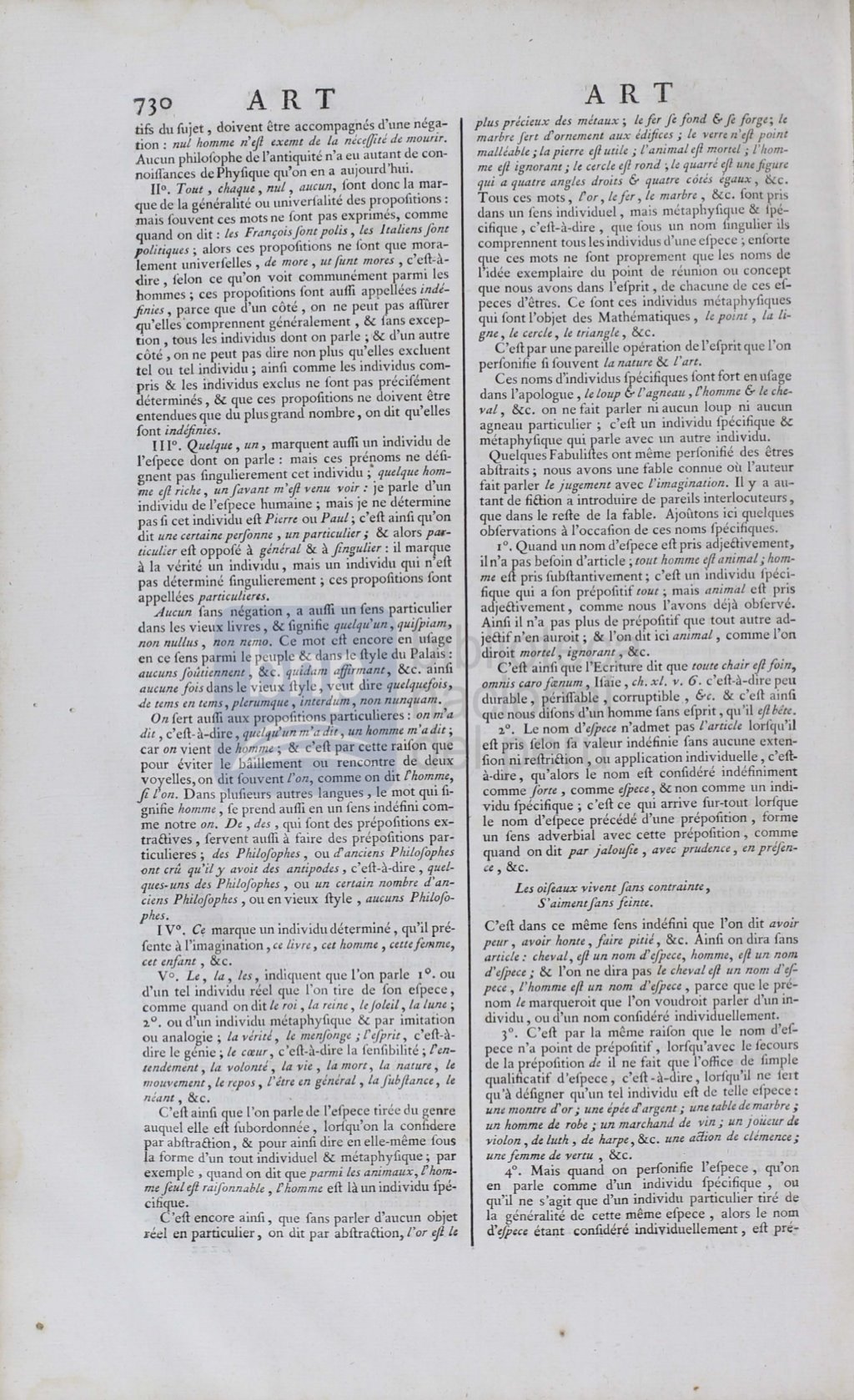
•
73°
ART
tUs
du [ujet, doivent etre accompagnés d'nne néga–
tion:
nul homme n'eJl exemt de la n¿ce(jiul de mourir.
Auenn philorophe de I'antiquité n'a eu amant de eon–
noiífanees dePhyíique qu'on en a aujourd'hui.
lI
o •
TOrit, chaque, nul, aucun,
ront
donc la mar–
que de la généralité on univer[alité des
'pr~politions
:
mais [onvent ces mots ne (ont pas exprimes, comme
quand on dit :
!es Franfoisfo,!t polis
,
les lEaliens font
potitiques
;
alOI"S ces propoíioons ne ront que
~ora
lement univer[elles ,
de more, UE fitnt mores,
Cefi-a–
¿ire, Ielon ce qu'on voit communément parmi les
hommes; ces propo(ltions [ont aulli appellées
indé–
finies,
parce que d'un coté, on ne peut pas aíflLrer
qu'elles 'comprennent généralemenr , & (ans excep–
rion , tous les individus dont on parle; & d'un autre
coté, on ne peut pas dire non plus qu'elles excluent
tel ou tel individu ; ainíi cornme les individus com–
pris & les individus exclus ne (ont pas précifément
déterminés, & que ces propoíitions ne doivent etre
entendues que du plusgrand nombre, on dit qu'elles
font
indijinies.
11 1°.
Quelque, un,
marquent auffi un individu de
re(pece dont on parle: mais ces prénoms ne déli–
gnent pas íingulierement cet individu ;'
quelque hom–
me eJl riclte, unfavant m'eJl venu voir:
je parle d'un
individu de l'erpece humaine ; mais je ne détermine
pas
Ii
cet individu efi
Pierre
ou
Paul;
c'efi ainíi qu'on
dit
une certaine perfonne
,
un particulier
j
& alors
pa,-–
ticulier
efi oppo[é a
générat
& a
Jingulier
:
il marque
a
la vérité un individu, mais un individu qui n'efi
pas déterminé lingulierement ; ces propofitions [ont
appellées
particulierts.
Aucun
fans négation, a auffi un (ens particulier
dans les vieux livres, & íignifie
quelqu'un, quijjJiam,
.non nullus, non nemo.
Ce mot cfi encore en u[age
en ce (ens parmi le peuple & dans le fiyle du Palais :
aucuns joztEiennelll,
&c.
quidam afftrmant,
&c. ainfi
aucune foisdans
le vieux fiyle, veut dire
quelquefois,
de tems en Eems, pterumque
,
interdum, non nunquam.
On
[ert auffi aux propofitions particulieres:
on m'a
.diE,
c'efi-a-dire,
tjllelqll'llnm'adit, /In homme m'adit;
car
on
vient de
homme;
& c'efi par cette raifon que
pour éviter le baillement OH rencontre de deux
vorelles,on dit (ouvent
l'on,
comme on dit
fhomme,
Ji 1Oll.
Dans plufieurs autres langues, le mot qui fi-
gnifie
}tOmme
,
fe prend auffi en un (ens indéfini com–
me notre
on. D e, des,
qui (ont des prépofitions ex–
trafuves, [ervent auífl
a
faire des prépofitions par–
ticulieres;
des Philofophes,
ou
d'anciens Philofophes
ont
CTll
qu'j[
y
avoiE des antipodes,
c'efi-a·dire,
quel–
ques·llns des Philofophes ,
on
un certain nombre d'an–
citlls Philofophes,
on en vieux fiyle ,
aucllns Philofo–
phes.
1
VO.
C~
marque un individu déterminé , qu'il pré–
[ente a l'imagination,
ce
tivre , cet homme, ceuefernme,
cet tnlant,
&c.
yo.
Le, la, les,
indiquent que l'on parle
10.OUd'un te! individu réel que l'on tire de ron erpeee,
comme quand on dit
le roi, la reine,
lt
jolei!, la ¡une ;
2.0.
ou d'un individu métaphyftque & par imitation
ou analogie ;
la vérité,
le
menfollge; l'ifprit,
c'efi-a–
dire le génie;
le
cceur,
c'efi-a-dire la [enfibilité;
l'en–
tendement, la volonté, la yie, la mort, la na/ure, le
mouvement, le repos, t'¿tre en gélléral
,
la fubjlallce, le
n¿allt ,
&c.
.
C'efl:ainft que I'on parle de I'e(pece tiréedu genre
auquel elle efi (ubordonnée, lorfqu'on la coníidere
par abl1:raétion, & pour ainG dire en elle-meme (ous
la forme d'un tout individuel & métaphyfique; par
exemple, quand on dit que
parmi les anilllallx, t'hom–
",;e
felll ejl raiJonnable, l'hamme
efi la un individu [pé–
clfique.
, Cefi enc?re
~irtfi,
que fans parler d'aucun objet
ree! en parocuher. on dit par abfuaétion,l'or
eJlle
ART
plus précieux des métaux; le fer
fe
fond
&
fe jorge; "
marbre ferE d'omemenE
flUX
¿diJiees;
le
yerre n'ejl poim
mallé..bLe; la pierre ejlutile
;
L'
animal
ejl
moml; l'lwm–
me ejl ignorant;
le
e"cle eJl rond
;
t.
quarré
ejl
11m
jigure
qui a quatre angles droits
&
qllaEre códs egaux,
&c.
Tous ces mots,
l'or, !efer, le marbre,
&c. font pris
dans un [ens individuel, mais métaphyfique & ipé–
cifique, c'efi-a-dire, (llle [ous un nom fingulier ils
comprennent tous les individus d'une e[peee ; en(orte
que ces mots ne [ont proprement que les noms de
l'idée exemplaire du point de réunion ou coneept
que nous avons dans l'e(prit, de ehacune de ces e[–
peces d'etres. Ce [ont ces individus métaphyfiques
qui (ont l'objet des Mathématiques,
le point
,
la
li–
gne, le cerele, le triangle,
&c.
C'efl:par une pareille opération de l'e(prit que
1'00
perfonifie fi [ouvent
lanal/lre
&
Cart.
Ces noms d'iodividus [pécifiques (ont fort en ufage
dans l'apologue,
Le
Loup
&
l'agneall, t'lzomme
&
le
ch~
yal,
&c. on ne fait parler
ni
aueun 101lp
ni
allClill
agneau particulier; c'efi un individu [pécifique &
métaphyfique qui parle avec un autre individuo
QuelquesFabulilles ont meme perronifié des etres
abfuaits; nOllS avons une fable connue ou l'auteu!
fait parler
le jugement
avec
l'imagination.
Il
y a au–
tant de fifuon a introduire de pareils interlocuteurs,
que dans le refie de la fable. AjoCttons iei qllelques
ob[ervations a I'occafion de ces noms fpéeific¡ues.
1°.
Quand un nom d'e(peee efl: pris adjefuvement,
iln'a pas be[oin d'article;
tOlil homme
ejl
animal; hOIll–
me
efl: pris [ubfiantivement; e'efi un lI1dividu (péci–
fique qui a ron prépofttif
tout
;
mais
animal
efl: pris
adjeétivement, eomme nous l'avons déja obrervé.
Ainii il n'a pas plus de prépofitif que tout autre ad–
jeétifn'en auroit; & I'on dit ici
animal,
eomme l'on
diroit
morul, ignorant,
&c.
C'efi ainfi que l'Ecriulre dit que
tollte chair eJlfoin,
omnis caro famum,
I[ale,
ch. xl.
V.
6.
c'efr·a-dire peu
durable, périffable, cormptible ,
&e.
& c'efi ainíi
que nous difons d'un homme fans e[prit, qu 'il
eJlbe"te.
2.0.
Le nom
d'ifpece
n'admet pas
l'ardele
lorrqu'il
efl: pris [elon [a valeur indéfinie (ans aucllne exten–
fion
ni
refuiétion , ou application individllelle, c'efl:–
a·dire, qu'alors le nom efi confidéré indéfiniment
eomme
jorte,
comme
ifpece,
& non comme un indi–
vidu [pécifique ; c'efi ce qui arrive fur-tout lorfque
le nom d'e(pece préeédé d'une prépofttion, forme
un [ens adverbial avee cette prépofition, comme
quand on dit
par jalouJie
,
avec prlldence,
m
prlfen–
ce ,
&e.
Les oifeaux yiventfans contrainte,
S 'aimelllfans fiinte.
C'efi dans ce meme [ens indéfini que l'on dit
ayoir
peur, ayoir honte, faire pilié,
&e. Ainfi on dira fans
anicle: cheval, eJllln nom d'ifpece, homme, efl un nom
d'eJPece;
& l'on ne dira pas
le clzevai efl un nom d'ef–
pece, l'holllme
efi
un nom d'ifpece,
parce que le pré–
nom
le
marqueroit que I'on voudroit parler d'un in–
dividu, ou d'un nom confidéré individuellement.
3°.
C'efi par la meme rai[on que le nom d'e[–
pece n'a point de prépofitif, lorfqll'avee le [eeours
de la prépofttion
de
il ne fait que l'offiee de iimple
qualificatif d'e[peee, c'efi-a-dire, lorfqu'il ne felt
qu'a déiigner qu'lIn tel individu efl: de telle e(pece:
um
montre d'or
;
une épée d'argent; une table de marbre ;
un Izomme
de
robe; un marchand de yin; un joiieur de
yiolon, de lzah, de harpe,
&c.
une aélian de climenee;
une fimme d. yertu
,
&e.
4°.
Mais quand on perfonifie I'e[peee, qn'on
en parle cornme d'un individu [pécifique, ou
qu'il ne s'agit que d'un individu partielúier tiré de
la généralité de eette meme e(pece, alors le nom
d'ifPece
étant coniidéré individuellement, efi pré-
















