
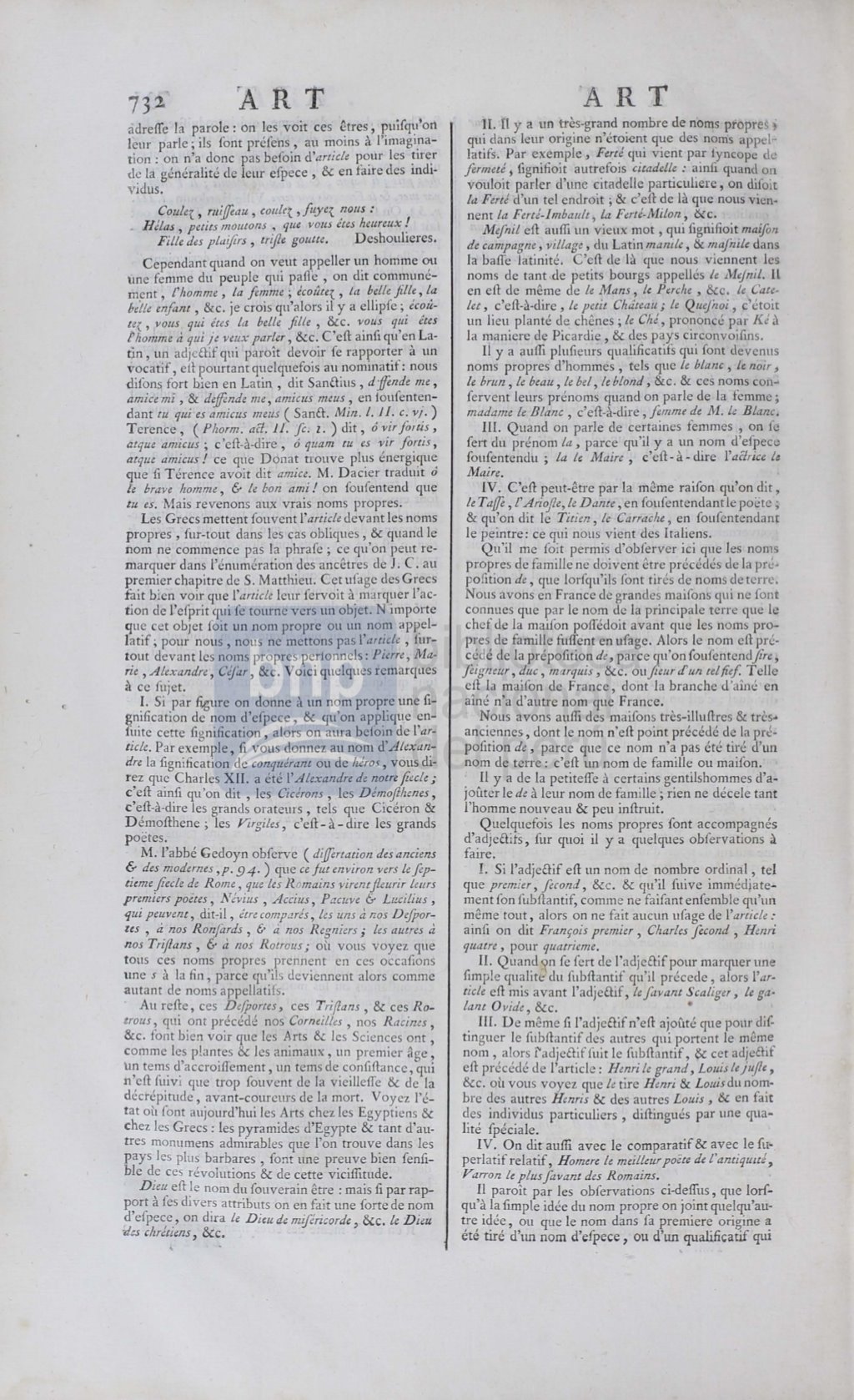
adreífe la parole: on les voit ees &tres,
puif~,'on
leur parle; ils font prélens, au moins
~
I'imag,.na–
tion : on n'a done pas befoin
d'article
~~ur
les
~Ire.r
de la généralité de lenr efpeee ,
&
en taue des mdi–
vidus.
COUÜ{ , miffoau, contr{ ,fuye{ nOlls
:
I
_
H¿las, petits mOItlons
.'
que vous ¿ces hwreux:
Fille des pluijirs, (rifle goutte.
DeshoulIeres.
Cependant quand on veut appeller un homme O'\.l
une femme du peuple qui paíle , on dit eommuné–
ment
l'
homme, La fimme
;
eco/2tet, la beLLe fiLLe, La
beile
e~font
,
&e.
je erois qu'alors il y a ellip{e;
.¿coú–
te{
,
vous qui étes la beLle fiLLe
,
&e.
-v,0us qm ¿teS
fhomme'¡ qui}e veux parler
,
&e.
C'eíl: amú qu'en La–
on, un adjcéhf qui parolt devc;>ir {e
rap\,ort~r
a
un
voeatif,
ea
pourtant quclquefo,s au nommauf: nous
difons fort bien en Latin , dit Sanétius ,
d:!finde me ,
amicemi,
&
deffonde me, amic/ts mws,
en
10u{ent~n
dant
tu qui es amicus me/ts
(Sanét.
Min. L.
JJ.
c.
V}. )
Terenee,
(Plwrm . aé!.
11.
fc.
z. )
dit,
ó
vir fimi!,
átque amicus'
e'eíl:-~-dire ,
ó quam
tu
es vlr flrus,
atque amicusJ
ee que Donat uouve plus énergic¡ue
que íi Térence avoit dit
amice.
M. Dacier tradlllt
ti
le
brave Iwmme,
&
ü
bon ami!
on fou{entend que
tu es.
Mais revenons aux vrais noms propres.
Les Grees menent {ouvcnt l'
articü
devant les noms
propres , {tU-tout dans les cas obliques , & quand le
nom ne commence pas la phra(e; ce qu'on peut re–
marquer dans I'énumération des ancetres de J.
c.
au
premierchapitre de S. Matthieu. Cetu(age des Grecs
fuit bien voir que
l'artic!e
lenr {ervoit a marquer I'ac–
tion de l'efprit C¡lli fe tomne vcrs un objeto N importe
que cet objet {oit un nom propre ou un nom
ap~el
latif; pour nous, nous ne mettons pas l'
arriele
,
tur–
tout devant les noms propres pertonnels:
Pierre, ]l,1a–
Tie ,ALexandre , CéJar,
&c. Voici qllelques remarques
a
ce fujet.
1.
Si par figure on
donne
a un nom propre une ú–
gni6cation de nom d'e(pece, & qu'on applique en–
Cuite cette ugnification, alors on aura beloin de
l'ar–
licie.
Par exemple, íi vous donnez au nom d'
Alexan–
¿re
la ugni6cation de
eonquérant
ou de
Mros
,
vous di–
rez que Charles
xn.
a été l'
Alexandre de nOlre fieele;
c'eíl: ainli qu'on dit , les
Cieérons,
les
D émoJl/¡enes ,
c'eíl:-a-dire les grands orateurs, tels que Cicéron &
D émoíl:hene ; les
VirgiLes,
c'eíl: - a - dire les grands
poietes.
M. l'abbé Gedoyn obferve
(diffortation des anciens
&
des modernes ,p.
94. )
que
ce
FU
environ vers le fip–
ti,me jiecLe de Rome, que les R omains virentfleurir Leurs
premiers poetes, N¿vius
,
Aecius, Pawve
&
L/¿eilins ,
'lui peuvent,
dit-il,
élre compads , Les uns
ti
nos Diffor–
tes
,
ti
nos Ronfards,
&
ti
nos Regniers; Les aUlres
ti
nos Triflans
,
&
ti
IIOS ROlrous;
011
vous voyez que
tous ces noms propres prennent en ces occauons
une
s
a la 6n, parce qu'ils deviennent alors comme
autant de noms appellatifs.
Au reíl:e, ces
D efPortes,
ces
Triflans,
& ces
Ro–
trous,
qni ont précédé nos
CorneiLi.s
,
nos
R aeines ,
&c. font bien voir que les Arts & les Sciences ont ,
comme les plantes & les animaux , un premier age ,
Un tems d'accroiífement, un tems de conliíl:ance, qui
n'eíl: {uivi que trop fouvent de la vieilleífe & de la
décrépiulde, avant-coltl'eurs de la mono Voyez I'é–
tat Ol! (ont aujourd'hui les Arts chez les Egyptiens &
ehezles Grecs : les pyramides d'Egypte & tant d'au–
tres monumens admirables que I'on trouve dans les
pays les plus barbares, {om une preuve bien fenú–
ble de ces révolmions & de cette viciílimde.
D ieu
eíl: .le nom du fouverain erre: mais
Ii
par rap–
port
a
fes dlvers attributs on en fait une (ortede nom
d'e{pece, on dira
Le D i,ude miflricord,
&c.
le
Dúu
7les cltrüi,ns,
&c.
'
'A R T
n.
n
y a un tres-grand nombre de noms propres ,
qui dans leur origine
n'ér~icn~ q~e
des
n~ms
appel
latifs. Par exemple,
Ferte
qlll
v¡ent par tyncope
d~
firmeu;
,lignifioit autrefois
citad,Ue
:
ainú quanu
011
vouloit parler d'une citadelle partieuliere , on difoit
la Ferté
d'un tel endroit ; & c'eíl: de la que nOlls vien–
nem
La Ferté-Imbault, la Ferré-Milon,
&c.
Mejiúl
eíl: auíli un vieux mor , qui úgnifioit
maifon
de eampagne, viLlage
,
du Latin
mantle
,
&
mafmle
dans
la baire latinité. C'eíl: de la que nous viennent les
noms de tant de petits bomgs appellés
le
M<'jniL.
Il
en eíl de meme de
le
Mans
,
Le
Perche,
&c.
Le
Cate–
Lel,
e'eíl:-a-dire,
Le petil Chdteall;
Le
Quejiloi,
c'étoir
un lieu planté de chenes ;
Le
CM,
prononcé par
Ké
a
la maniere de Picardie , & des pays eirconvoiúns.
11
y a auíli plulieurs qualificatifs qui font devenus
noms propres d'hommes , tels que
Le bLane
,
le noir,
le
brull,
le
beau, le bei, le blond
,
&e. & ees noms con-'
fervent leurs prénoms quand on parle de la femme;
madame le Olanc
,
e'eíl:-a-dire,
fimme de
M.
Le
Blanc.
III.
Quand on parle de cenaines femmes , on fe
fert du prénom
la,
paree Cju'il y a un nom d'e{peee
fOllfentendu;
la
Le
Maire,
c'eíl:-a-dire
I'aé!riee Le
Maire.
IV. C'eíl: peut-&tre par la meme raifon qu'on dit,
Le
TafJe ,l'Ariojle,
Le
Dante,
en fou(entendantle poete ;
& qu'on dit le
Titien, le Carrache,
en fou{entendant
le peimre: ce qui nous vient des Italiens.
Qu'il me (oit permis d'obferver ici que les noms
propres de famille ne doivent etre précédés de la
pr~.
polition
de,
que lor{qu'ils {ont tirés de noms de terreo
NOlls avons en France de grandes maifons qui ne Cont
connues que par le nom de la principale terre que le
chefde la mai{on poífédoit avant Cjue les noms pro–
pres de famille fuífent en ufage. Alors le nom eíl: pré–
cédé de la prépoíition
de,
parce gu'on fou{entendjire,
fiigtzeur, duc, marquis,
&c.
oujleurd'un te/fe{.
Telle
e,íI:
!a
~airon
de France, dont la branche d'amé en
ame
11
a d autre nom que France.
Nous avons auíli des maifons tres-illuíl:res & tres.
anciennes, dont le nom n'eíl: point précédé de la pré–
polition
de,
parce que ce nom n'a pas été tiré d'ull
nom de terre: c'eíl: un nom de famille ou maifon.
11
y
a
de la petiteífe
a
eertains gentilshommes c!'a–
jOllter le
de
a leur nom de famille ; rien ne décele tant
I'homme nouveau & pen iníl:ruit.
Quelqncfois les noms propres font accompagnés
d'adjeétits, fur quoi il ya qllelques obCervations
a
faire.
1. Si I'adjeétif ell: un nom de nombre ordinal, tel
que
premier, ficond,
&c. & qn'il {uive immédjate–
ment fon fubíl:antif, comrne ne faifantenfemble qU'tUl
meme tout, alors on ne fait aucnn u{age de l'
artide :
ainú on dit
Frallljois premier, Charles ficond
,
HenTi
quatre,
pour
quarrieme.
II.
Quand
~n
fe fert de l'adjeaifpour marquer une
umple qualitt: du fubíl:antif qu'il précede, alors
I'ar–
tiele
eíl: mis avant I'adjeaif,
le fl,vant Scaliger, Le ga·
lant
o
vide
,
&c.
. m.
De meme
Ii
l'adjeétifn'eíl: ajouté que pour dir.
unguer le (ubíl:antif des autres qui portent le meme
nom , alors f'adjeétif{uit le {lIbílantif, & cet adjeétif
eíl: précédé de I'artide:
Henri
Le
grand, Louis Le
}11",
&c. Ol.! vous voyez que
le
tire
Henri
&
Louisdu
nom–
bre des autres
Henris
& des autres
Louis
,
& en faít
des individus particuliers , diíl:ingués par une
qua~
lité fpéciale.
IV. On dit auffi avec le comparatif& avec le fu–
perlatifrelatif,
Homere
Le
meiUeurpoete
tfe
L'anciqulté,
Varron le plusfavant des Romains.
Il paroit par les ob{ervations ci-deífus, que
lorf~
qu'a la úmple idée du nom propre on jointquelqu'au–
tre idée, ou que le nom dans fa fremiere origine a
été tiré d'un nom d'ef¡,'ece, ou d un qualificatif qui
















