
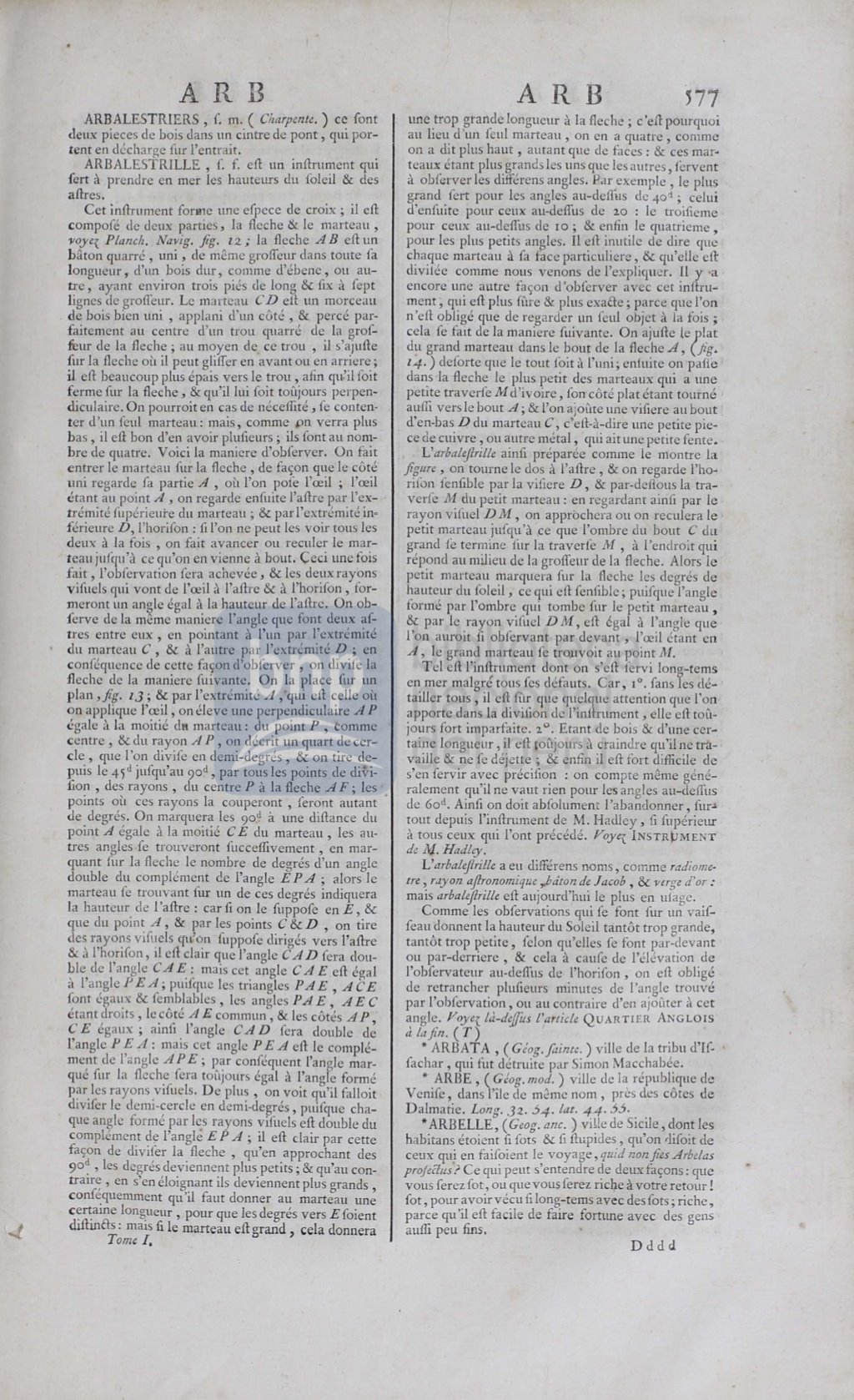
ARB
ARBALESTRlERS , f. m. (
Cliarpenle.
)
ce font
deux pieces de bois dans un cintre de pont , qui por–
tent en décharge fur l'entrait..
.
ARBALESTRILLE ,
t:
f.
efr un mfrntment ql11
fert a prendre en mer les hauteurs du {oleil
&
des
afues.
Cet infrrument fonille une efpece de croix; il efr
compofé de deux parties, la fleche
&
le marteau,
yoye{ Plancll. Nal'ig. fig.
Z2;
la fleche
A B
efr un
baton qualTé , uni, de meme groífeur dans tonte fa
longueur, d'UD bois dur, comme d'ébene, ou au–
tre, ayant environ trois piés de long
&
fix a fept
lignes dc groífeur. Le marreau
e
D
eH un morceau
de bois bien uni , applani d\m coté,
&
percé par–
faitement au centre d'un trou quarré de la grof–
feur de la fleche; au moyen de ce trou , il s'a)ufre
fur la fleche Oll il pent gliífer en avant ou en arnere;
il eíl: beaucoup plus ép"is vers le trou , afin qn?il foit
ferme fur la fleche,
&
qu'illui
Coit
totljours perpen–
diculairc. On pourroit en eas de néceffité , fe conten·
ter d'un fcul marteau: mais, comme pn yerra plus
bas, il ea: bon d'en avoír plufieurs; ils Cont au non:–
bre de quatre. Voici la maniere d'obferver. On falt
entrer le marteau fur la fleche, de faeron que le coté
uni regarde fa partie
A
,
oll l'on pole l'reil ; l'reil
étant an point
A,
on regarde enCuite l'ail:re par l'ex–
trémité fupérieui'e dn marteau ;
&
par l'exu'émité in·
férieure
D,
l'horifon :
íi
I'on ne peut les voír tous les
deux a la fois , on fait avancer on reculer le mar–
lean jufqu'a ce qu'on en vienne
a
bont. Ceci une fois
fait, l'obCervation fera achevée,
&
les deuxrayons
vifuels qui vont de l'reil
a
l'afue
&
a l'horiCon , for–
meront un anole égal
a
la hauteur de l'aíl:re. On ob–
ferve de la meme maniere ['angle que font deux aC–
tres entre eux, en pointant
a
['un par l'extrémité
du marteau
e
,
&
a
l'autl'e par l'extrémité
D
;
en
conCéquence de cette faeron d'obferver , on divile la
fleche de la maniere Cuivante. On la place Cm un
plan
,fig.
Z3;
&
par l'extrémité
A
,qui efr celle oll
on appliqlle l'reil , on éleve une perpendiculaire
A P
égale a la moitié da marteau: du point
P
,
tomme
centre,
&
du rayon
A P
,
on décrit un quart de cer–
ele, que 1 'on divife en demi-degrés,
&
on tire de–
puis le 45
d
juCqu'au 90d, par tous les points de divi–
fion , des rayons , du centre
P
a
la fleche
A F;
les
points 011 ces rayons la couperont , {eront autant
de degrés. On marquera les 90d
a
une difrance du
point
A
égale
a
la moitié
e
E
du marteau , les
3U–
tres anales
Ce
trouveront fucceffivement, en mar–
Cfuant fi'lr la fleche le nombre de degrés d'un angle
double du complément de l'angle
EPA;
alors le
marteau /e trouvant Cur un de ces degrés indiquera
la hauteur de l'afrre : cal' fi on le fuppofe en
E,
&
que du point
A,
&
par les points
e
&D
,
on tire
des
r~yo~s
vifuels
qu'~n
Cuppo{e dirigés vers l'ail:re
&
a
1honfon, 11 eíl: clalI que l'angle
e
A D
Cera dou–
ble de l'angle
CAE:
mais cet angle
e
A E
efr égal
a
l'angle
P E A;
puiCque les triangles
PA E A
e
E
fom égaux
&
femblables, les angles
PA E
'
A E
e
étantdroits, lecoté
A Ji
commun,
&
les cotés
AP
e
E
égaux ; ainfi l'angle
e
A D
fera double
d~
l'angle
P E A:
mais cet angle
P E A
eíl: le complé–
ment de l'angle
A
PE;
par conféquent l'angle mar–
qué fuI' la
flech~
fera toüjours égal
a
I'angle formé
par les rayons vlfuels. D e plus, on voit qu'il falloit
divifer le demi-cercle en demi-degrés, pu.ifque cha–
que an
9
le formé par les rayons vifuels efr double du
complement
d~
I'angle
E P A
;
il
eíl: clair par cette
faeron de diviler la fleche, qu'en approchant des
90~
,
les degrés deviennent plus petits;
&
qu'au con–
tralre , en s'en éloignant ils deviennent plus grands
conf~(¡uemment
qu'il faut donner au marteau
un~
c~n:ame
lon&ueur , pour <jlle les degrés vers
E
Coient
dlÍÜJlétS: malS fi le martean efr grand , cela donnera
Tome
J.
ARB
tille trop gtandelonguem
a
la fleche; c'efrpourquoi
au [jeu d'un feul marteau, on en a <jllatre, comme
on a dit plus haut , alltant que de faces:
&
ces mar–
teaux étant plus grands les uns <jlle les autres, lcrvent
a obCerver les différens angles. Pdr exemple , le plus
grand ferr pour les angles au-deífus de
4od ;
celui
d'enfuite pour ceux au-deífus de 20 : le troifieme
pour ceux au-deílus de 10;
&
enfin le quatrieme,
pom les plus petits angles. Il efr inutile de dire <jlle
chaque marteau
a
fa face particuliere,
&
qu'elle efr
divilée comme nous venons de l'expliquer. Il y ·a
encore une autre fa<;on d'obCerver avec cet inftru–
ment, qui eíl: plus fllre
&
plus exaéte; parce que l'on
n'eíl: obligé que de regarder un Ceul objet
a
la fois;
cela fe faít de la maniere ftúvante. On ajufre !eplat
du grand marteau dans le bout de la fleche
A,
( jg.
z+ ) deforte <jlle le tout foit
a
l'uni; en/uite on pafie
dans la fleche le plus petit des marteaux qui a une
petite traverfe
M
d'ivoíre, fon coté plat étant tourné
auffi vers le bollt.A;
&
l'on ajOtlte une vifiere au bout
d'en-bas
D
du marteau
e,
c'eíl:-a-dire une petite pie–
ce de cuivre, ou autre métal, qui aitune petire fente.
L'arbaleflrille
ainfi préparée comme le montre la
figure,
on toume le dos
a
l'afrre,
&
on regarde l'ho–
rifon Cenfible par la vifiere
D,
&
par-deílous la tra–
verfe
M
du petit marteau : en regardant ainfi par le
rayon vifuel
D M,
on approchera ou on reculera le
petit marreau juCqu'a ce que l'ombre du bout
e
da
grand fe termine {ür la traverfe
M
,
a
l'endroit qui
répond au milieu de la groífem de la fleche. Alors le
petit marteau marquera Cur la fleche les degrés de
haureur du {oleil, ce qui eíl: Cenftble; puif<jlle l'angle
formé par l'ombre qui tombe fur le petit marteau •
&
par le rayon vifue!
D M
,
efr égal
a
l'angl'e que
1'0n alU'oit fi obCervant par devant, l'reil étant en
A,
le grand marteau fe tro!lvoit au point
A-f.
Tel efr l'infuument dont on s'eíl: lervi long-tems
en mer malgré tous Ces défauts. Cal',
l°.
fans les dé–
tailler tous, il ell: fllr cJue <jllelque attention que ['on
apporte dans la divifion de l'inLtrument, elle efr tOtl–
jours fort imparfaite. 2
O.
Etant de bois
&
d'une cer–
taine longueur , il ell: tOltjours
a
craindre qu'il ne
trá–
vaiHe
&
ne Ce déjette ;
&
enfin il efr fon difficile de
s'en fervir avee précifion : on compte meme géné–
ralement qu'il ne vaut rien pOlU' les angles au-deífus
de 60
d •
Ainfi on doit abColument l'abandonner, Cm"
tout depuis I'infuument de M. Hadley , fi fllpérietlI
a
tous ceux qui l'ont précédé.
Voye{
lNsTRI;MENT
d~
M.
Hadley.
L'
arbaleJlrille
a eu différens noms, comme
radiome–
tre, rúyon ajlronomique
~bdton
de]acob
,
&
l'trge d'or :
mais
arbalejfrille
efr aujourd'hui le plus en ulage.
Comme les obCervations qui fe font fur un vaiC–
feau donnent la hauteur du Soleil tantot trop grande,
tantot trop petite, felon qu'eHes
Ce
font par-devant
ou par-derriere,
&
cela
a
caufe de l'élévation de
l'obCervateur au-deífus de I'horifon, on efr obligé
de retrancher plufieurs minutes de I'angle trouvé
par l'obfervation, ou au contraire d'en ajouter a cet
angle.
Poye{ la-d1]ils l'article
QUARTIER
ANGLOIS
a
la fin. (T)
~
ARBATA , (
Clog. Jainte.
)
viHe de la tribu d'IC–
fachar, qui filt détruite par Simon Macchabée.
*
ARBE, (
Céog.modo
)
ville de la républi<jlle de
VeniCe, dans l'lle de meme nom, pn!s des cotes de
Dalmatie.
Long.
32.
.s+
lato
4+
.s.s.
•ARBELLE,
(Ceog. anc.
)
viLle de Sicile , dont les
habitans étoienr
íi
fots
&
fi íl:upides, <jll'on rliCoit de
ceux qui en faifoient le voyage,
quid nonfos Arbelas
proJeaus'?
Ce 'lui peut s'entendre de dem( fa<;ons: que
vous Cerez fot, ou que vousferez riche avotre retour
!
fot, pour avoirvécu fi long-tems avec des
Cots;
riche,
parce c¡u'il efr facile de faire fortune avec des gens
auffi peu fins.
Dddd
















