
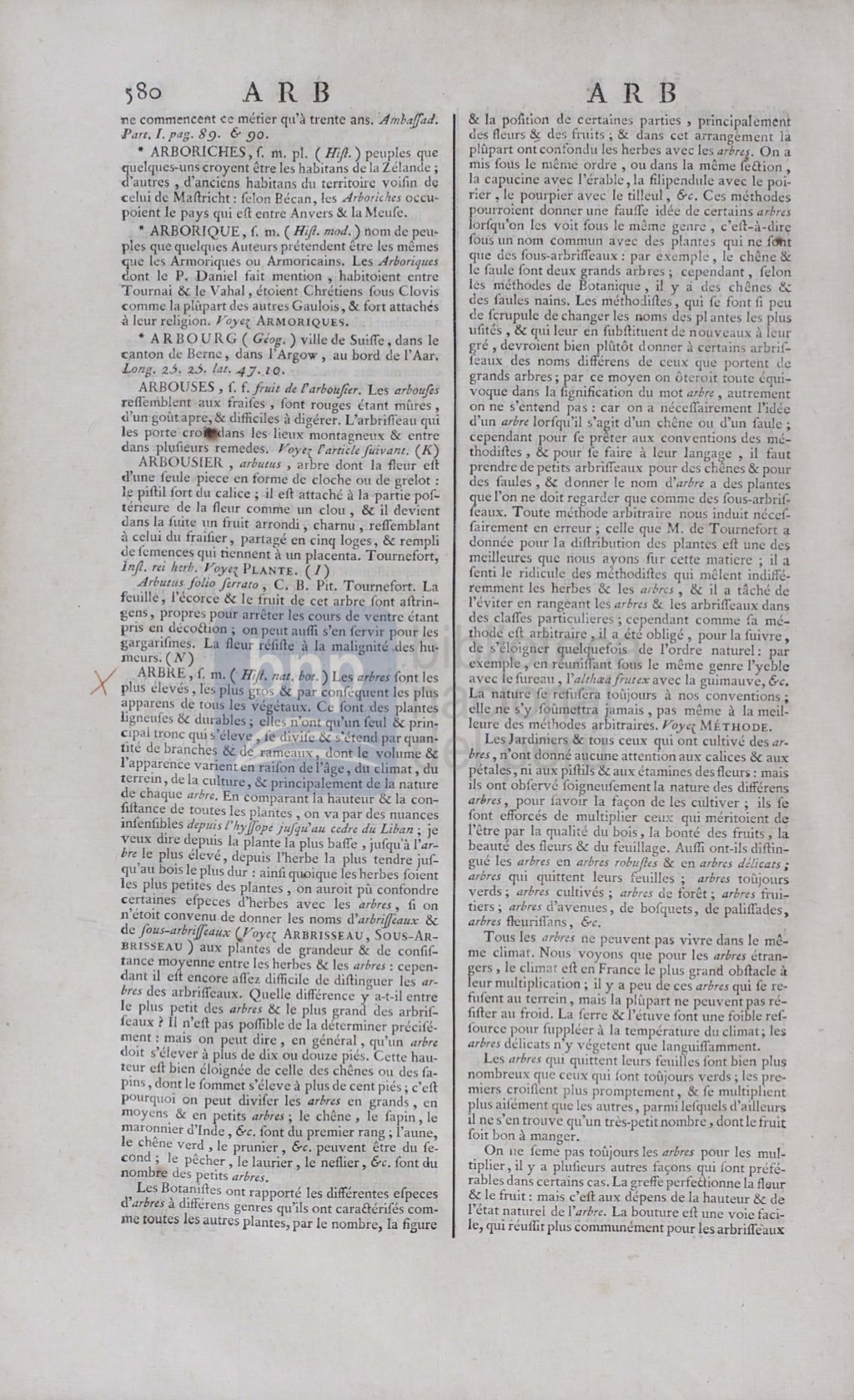
ARB
ne commeocel'lt ce métier qu'a trente ans.
A1TI~a.Jfad.
Pare. [.pag.
89·
&
90 .
*
ARBORICHES,
f.
1\1.
pI.
(Hij!.)
peuples que
quelc¡ues...
u~s
w;>yent
~tr.e
les
haDitan~ d~
la
Zé~ande
;
¿'autres , d anClens habaans du terntou·e. vOllin de
celui de Mafuicht: [elon Bécan, les
ArboflChes
occu–
poient le pays qui efi entre Anvers & la Meu[e.
*
ARBORIQUE, [. m.
(!fij!.
mod)
nom de
peno
pIes que quelques AlIteurs
pret~n~ent
etre les
m~mes
que les Armoriques
o~ AI1no~calns. L~s
:1rboruf'tes
dont le P. Daniel falt mentton , haDltOlent entre
Tournai
&
le Vahal, étoient Chrétiens {OllS
Clovis
comme la pIltpart des autres GauIois,
&
fort attaehés
.a
leur religion.
Voye{
ARlIlORIQUES.
*
A R BO URG (
Géog.
)
ville de Suilre, dans le
c,anton de Berne , dans I'Argow , au bord de l'Aar.
Long.
2.5. 2.5.
lato
47.
10.
ARBOUSES, [. f.
¡mil de l'arbouJia.
Les
arboufos
J'elfemblent aux frai{es , [ont rOllges étant mí:tres,
<!'un gOlltapre,& difficiles a digérer. L'arbriífeau c¡ui
les porte cro lans les licux montagneux & entre
¿ans pl\l{leurs remedes.
Voye{ l'arricLefuivant.
(K)
ARBOUSIER ,
arblltlls
,
arbre dont la f1eur eít
d'une {eule pieee en forme de c10che Ol! de grelot :
le pifril {ort du calice ;
iI
eil: attaché
a
la partie por.
térieure de la fleur comme un clou ,
&
il devient
dans la (uite un [mit arrondi, charnu , reífemblant
a
celui du fraiiier, partagé en cinc¡ loges,
&
rempll
de [cmences c¡ui riennent
iI
un placenta. Tournefort,
infl. rei h!rb. Voye{
PLANTE.
( 1)
Arbutlis folio flrraro,
C. B. PitoTournefort. La
feuille, l'écorce
&
le fmit de cet arbre {ont ail:rin–
gens, propres pour
arr~ter
les eours de ventre étant
pris en d¿coébon; on peut auffi s'en (ervir pour les
gargarumes. La f1eur réliíle
a
la maligruté des hu–
meurs.
eN)
X
ARBH.E ,
f.
m. ('
11'.11•
nato bOL.
)
Les
arbres
{ont les
plus élevés, les plus gros
&
par confé'l11ent les plus
apparens de tous les végétaux. Ce [ont des plantes
lignell[es
&
durables; elles n'ont 'I11'un {eul
&
prin–
cIpal tronc q\Ú s'éleve, [e divi[e
&
s'étend par 'I11an–
tité de branches
&
de rameaux, dont le volume
&
l'app~rence
varient en rauon de l'age, du climat, du
ten'em, de la cululre,
&
principalement de la nature
de chaque
arbre.
En comparant la hauteur
&
la con–
~il:ance
de
tout~s
les plantes, on va par des nuances
ll1{eníi~les dep/l~s
L'hyffope j/lfqll'au eedre du Liban;
je
veux dire deplus la plante la plus baíI'e ,jufqu'a
l'ar–
bre
le
pl~s
élevé, depuis l'herbe la plus tendre juf–
qu'au bOiS
l~
plus dur : ainft qUDique les herbes [oient
les
pl.uspetltes des plantes, on auroir pu confondre
c~;ta.mes
e[pcces d'herbes avec les
arbres,
li on
11
etolt convenu de donner les noms
d'arbriffiaux
&
de
fous-arbriffiallx (Voye{
ARBRISSEAU, SOUS-AR–
llRISSEAU ) aux plantes de grandeur & de conli[–
tanee. moyenne entre les herbes
&
les
arbres
:
cepen–
dant
ti
eH encore aíI'el. difficile de dillinguer les
ar–
bres
des arbriíI'eaux. Quelle diJférenee
y
a-t-il entre
le plus perit des
arbres
&
le plus grand des arbru–
{eaux
?
Il
n'eíl pas poffible de la déterminer préciíe–
ment : mais on peut dire, en général, 'I11'un
arbre
doit s'élever a plus de dix ou doul.e piés. Cette hau–
t~ur
eíl bien éloignée de celle des chenes ou des fa–
pms, dont le [ommet s'éleve
a
plus de cent piés; c'eíl
pourquoi on peut divifer les
arbres
en grands, en
mOyens & en petits
arbres;
le chene, le {apin, le
maronnier d'{nde ,
&c.
{ont du premier rang ; l'aune,
le
ch~ne
verd , le prunier,
&e.
peuvent
~rre
du
[e–
cond; le pecher, le laurier , le neflier ,
&c.
[ont du
nombre des petits
arbres.
Les
Bota.ni~es
Ont rapporté les dilférentes efpeces
d'
arbres
a
dilferens genres qu'ils ont caraaérifés com–
me routes les autres plantes, par le nombre, la figure
AR B
& la poiition de certaines parties , principalel\1clit
des fleurs
~
des frnits ; & dans cet arrangement la
plllpart ontconfondu les herbes avee les
arbre~.
On a
mis {olls le
m~me
ordre , ou dans la meme Ceaion ,
la capucine avec l'érable, la filipendule avec le poi–
rier , le pourpier avec le tilleul,
&c.
Ces méthodes
pourroient donner une fauífe idée de certains
arbres
lorfc¡u'on lcs voit [ous le mgme genre, c'eíl-a-dire
[ous un nom commun avec des plantes qui ne [<'ht
que des [ous-arbrilreaux : par exemple, le
ch~ne
&
le [aule [ont deux grands arbres; cependant, [eIon
les méthodes de Botanique, il Y
a
des
ch~nes
&
des faules nains. Les méthodiil:es, qui [e font
íi
peu
de {cmpule de changer les noms des pi antes les plus
ulités ,
&
qui leur en [ubíl:ituent de nouveaux a leur
gré , devroient bien plútot donner
a
certains arbri[–
[eaux des noms dilférens de ceux que portent de
grands arbres; par ce moyen on oteroit tome é'l11i–
v0'l11e dans la lignifieation du mot
arbre
,
autrement
on ne s'entend pas; car on a néeeíI'airement l'idée
d'un
arhre
lor[qu'il
~'a~it
d'un chcne ou d'un [aule;
cependant pour [e preter aux convcntions des mé–
thodiíl:es,
&
pour
Ce
faire
a
leur langage ,
iI
faut
prendre de petits arbrilreaux pour des chenes & pour
des {aLÚes,
&
donner le nom
d'arbre
a des plantes
que l'on ne doit regarder que comme des [ous-arbriC–
{eaux. Toute méthode arbitraire nous induit nécef..
[airement en erreur; celle 'I11e M. de Tourneforr a
donnée pour la diil:ribution des plantes eil: une des
meilleures que nous ayons [ur cene mariere ; il a
{enti le ridicltle des méthodiil:es qui
m~lent
iodiJfé–
rcmment les herbes
&
les
arbres,
&
il a t1lché de
l'éviter en rangeant les
arbres
& les arbrilreaux dans
des claífes particulieres ; cependant comme fa mé–
thode eil: arbitraire, il a été obllgé , pour la [uivre,
de s'éloigner quelquefois de l'ordre naturel: par
exemple, en réuruífant [O\1S le
m~me
genre l'yeble
avec le [lu'eau , l'
altlltllafrtttex
avec la guimauve,
&c.
La nature [e ren¡[era toLljours
a
nos conventions;
elle ne s'y [oúmettra jamais , pas memc
a
la meil–
leure des méthodes arbitraires.
Voye{
MtTHODE.
Les Jal'diniers & tous ceux qui ont cultivé des
af–
bres,
n'ont donné aucune attention aux caliees
&
aux
pétales, ni aux pillils
&
aux étamines des f1eurs : mais
ils ont ob[ervé [oigneuCement la nanrre des dilférens
arlms,
pour lavoir la fa<ron de les cultiver; ils [e
{ont elforcés de multiplier ceux c¡tu méritoient de
l'etre par la 'I11alité du bois, la bonté des fruits, la
beauté des fleurs
&
du feuillage. Auffi ont-ils diílin–
gué les
arbres
en
arbres robllflts
& en
arbres dJlicaes;
arbres
'I11Í 'I1úttent leurs feuilles;
arbres
toújours
verds;
arbres
cultivés;
arbres
de
for~t;
arbrts
fi-ui–
tiers;
arbres
d'avenues, de boC'I11ets, de paüífades,
arbres
f1euriífans ,
&c.
Tous les
arbres
ne peuvent pas vivre dans le
m~me climar. Nous voyons que pour les
arbres
étran–
gers, le climat eil: en Franee le plus grand obil:acle
a
Ieur multiplicarion; il Y a peu de ces
arbres
qui fe re–
nlfent au terrein, mais la plupan ne peuvent pas ré–
ftfier au froid. La {erre
&
l'étuve [ont lme foible re[–
{ource pour {uppléer
a
la température du climat; les
arbres
délicats n'y végetent que languilramment.
Les
arbres
clui 'I11ittent leurs feuilles [ont bien plus
nombreux que eeux qui {ont tOlljours verds ; les pre–
miers croiíreIlt plus promptement, & [e mulriplient
plus auément que les autres, parmi lefi¡uels d'ailleurs
il ne s'cn trouve qu'un tres-petit nombre, donrIe fi-uit
foit bon
a
manger.
On Ile {eme pas tOltjours les
arbres
pOU!' les mul–
riplier, il Y a plulieurs autres fa<rons
'!11Í
{ont préfé–
rabIes dans cenains caso La grelfe perfeélionne la flenr
&
le fruit: mais c'eil: aux dépens de la hauteur
&
de
l'état naturel de
l'arbre.
La bomure eíl une voie faci–
le, qui réuffit plus éommunément pour les arbriífeaux
















